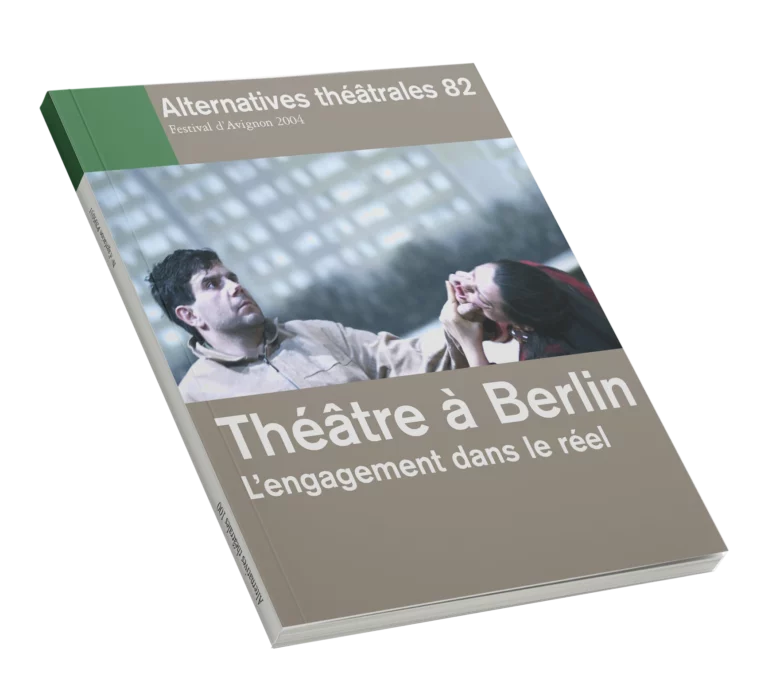PEUT-ON PARLER d’une fonction particulière du théâtre en RDA avant 1989 ? Dans quelle mesure s’agissait-il d’un théâtre politique ?
Wolfgang Engler : On peut dire que le théâtre en RDA était différemment politique qu’il ne l’a été ailleurs ou après, du fait que même s’il ne se voulait pas forcément politique, il était perçu comme tel. Le théâtre, l’art ou la littérature étaient considérés a priori comme recelant un contenu à déchiffrer, des allusions, une confrontation avec le système politique, soit à un niveau métaphorique, soit dissimulé dans une fable. C’était comme la condition préalable à la réception ou à la consommation de l’art et de la culture, tout du moins dans les années 80, sans vouloir bien sûr passer en revue toute l’histoire de la RDA.
Quel public allait au théâtre ?
W. E. : Il n’y avait plus de public bourgeois, puisqu’il n’y avait plus de bourgeoisie, ni une bourgeoisie possé- dante, ni une bourgeoisie cultivée qui aurait pu avoir un intérêt purement « culinaire » pour la culture, un intérêt pour le théâtre « en soi », c’est-à-dire qui aurait voulu voir l’œuvre présentée en tant que telle, ou être sensible à une authenticité de l’œuvre. Au contraire, le public moyen représentait la société moyenne, exception faite, bien sûr, de ceux qui tout simplement n’allaient pas au théâtre.
Le public ne représentait pas une société bourgeoise, mais une société relativement égalitaire d’ouvriers et d’employés. Parmi eux, allaient au théâtre ceux qui étaient culturellement les plus engagés, prétendant ainsi entrer dans un espace public. La condition préalable à cela était, pour le public comme pour ceux qui produisaient du théâtre, du cinéma ou bien de la littérature, que l’on traite de quelque chose qui concerne la société.
Le théâtre en RDA avant 1989 était-il considéré comme une institution étatique ou bien comme un espace de subversion ?
W. E. : Les deux à la fois, car le subversif était demandé par le public. Mais est-ce que la subversion avait lieu dans tous les cas ? Probablement pas. C’était une affaire de réception : on attendait du théâtre une confrontation, l’expression de quelque chose en opposition aux conditions politiques en place.
Cela concernait l’écriture dramatique contemporaine, qui était le plus souvent importée d’Union soviétique.
À l’intérieur du pays, les auteurs dramatiques n’écrivaient plus de théâtre contemporain, ni Heiner Müller, ni Peter Hacks, ni Volker Braun ou Christoph Hein, on leur en avait fait passer l’envie. Mais ils écrivaient des paraboles. Il s’agissait de raconter au moyen d’une parabole une histoire contemporaine, ou bien d’interpréter les classiques de sorte qu’ils acquièrent une pertinence contemporaine. Il y avait trois façons de faire, trois sortes de textes : les rares pièces contemporaines, les interprétations politiques ou prétendument politiques de classiques et les pièces dont l’auteur choisissait de délocaliser l’action vers d’autres contrées, dans d’autres époques ou d’autres environnements culturels afin de pouvoir y thématiser plus librement ses préoccupations et de présenter ainsi un reflet de la société.
Et est-il resté quelque chose de cette spécificité après 1989 ?
W. E. : Si l’on pouvait avoir une vue d’ensemble, on parlerait plutôt d’héritage ici ou là… mais je pense qu’il n’est rien resté de cette spécificité parce que les structures qui donnaient sens à l’ensemble n’existaient plus.
L’autre raison, c’est qu’un espace public, qui n’était pas sans importance pour la scène comme pour l’écriture dramatique, n’apparaît plus : c’est l’espace économique, et ce simplement parce que cet espace a été privatisé depuis. Dans l’écriture dramatique de la RFA de 1945 à 1990, il n’existe pas une seule pièce qui traite de la production ( Produktionsstück). Au contraire, en RDA, la production était un thème important de l’écriture dramatique.
On traitait amplement des relations sociales qui ne s’y déroulaient pas comme on pensait qu’elles le feraient, du fait que l’économie manquait de rendement, ou bien ne fonctionnait pas de manière « économique»… tout cela constituait un élément essentiel de cette écriture et disparaît aujourd’hui totalement.
Mais trouve-t-on des traces de cette expérience historique – sinon dans les productions théâtrales – dans la réception du public, dans ses attentes ? Qu’est devenu ce public de la RDA ?
W. E. : C’est difficile à savoir, car il n’y a malheureusement plus d’études sociologiques sur les théâtres allemands et sur la composition de leur public. Dans les années 80, on faisait des recherches, tant à l’Ouest qu’à l’Est, sur les couches socioprofessionnelles, les différentes classes d’âge qui allaient au théâtre.
Mais les gens qui allaient au théâtre en RDA, qui ont été marqués par ses formes dramatiques, semblent s’être faits au changement des contenus, à la privatisation
des thèmes abordés sur scène ; les autres, le théâtre les a perdus…; cette pratique culturelle ne fait plus partie de leur vie parce qu’ils n’y retrouvent plus leurs problématiques… Que le travail ne soit plus abordé au théâtre a aussi une autre raison : dans la partie est de l’Allemagne, seule une petite partie des gens travaille encore…
Non seulement le travail lui-même a été privatisé, et n’est donc plus l’espace public et de société qu’il était, mais surtout il est devenu presque le fait d’une minorité : d’une population qui travaillait à 99 %, il reste à peu près 40 % d’actifs.
Le théâtre de l’Est s’est-il conformé au théâtre de l’Ouest ? Ou bien, comme vous l’observez pour la société est-allemande dans votre ouvrage Die Ostdeutschen ( Les Allemands de l’Est), quelque chose de spécifique s’est-il développé après la réunification, au théâtre ou encore dans d’autres formes artistiques ?
W. E. : En effet, je crois qu’il y a eu dans les années 90 une particularité du paysage théâtral est-allemand, parce que la situation géographique et politique faisait qu’une grande partie des gens, public comme acteurs culturels, s’intéressait de manière engagée à l’est de l’Europe…
Le théâtre de Cottbus ( proche de la frontière polonaise) a par exemple thématisé cette proximité en orientant sa programmation autour des problématiques des limites de l’Europe et de sa périphérie, jusqu’à en faire une sorte de festival annuel. Il s’agissait donc de particularités déterminées par la situation géopolitique locale des théâtres qui s’affirmaient face à la simple pratique théâtrale. Ces conditions ont conduit à ce que soit traité autre chose que seulement ce qui était en vogue.
Mais les réflexions ou productions les plus intéressantes de cette période n’ont pas eu lieu au théâtre. Si on devait considérer les années après la chute du Mur à travers leurs traces artistiques, le théâtre ne se révèlerait pas très important, la littérature non plus. Les témoignages les plus intéressants sont sans doute ceux laissés par le film documentaire ( et pas le film de fiction).
Et ce tout simplement parce que ce n’était pas une époque de projets, d’esquisses, où l’on avait une idée de là où on voulait aller, et où l’on pouvait formuler ses représentations à travers la production artistique.
C’était une époque d’inventaire, de constat, d’interroga- tions et d’observation de la réalité, de questionnements que l’on retrouve dans les films de Volker Kopp, Thomas Heyse ou Wilfried Junge… Ce sont sans doute ces travaux qui constitueront la mémoire collective de cette période, plus que d’autres genres, car ils étaient au plus près de ce qui se passait, et renonçaient à l’effet artistique pour se concentrer sur l’observation.
Comment est ce que l’on peut expliquer le phénomène constitué par la Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz à Berlin dans les années 90 ? Le travail de Frank Castorf, directeur de ce théâtre depuis 1992, était très impressionnant car il représentait directement les aspects les plus concrets des changements économiques et politiques de l’époque, et affirmait une trivialité du signe devant un public nombreux… Est-ce que l’on peut dire que le théâtre de Castorf s’est imposé peu à peu à l’Ouest, mais plus selon des critères théâtraux qu’en fonction de sa pertinence politique ?
W. E. : La Volksbühne était vraiment un phénomène particulier, parce que ce fut un événement Est/Ouest, une expérience commune, ne serait-ce qu’en raison de l’esthétique, du langage théâtral qui concentrait quelque chose de l’air du temps. La mise en pièces des textes, le fragmentaire, le provisoire, les moments fugitifs sur lesquels on attirait l’attention – tout cela convenait sans doute plus à un public de l’Ouest qu’à un public de l’Est. Pour les gens de l’Est, les mises en scène de la Volksbühne représentaient une manière de prendre congé d’un monde qui touchait à sa fin, une sorte d’accompagnement de fin de vie avec l’aide du théâtre, une récapitulation. À l’époque, les comédiens de la Volksbühne étaient presque tous de l’Est et résumaient sur scène leur expérience, tout en communiquant à un niveau thématique, dans les pièces et dans la façon dont elles étaient traitées, avec un public de l’Est.
Par contre, l’esthétique était pour les deux publics le dénominateur commun. Le public de Berlin-Ouest n’avait, je crois, que peu de part au contenu. Mais il était attiré par l’aspect spectaculaire de la chose, par le choix du « vrai », de l’authenticité, par la façon particulière non théâtrale de jouer. Les acteurs jouaient avec leur propre personne, c’était caractéristique, ils ne tenaient pas des rôles selon les conventions théâtrales habituelles… Voilà ce qui attirait le public jeune, avec son besoin d’authenticité. Mais à l’inverse, la chose elle-même, le fait que les pièces et la façon dont Frank Castorf et sa troupe les représentaient constitue un processus de réflexion, de confrontation avec la fin du communisme et l’entrée dans un monde capitaliste – tout cela est sans doute resté inaccessible à un public de l’Ouest, ne l’a pas vraiment intéressé.
En tout cas, le succès s’explique de par ces deux aspects. Il n’existait pas d’autre lieu qui soit ainsi à l’avant-garde esthétique, dans la mise en pièces des textes et des conventions théâtrales… ainsi que dans les théma- tiques qui, jusqu’à aujourd’hui dans les derniers travaux autour de Dostoïevski, élaborent une réflexion autour d’une certaine expérience de « l’Est », de l’Allemagne de l’Est comme de l’Europe de l’Est.
Et comment les choses se sont-elles passées dans d’autres grandes villes d’Allemagne de l’Est ?
Le dramaturge Thomas Oberender émet l’hypothèse qu’après 1989, en ex-RDA, certains auteurs ont disparu du répertoire tandis que les classiques de l’époque bourgeoise étaient redécouverts, et par là même une « identité bourgeoise»… Est-ce qu’on joue aujourd’hui la même chose à Hambourg et à Leipzig ? Ou bien peut-on parler d’une spécificité de programmation en ex-RDA ?
W. E. : C’est difficile à observer car les théâtres rivalisent, mais en même temps il y a des vagues thématiques et les metteurs en scène circulent de plus en “plus dans l’espace théâtral allemand dans son ensemble. Cela dit, je ne crois pas qu’on tente de « retrouver » une identité bourgeoise ou de « rattraper » une époque bourgeoise en ex-RDA, parce qu’il manque les gens pour cela. Le public n’était pas un public bourgeois auparavant, il l’est encore moins aujourd’hui.
Actuellement, le public est plutôt plébéien ou bien rabaissé à un niveau sous-prolétaire… du fait que la majorité est constituée d’inactifs.
Mais il est vrai qu’on constate un retour des textes bourgeois et classiques dans les théâtres de l’Est, comme à Berlin au Deutsches Theater. La programmation constitue une sorte de récapitulation du répertoire bourgeois à grand renfort de textes classiques. Mais je ne pense pas que cela puisse être la base d’une communication accrue avec le public… À qui s’adresse aujourd’hui la désillusion des personnages bourgeois de Tchekhov si on ne trouve pas un niveau métaphorique, une façon d’actualiser ces enjeux ? Est-ce qu’on ne sait pas quoi jouer d’autre ? Ou bien est-ce par frilosité, pour être sûr d’attirer les spectateurs : les textes et les auteurs sont connus, ainsi on ne prend pas de risques. En ces temps de crise économique, cela n’est pas si improbable.
À l’inverse, comment les pièces d’un metteur en scène et auteur comme Armin Petras peuvent-elles êtres jouées à l’Ouest et faire salle comble ? Qu’est-ce qui, dans ce théâtre, intéresse le public de l’Ouest ?
W. E. : En ce qui concerne Armin Petras, c’était encore tout à fait différent au début des années 90. On avait l’impression que, malgré des moyens très personnels, le théâtre de Petras allait devenir du Castorf : une forme de culture trash, avec une façon de violenter quelque peu les textes ou les histoires, de les actualiser avec force dans des scénographies extrêmes… Mais il est un des rares auteurs de l’Est dont les textes sont compréhensibles par un public de l’Ouest. Il introduit toujours dans les fables certains éléments qui reflètent une expérience de l’Ouest. C’est vrai qu’après avoir quitté la RDA, il a aussi vécu à l’Ouest. Dans une pièce comme ZEIT ZU LIEBEN, ZEIT ZU STERBEN… par exemple, une partie de cette expérience à l’Ouest est thématisée.Le personnage principal découvre l’amour à l’Ouest, cette expérience contraste avec les ruades désespérées contre les conditions de vie à l’Est. L’histoire et les personnages sont de moins en moins réductibles à leur lieu d’origine.Dans ses textes se cristallise quelque chose comme un voyage à travers les deux parties de l’Allemagne, une forme de comparaison.
Est-ce que c’est le début d’une unification ?
W. E. : Oui, je crois que l’époque où l’on se répartissait les contenus en fonction de son origine dans l’une des deux Allemagnes touche à sa fin. Cette évolution est sensible dans différentes formes artistiques et tout particulièrement chez la jeune génération. Au cinéma, on assiste ainsi à des croisements entre thématiques et origines, comme récemment dans le film HERR LEHMANN, à travers lequel le réalisateur de l’Est Leander Haußmann s’intéresse au Berlin-Ouest des années 80.
Le film GOOD BYE, LÉNINE, qui relate la période de la chute du Mur dans une famille de l’Est et dont le réalisateur Wolfgang Becker vient d’Allemagne de l’Ouest, en constitue un autre exemple. En littérature, on observe la même chose et la jeune génération d’auteurs, qui ont environ une trentaine d’années, qu’ils soient originaires de l’Est ou de l’Ouest, trouvent leurs thèmes et leur inspiration de préférence à l’Est.
Pour revenir au théâtre, quelle pertinence, quelle influence peut-on lui reconnaître aujourd’hui ?
W. E. : Pour le moment, parmi les différentes formes artistiques, le théâtre ne semble pas prendre une signification particulièrement importante. On assiste plutôt à une colonisation du théâtre par le cinéma, par les mondes imaginaires et visuels du film. En Allemagne, ces dernières années, les événements les plus spectaculaires qui ont suscité des débats et interpellé l’opinion publique n’ont pas été des évènements théâtraux, mais ont plutôt été liés à la sortie d’un film ou d’un livre. C’est-à-dire que le théâtre ne semble pas être le lieu où notre époque se réfléchit, aux deux sens du terme, ni le lieu public qui cristallise et déchaîne les passions. Le théâtre lui-même est en partie responsable de ce phénomène, en ce sens qu’il a dans les années 90 énormément réduit son sujet, en le privatisant d’une manière que je trouve particulièrement inquiétante : les thèmes abordés sont purement privés, se retirent dans les intérieurs et engagent à peine plus de personnes que les habituelles constellations familiales. Contrairement à ce qui se passait dans les décennies précédentes, le « monde » est très peu présent sur la scène.
Il ne reste qu’à espérer que le théâtre s’ouvre à nouveau, suscite des frictions avec la société, se remette à assumer sa mission publique. Il faudrait commencer par redéfinir les liens entre le théâtre et le lieu où il se trouve, le public local. C’est ce que Thomas Ostermeier a réussi avec la mise en scène de NORA ( MAISON DE POUPÉE ) d’Ibsen à la Schaubühne de Berlin : il était absolument nécessaire de tendre au public de la Schaubühne un miroir de ce qu’il est devenu. Ostermeier, en donnant une forme actuelle aux personnages de la pièce, a proposé aux spectateurs de ce théâtre, qui autrefois étaient porteurs des idéaux de 68, une représentation de leur évolution.
Le public était confronté à son portrait critique comme au temps de Botho Strauss. Ce qui n’a pas empêché le succès, au contraire.
Est-ce que l’on peut considérer que le système théâtral allemand est l’héritier d’une société qui n’existe plus ?
W. E. : Oui, et c’est avec la perte de cette place dans la société que les théâtres sont le plus en prise. Sous l’ancien régime, au temps du pouvoir absolu, les théâtres étaient le lieu où la bourgeoisie se définissait et se relativisait, par le biais des représentations qu’en proposaient les pièces. C’était pour la bourgeoisie à la fois un acte de communication et une réflexion sur sa propre époque. Dans une société qui n’est plus déterminée par la bourgeoisie, c’est bien évidemment difficile à conserver. Si ce milieu social n’existe plus, que deviennent les lieux du débat public de la bourgeoisie que le théâtre constituait, avec la littérature ? Comment faire lorsque s’est dissout le champ social qui a créé ces institutions ?

Pour faire face à cela, on peut observer différentes stratégies : soit un théâtre cosmopolite, interchangeable, où les pièces s’importent et s’exportent et où les thèmes viennent aussi d’ailleurs ; soit un théâtre où l’on tente de porter son attention sur le lieu où on se trouve et sur son public en s’efforçant de le thématiser, comme cela a été le cas à la Schaubühne, à la Volksbühne, mais aussi à Cottbus, à Rostock ou à Schwerin. En règle générale, le fait que le théâtre ne communique plus avec sa communauté participe de sa perte de signification.
Le théâtre ne s’inquiète pas de connaître son public et ne tente pas d’analyser ses préoccupations et problèmes, il ne propose rien de plus que ce que l’on sait déjà : que la vie conjugale entre quatre murs est oppressante ou bien que l’on puisse devenir terroriste dans sa vie privée, ce ne sont pas vraiment des révélations.
Est-ce que ces lieux de débat public se sont déplacés ? Les trouve-t-on ailleurs ?
W. E. : S’ils existent encore ! Il est difficile de dire s’il y a encore aujourd’hui des lieux de rassemblement de la communication collective… Il n’y en a probablement plus autant que par le passé. Mais s’ils existent, c’est sans doute plus au cinéma qu’au théâtre. Le cinéma est le plus global des phénomènes culturels ; lorsqu’on entend des gens échanger autour d’un produit culturel, il s’agit la plupart du temps d’un film. Le cinéma permet donc une communication, on communique parce qu’on a vu le film, ce qui est bien sûr plus difficile avec le théâtre, du fait de sa temporalité et de son ancrage dans un lieu.
Mais alors, est-ce que cela veut dire que les besoins d’échanges et de communication se réduisent à la sphère privée ?
W. E. : À l’Est, avant 1989, les protestations des citoyens se regroupaient autour de deux lieux : les églises et les théâtres. À l’automne 1989, beaucoup de théâtres étaient des lieux de la vie sociale et politique, ce qui “montre bien qu’ils étaient perçus comme des lieux où la communication publique trouvait sa place. Spontanément, la population s’est tournée vers les théâtres : dans de nombreuses villes de RDA, ils sont devenus soudain des tribunes où l’on débattait, où l’on formulait des solutions, où l’on planifiait les jours suivants.
Qu’en est-il de l’espace public aujourd’hui ?
Il semblerait qu’il soit vraiment déserté. Cela est dû à différents phénomènes, parmi lesquels la précarisation sociale est le plus important, c’est-à-dire la réelle vulnérabilité qui ne touche pas seulement les chômeurs.
Tant que l’on croit pouvoir encore se réfugier ou se régénérer dans la sphère privée, on y reste. Lorsque cela ne sera plus possible, on en sortira, mais pour le moment je crois que nous sommes dans une phase de profonds bouleversements et de déstabilisation des conditions de vie. Et nous n’avons pas encore abordé la phase où cette expérience se généralise et peut être traitée en commun, discutée en public, proposée au débat.
Pour le moment, nous sommes face à de nombreux phénomènes individuels, aux souffrances personnelles et multiples d’une société qui ne ressent pas encore la nécessité de se rassembler, de se socialiser. Auquel cas il incomberait aussitôt au théâtre une tout autre fonction.
Le théâtre pourrait bien sûr reconnaître ici un aspect de sa fonction et activer de tels processus afin de venir à bout de cette « privatisation » des problèmes, de cette isolation dans la souffrance personnelle. Mais cela impliquerait d’abord de thématiser ces problèmes. Alors que l’on observe au théâtre la même tendance que dans le champ social : individualisation ou privatisation, le théâtre reproduit ce phénomène au lieu de l’interroger.
Une écriture dramatique comme celle de Franz Xaver Kroetz met certes en scène la sphère privée mais démontre son insuffisance, car si les problèmes peuvent bien être abordés dans la sphère privée, ils n’y ont pas leur origine, de même qu’ils ne peuvent y être résolus. En ce sens, il y a toujours dans le caractère privé de l’écriture dramatique des années 60 et 70 un moment où la sphère privée est surmontée et s’ouvre sur la société.
Et c’est précisément ce qui fait défaut aujourd’hui.
Le système culturel allemand fait face actuellement à de nombreuses mesures de restriction budgétaire.
Ces réformes ont sans doute des impacts différents sur la société que l’on se trouve à l’Ouest ou à l’Est de l’Allemagne. Que se passe-t-il dans les nouveaux länder lorsque les institutions culturelles sont remises en question ?
W. E. : C’est un démantèlement. L’Est de l’Allemagneest bien sûr encore plus touché. Car dans la plupart des cas, ces régions ont déjà perdu leurs infrastructuresculturelles après la fermeture des entreprises auxquelles elles étaient rattachées. Dans de nombreux cas, la culture n’était pas sous la responsabilité des communes mais sous celle des combinats industriels, c’est-à-dire qu’ils la finançaient et l’intégraient parfois à leurs structures. Ainsi, la fermeture des usines a marqué aussi la fin de la vie culturelle. Les théâtres ont été les seules structures à survivre.
Pourtant, chaque année, des milliers de jeunes gens se présentent aux concours d’entrée des écoles de théâtre, et on organise partout de petites expositions, des performances dans la salle de séjour… Il semblerait que le besoin de produire de la culture soit bel et bien encore vivace.
W. E. : C’est un potentiel, ça peut mener loin. Fassbinder par exemple a écrit ses premières pièces comme cela, ensuite elles ont été jouées dans la salle de séjour. C’est sans doute la seule manière de susciter une production culturelle authentique et collective. Lorsque des gens se rencontrent et produisent quelque chose ensemble, indépendamment de l’appareil technique ou institutionnel, c’est un moment très rare et très précieux, peut-être le plus vivant de l’héritage théâtral. Même lorsque la facture en reste amateur ou dilettante. En ce cas le théâtre est toujours satisfaisant, car il reste une forme de collaboration et d’échange entre ceux qui sont présents ici et maintenant. On peut dire que de telles formes se sont généralisées de manière non spectaculaire à partir des institutions théâtrales établies.
Le théâtre en tant que pratique sociale augmente ses chances du fait que les autres formes culturelles fonctionnent soit de manière médiatique, soit elles ne
permettent au public qu’une participation indirecte, soit elles isolent les gens, soit elles diffèrent le moment de leur réception et donc de leurs réactions. C’est-à-dire que ces autres formes culturelles ne satisfont pas le besoin d’une communication directe et simultanée.
Le théâtre est la seule forme d’une collaboration effective entre personnes qui existent réellement. Ce besoin de production collective ne trouve presque jamais satisfaction. Le monde du travail – qui jusqu’à maintenant y répondait même avec dureté, était un endroit de coproduction, d’échange social et d’émulation intellectuelle – concerne aujourd’hui de moins en moins de gens. Le travail disparaît du centre de l’existence.
De sorte que la seule pratique pouvant répondre à ce besoin, qui semble être universel, serait le théâtre, ou encore le jeu, mais il semble que, dans notre société, celui-ci soit réservé aux enfants. Il n’est sans doute pas nécessaire de chercher à argumenter la défense du théâtre, à prouver son immortalité ; puisqu’il dépend de ce besoin, c’est une constante anthropologique humaine.
L’entretien a eu lieu le 17 avril 2004 à Berlin.