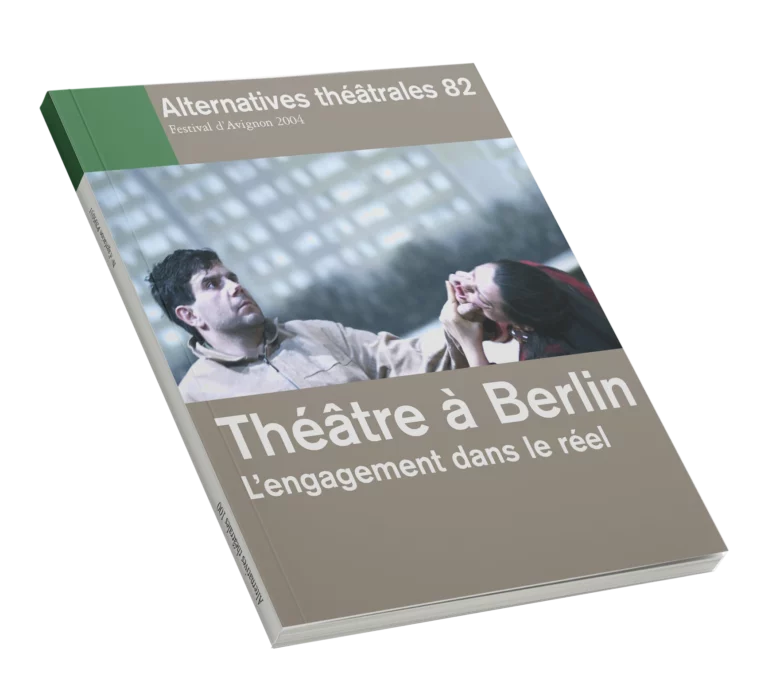RENÉ POLLESCH a souligné depuis ses débuts qu’il n’était pas un auteur de pièces de théâtre (dramaturge). Et certainement pas l’auteur de textes destinés à d’autres metteurs en scène. Et pourtant il reçoit des prix décernés à des auteurs de théâtre, ses « pièces » sont publiées et analysées comme telles et on lui pose régulièrement la question de savoir s’il se considère comme un auteur politique. Un malentendu ? Un indice que le public et les critiques veulent absolument s’orienter sur des critères théâtraux connus ? Oui et non.
Effectivement, René Pollesch écrit et met en scène. Mais son théâtre se veut partie intégrante de la réalité et renverse à plusieurs égards les rapports de représentation entre scène, texte, jeu et public. C’est dans ce sens que René Pollesch écrit aussi ses textes de théâtre, des textes inventant un langage que l’on n’entend pas habituellement sur les scènes. Et René Pollesch est et reste politique, parce qu’il fait du théâtre un espace d’écoute pour des cheminements de pensée que ses acteurs produisent sur la scène avec le public, par-delà la simple transmission d’un texte.
Depuis l’automne 2001, René Pollesch a un lieu pour son théâtre et un public fidèle. Sous sa direction artistique, le Prater est devenu la scène de Pollesch, malgré – ou peut-être justement à cause du « programme accessoire » – d’autres activités. Cette petite salle de la Volksbühne de Berlin ne dispose pas d’un budget propre. Mais elle est située au cœur de Prenzlauer Berg ( Berlin- Est), un quartier qui est devenu, depuis la chute du Mur, le lieu « in » de tous les gens qui fréquentent les cafés, les bistrots et les clubs. Tout ce qu’on pouvait encore récupérer du charme de l’Est pour la jeune « bohème de Berlin » et les touristes de passage, on l’exploite ici à la manière occidentale.
« La ville comme butin » ( StadtalsBeute). Le Prater, premier lieu de théâtre fixe pour René Pollesch, a non seulement mis fin à la période difficile d’un homme de théâtre « libre », qui implique, comme partout, un manque de lieu fixe pour toutes les (co) productions « libres », mais lui fournit également un champ thématique bien déterminé : la façon dont la ville, entre les mains des urbanistes et des architectes, des agents immobiliers et de la politique du « nouveau centre »1 se vend systématiquement et où tout est dirigé vers « l’activation d’espaces publics comme bien immobilier ». La façon dont toute promenade urbaine se mue en une attitude de consommation régulée, entre le café au lait et le design architectural. C’est justement ce dernier aspect que le théâtre de Pollesch présente dans toutes les variantes : il met des bornes fixes à la vie quotidienne chez soi et à l’extérieur, invente des maisons selon « des analyses sociologique des tendances », où la technologie prend les rênes et transforme l’environnement urbain en centres commerciaux qui simulent des besoins aussi bien qu’ils les stimulent. Les « situations » dont le théâtre de Pollesch parle sont matérialisées par des objets du « chez soi » et l’environnement urbain. Elles sont déterminées par la logique du capital et conditionnent également l’individu là où il pensait auparavant pouvoir se retirer dans sa vie privée ou dans la réalisation de soi. Ce ne sont pas les contraintes des rapports de travail et des moyens de production qui sont au centre de son travail, mais la reproduction forcée d’attitudes et de besoins normatifs que le néolibéralisme cultive avec succès.
Si complexes que puissent paraître ces réflexions à travers le jargon théorique des sociologues, c’est à ce langage que Pollesch emprunte la terminologie de ses pièces sur la métropole. Livres scientifiques et études spécialisées constituent ses sources essentielles d’inspiration, ils délimitent la forme langagière et l’espace de réflexion, pour ces sujets presque a‑théâtraux aussi bien que pour les formes – presque – scientifiques de l’expression et de l’argumentation. Il n’écrit pas un théâtre dramatique en dialogues, mais répartit ses textes parmi les acteurs-diseurs qui les propulsent en général avec une rapidité extrême, de manière à la fois « plate » et entrelacée, ou qui les structurent par quelques mots et bribes de phrases criés. Le rythme le plus marquant est celui des cris, lorsqu’ils gonflent les veines du cou pour éructer les « merde » et « truie » et « putain » qui s’intercalent comme des ponctuations dans les passages de textes. L’attitude de parole est tendue, puisque les diseurs doivent suivre le flot de paroles ininterrompu, qu’ils ne jouent pas de rôles, qu’ils ne racontent pas d’histoires, mais qu’ils pensent ensemble. Ils le font en boucles, se vrillent plus loin, recommencent au début ou se perdent dans des idées thématiquement secondaires. Dans le théâtre de Pollesch, l’action dramatique est abolie, il n’y a plus de personnages artificiels ni de rôles et toute intonation d’un conteur serait déplacée. Ce qui importe, ce sont les sujets apparemment objectifs : les processus actuels d’une transformation de la société – par la globalisation, la technologie du pouvoir, les formes du travail propres à la prestation de service – qui à leur tour produisent certaines conventions qui sont alors (re) produites comme « normalité », parmi lesquelles la hiérarchie des rôles liés à la différenciation sexuelle et à l’hétérosexualité, ou l’illusion dont use depuis longtemps le néolibéralisme d’une réalisation personnelle par le biais d’un travail « libre ». Pollesch, qui affirme ne s’intéresser qu’à un théâtre produisant de nouvelles formes d’expressions théâtrales, n’est toutefois pas formaliste. Car son théâtre s’oriente selon des jeux de réflexion qui s’engagent souvent sur des voies alternatives, c’est-à-dire par-delà le consensus scientifique. Mais ne peut s’orienter que celui qui reste ou veut rester en mouvement, celui qui cherche des « voies ». Les acteurs de Pollesch font cela, non d’une façon hésitante et en s’interrompant, mais à la façon d’un coureur qui s’élance avec une accélération incroyable et qui fonce de temps en temps dans le mur. Lorsqu’ils s’arrêtent juste avant ou lorsqu’ils se font mal, parce que les voies de réflexion ne sont pas nécessairement des voies de sortie, ils le commentent d’un « merde » ou d’un « je ne veux pas ça » aussi étonné que révolté.
La tension d’un tel théâtre naît de ces processus de réflexion propulsés sur la scène. Car les spectateurs s’aperçoivent très vite que ces acteurs veulent vraiment trouver, et même comprendre quelque chose, ce qui confère une crédibilité à ce jeu et à ce parler, malgré leur artificialité criarde. Les réflexions et les thèses ne sont pas « codées » littérairement, mais se tiennent très proches de l’analyse de chaque matériau de base, ou conduisent le texte au-delà de l’original, comme le dit elle-même une des auteurs scientifiques et journalistes. Le spectateur n’est pas occupé à retraduire un langage théâtral symbolique et métaphorique. Par contre, l’appareil conceptuel théorique dont use Pollesch échappe parfois à plus d’un, parce chacun ne peut pas être à sa hauteur – mais ne le doit pas non plus. Car cet assemblage de notions théoriques comporte son lot de comique et de caricature, un baratin de jargons qui joue aussi, dans cette forme condensée, d’effets de parodie sur la scène. Car visiblement, les acteurs se battent avec cette terminologie très spécifique et une musique théorique qu’ils transfèrent de leur neutralité scientifique vers les « personnages » sur scène qui parlent en leur nom propre. Mais Pollesch parvient à produire régulièrement des effets du genre « c’est vrai », « c’est exactement ça » chez les acteurs et chez les spectateurs. Ce ne sont pas du tout des triomphes de pédanterie, mais le résultat d’une mise en évidence extrêmement précise des mécanismes produits par le capitalisme de tous les jours et qui le font perdurer. Là où l’individu reconnaît son propre quotidien, celui-ci est dé-normalisé et devient un problème commun.
Insourcing des Zuhause – Menschen in Scheiss- Hotels (Insourcing du chez-soi. La vie dans des HÔTELS MERDIQUES ) est un titre que Pollesch emprunte également à une étude, pour laquelle les auteurs se sont installés dans un de ces hôtels de location de bureaux, où les relations sociales et les sentiments peuvent êtres produits et vendus comme une marchandise immatérielle. Il s’agit donc de pratiques sociales organisées dans le sens d’une entreprise, qui pervertissent les vrais sentiments en rapports négociables et chiffrés. Les émotions sont transformées en services « joués » pour provoquer le sentiment d’un comme chez soi pour l’acheteur ou l’utilisateur. Et ceci afin de trouver une forme de travail qui suggère « la mobilité comme offre attractive pour trouver son identité » et qui ne permet plus une séparation nette et claire des domaines professionnels et privés. Pollesch montre comment les professions modernes du secteur des services sont marquées par les transitions floues entre la sphère du travail et celle de l’habitat. Et comment elles fournissent ainsi les meilleures conditions pour une auto-exploitation parfaite dans tous les domaines. Car tout ce qui, dans ces nouveaux types des professions de la société des services, nécessite de la « créativité » naît d’une initiative propre et donc de trop grandes exigences permanentes envers soi-même. INSOURCING DES ZUHAUSE ne montre donc pas seulement comment on peut déléguer (outsourcing) les émotions personnelles ( ainsi que quelques gros travaux de ménage) à d’autres, dans le cas présent à des services hôteliers particuliers, mais comment le travail s’incruste de plus en plus dans les domaines de l’habitat et de la vie privés.