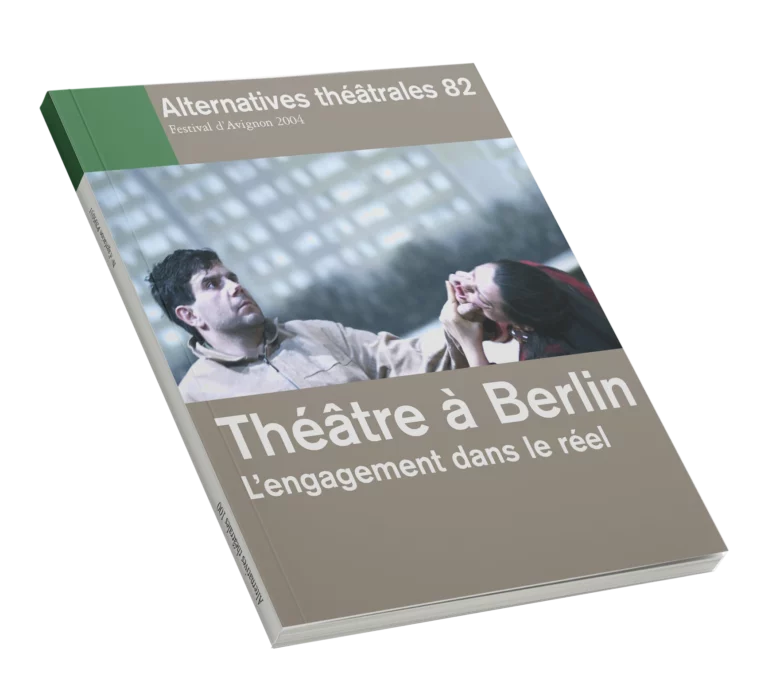LES PIÈCES DU MÉTÉORE LITTÉRAIRE1 ont été montées tant de fois. Qu’est-ce qui inspire, attire, attise encore la saine colère des metteurs en scène de Büchner, quelle substantifique moelle Thomas Ostermeier prélève-t-il de l’animal Woyzeck ? Sans doute un peu de cette bestialité qui est le propre de l’homme : criante dans les villes-casernes d’Allemagne du début du XIXe siècle ; hurlante dans les cités d’aujourd’hui.
L’art du montage
WOYZECK est un puits d’images qui permet des traductions visuelles très variées. Dernièrement, William Kentridge en a fait une adaptation pour marionnettes. Pas étonnant quand on sait que le fiévreux Büchner nous décrit, pauvres humains, comme des pantins « manœuvrés par des forces inconnues ». André Engel avait également réalisé une version très réussie. Un découpage cinématographique donné à voir par le truchement d’une machinerie, qui permettait l’éclatement du dispositif en de multiples aires de jeu, reliées par des fondus-enchaînés réglés par un gigantesque diaphragme. Cette pièce fragmentaire se prête bien au jeu de la recomposition. Pas de découpage en actes, mais une série de scènes courtes dont l’ordon- nancement fait s’arracher les cheveux à quelques traducteurs et autres metteurs en scène courageux2. À leur tour, Thomas Ostermeier et son dramaturge Marius Von Mayenburg ont dû prendre à bras-le-corps ces questions d’écriture. Optant comme Engel pour un art du montage cinématographique, mais sans recourir à un dispositif qui l’évoquerait, ils ont recomposé la pièce comme un scénario de film. Si l’essentiel du texte allemand d’origine est conservé – quelques parties sont coupées, d’autres inconnues de la version française3 –, la véritable particularité de cette adaptation tient à l’ajout de plusieurs scènes muettes. Non pas de simples transitions divertissantes, mais des « natures vivantes » à part entière. Petites chorégraphies surréalistes sur fond de rap tonitruant, strip-tease grotesque et hilarant du capitaine… Ces moments de jeu semblent emportés par la gestuelle et les décibels et les tableaux entrent en collision, relayés par la bande-son. Moments de silence, crissements, tubes anglo-saxons ou rap hypnotique et menaçant… hantent le plateau comme autant de ruptures sonores pour ces scènes auto-tamponneuses.
WOYZECK hic et nunc
On l’aura compris, ce WOYZECK-là parle de nos contemporains à nos contemporains. Inspiré de l’histoire vraie de Johann Christian Woyzeck, à la fin du XVIIIe siècle, le personnage inventé par Büchner était un simple soldat : victime d’un capitaine qui l’exploite, sujet d’expérimentation d’un docteur Mabuse, et trompé par la femme qu’il aime. Au bas de la hiérarchie sociale, il n’est plus ce petit militaire sans carrière, mais un de ceux « d’en bas » – pour emprunter à une sinistre expression ministérielle en cours. Le WOYZECK d’Ostermeier est un de ces « sans » – logis, travail, papier… –, un exclu de nos sociétés relégué à la périphérie d’une ville quelconque. Un individu proche d’une réalité que l’on préfère ignorer. Par souci de vraisemblance historique, politique et psychologique, Büchner avait campé son personnage en puisant dans des comptes-rendus juridiques de l’époque. Armé d’un même souci de vérité, Ostermeier transplante l’histoire dans une cité. Au centre du plateau, une place assez sordide avec un point d’eau desservi par un énorme tuyau d’évacuation, le tout cerné par un amphithéâtre de béton. À part une baraque à frites plantée là en permanence, quelques chaises, un projecteur, des merguez et autres tripes de chat… sont introduits au fil du récit. Sur la scène, dans le lointain, à cour et à jardin, sur les murs latéraux de la salle où le public est installé, l’on ne voit que pylônes, immeubles et fils électriques.