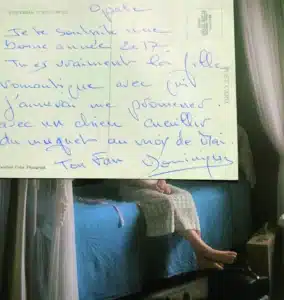BRUNA FILIPPI : Dans quelle mesure la notion de risque est-elle présente dans ta pratique artistique actuelle ? A‑t-elle changé au cours du temps ?
Mathilde Monnier : La notion de risque se déplace en permanence, ce n’est donc pas qu’elle a changé mais qu’elle ne se situe plus au même endroit dans mon travail. Les risques ne sont plus les mêmes qu’il y a une dizaine d’années. En tout cas, la question du risque reste pour moi fondamentale. Le risque est ce qui m’amène à faire des créations, ce qui me met en jeu et me fait bouger. Le risque est l’enjeu premier.
B. F.: Comment cette prise de risque, fondamentale, fait-elle partie de la formalisation de ton art ? Comment s’inscrit-t-elle dans la construction des spectacles, dans ton travail quotidien ?
M. M.: La formalisation, c’est essayer de cerner le risque, et justement de l’apaiser. Le risque s’inscrit dans une part d’inconnu, il n’est pas rationalisable. S’il était rationalisable, on ne prendrait pas de risque. On se projette dans quelque chose qui fait peur, avec le sentiment de ne pas pouvoir le contrôler. Mais ce n’est là qu’un premier type de risque, il y en a un autre, après, qui concerne la pièce elle-même, ce qu’elle va risquer. La question est alors de savoir comment la pièce va être reçue par le public. Dans les deux cas, c’est l’inconnu. Dans ma pratique artistique, cela touche vraiment le quotidien parce que la mise en jeu du corps est toujours risquée, elle n’est jamais acquise d’emblée. Dans ma recherche chorégraphique, je ne travaille pas à la construction d’un style. C’est au contraire chaque fois une aventure nouvelle qui se vérifie au quotidien.
B. F.: En prenant des risques, se libère-t-on de soi-même et de son image ? Ou bien du public et de l’institution ?
M. M.: Je crois que les trois ne sont pas dissociables. Tu ne peux pas libérer quelque chose du public que tu ne libérerais pas en toi. Ces trois éléments sont en fait étroitement liés. Ce qui se libère en toi-même est quelque chose de très complexe. Il est difficile d’anticiper cette question parce qu’il y a des pièces qui libèrent une part d’inconscient, mais ce n’est jamais là que ça se joue. Pour ce qui est de l’image, elle ne m’intéresse pas. Je n’ai jamais cherché à construire une image. Même si on m’en a inévitablement collée une, je ne sais pas trop ce qu’est cette image, je n’arrive pas à la visualiser.
B. F.: Par la prise de risque, est-ce qu’il y a quelque chose que tu veux briser ou mettre à l’écart ? Que veux-tu atteindre ?
M. M.: Prendre des risques revient pour moi à créer toujours plus de liberté dans mon rapport au monde. En fait, plus tu prends des risques, plus tu parviens à prendre une distance qui te donne une liberté d’être. Cette distance évite d’être prisonnier de soi-même, tout en passant par la création d’une certaine forme. Mais on sait que l’on n’échappe pas totalement à soi même, il y a toujours des récurrences qui te rattrapent. La prise de risque, c’est s’étonner soi-même tout en testant ses propres limites. Il y a un rapport de coexistence entre la prise de risque et la forme. La prise de risque crée et invente la forme. Elle déforme, déconstruit et même, brise la forme.
B. F.: Est-ce que la prise de risque se transforme lorsque tu entres dans le travail collectif ? En quoi devient-elle un enjeu collectif ?
M. M.: Il est toujours difficile de faire peser sur les autres tes risques personnels. Toutefois, ce sont souvent mes danseurs qui m’aident à prendre un risque. En fait, ce sont eux qui supportent le risque et, même, qui le précipitent. Ils ont une forte intuition, savent où se trouve le risque et, en général, ils ont la force d’aller beaucoup plus loin, en l’accentuant. Les danseurs que je choisis pour mes projets savent où se situe le risque et ils le prennent avec moi.
B. F.: Quelle différence il y a‑t-il entre la provocation et le risque ?
M. M.: La provocation est un état beaucoup plus volontaire. C’est un faux état de risque, une espèce de mise en scène du risque. C’est déjà une ré-appropriation de la notion de risque, une pure représentation. Il y a des artistes qui sont dans la provocation et le font très bien. Mais le risque qu’il y a reste mesuré, calculé.
B. F.: Est-ce qu’il y a une différence entre « prendre un risque » et « être en révolte » ?
M. M.: Oui, « prendre un risque » est une posture d’artiste tandis qu’«être en révolte » est plus une posture de citoyen. Les deux ne se placent pas au même niveau. La révolte reste individuelle. L’histoire de la révolte est une histoire de l’individu qui se positionne face au monde sans forcément passer par la représentation. Je ne pense pas que la scène soit un lieu de révolte. Je vois plutôt des interprètes dans la révolte. Malheureusement, la scène n’est plus très politique, ni proche des questions sociales comme elle a pu l’être un certain moment. Aujourd’hui elle reste très esthétique, toujours dans la représentation. J’ai l’impression qu’on est plutôt dans un mouvement régressif, les spectacles penchent pour le divertissement, même si cela passe par la provocation.
B. F.: Selon toi, le public préfère-t-il que le risque ne soit pas visible ?
M. M.: Oui, le public ne veut pas forcément voir le risque sur scène. Malheureusement, on cherche aujourd’hui plutôt des formes qui ne prennent pas de risque. Le public suit ce que propose l’institution. Il y a une sorte de dépendance entre l’un et l’autre. L’institution donne de l’argent à des spectacles qui vont tourner et les programmateurs choisissent des spectacles dont il sont sûrs qu’ils vont être aimés par le public. Les règles du marché font qu’on choisit des spectacles qui prennent le moins de risques possibles. C’est un calcul permanent de la part des producteurs et des directeurs de salle pour prendre des risques minimaux. Cette année, par exemple, le festival d’Avignon prend de gros risques avec une programmation où il n’y a pas de théâtre classique et où il y a, par contre, de jeunes auteurs. Pour un public aussi diversifié que celui d’Avignon, c’est un risque.
B. F.: Est-ce qu’aujourd’hui, à la lumière de ce que tu viens de dire, un risque est encore un risque ?
M. M.: En tant qu’artiste, je me pose moi-même cette question parce que j’ai moins d’illusions qu’avant par rapport au statut de la scène. Je pense que les risques qu’on pourrait prendre sont des risques plus politiques ou plus sociaux. Je n’ai pas d’utopie par rapport à l’impact du spectacle sur la vie car on sait très bien où est l’art aujourd’hui. Même s’il peut être subversif et provocateur, tout reste lié à la situation du marché. Face à cette situation, la notion de risque devient importante. Les risques se prennent à plusieurs. Mais, aujourd’hui, on demande à l’artiste de prendre des risques tout seul, les programmateurs ne sont disponibles à les partager que lorsqu’un spectacle marche. J’attends aujourd’hui que les producteurs prennent des risques avec l’artiste. Par exemple, avec des artistes jeunes ou méconnus. Il faut sortir du mythe de l’artiste qui prend des risques tout seul. Pour moi, le risque est quelque chose qu’on partage à plusieurs.
B. F.: Au regard de cette problématique, Antonin Artaud a‑t-il selon toi une place aujourd’hui ?
M. M. : Artaud est avant tout un poète. Par la folie du langage, par son rapport charnel avec les mots, Artaud a transcendé la scène. Aujourd’hui, la scène a tellement intériorisé la transgression qu’on peut dire que la scène a tout récupéré, tout intégré. La posture individuelle de l’artiste dans un état limite ne peut plus exister parce que les artistes sont plus calculateurs, ils gèrent leur carrière. Artaud ne gérait pas sa carrière. On ne peut pas séparer l’artiste de sa posture d’individu dans la société. De sa révolte.