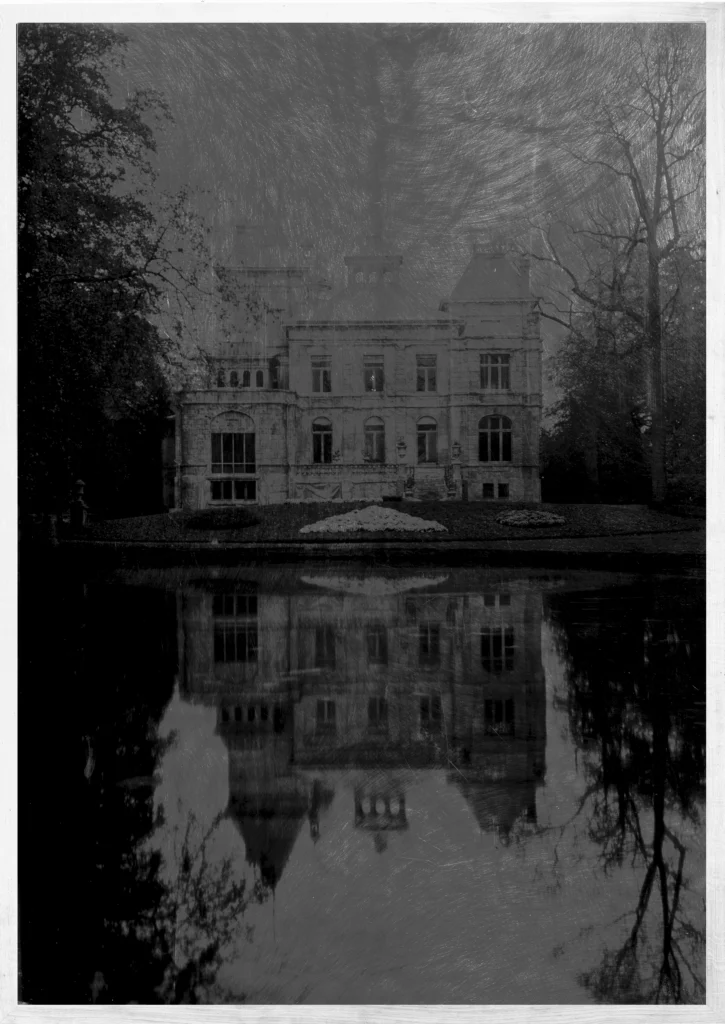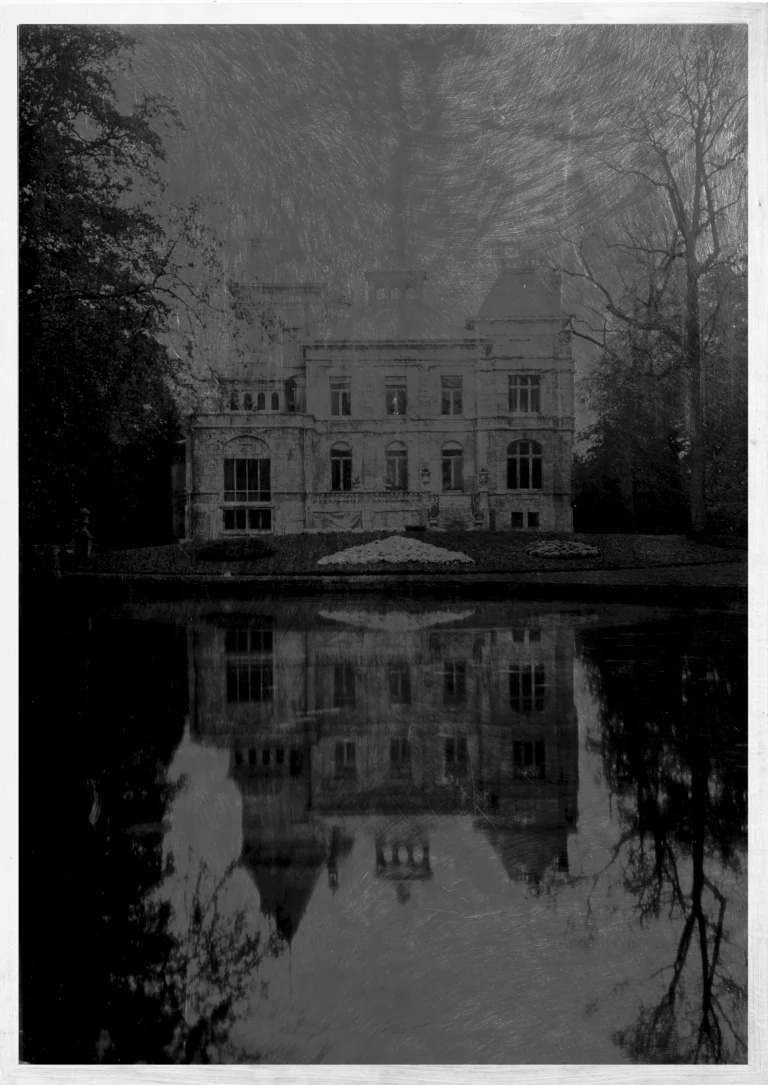1. L’art est comme un exercice spirituel, c’est une pratique destinée à opérer un changement radical de l’être. C’est le leitmotiv des philosophes et, notamment, de Pierre Hadot. Tout véritable artiste tend par son art vers ce but. La réflexion comme manière de vivre. L’artiste Jan Fabre a, tout au long de sa carrière, allié dans ses différentes pratiques artistiques (théâtre, performances, films, chorégraphies, pièces et monologues, objets, sculptures, dessins au bic bleu, installations diverses) cette combinatoire singulière, baroque, hyper symbolique, se rapportant à de nombreuses références de l’Histoire de l’art et, bien sûr, à l’entomologiste français, Jean-Henri Fabre, l’auteur de Le Monde merveilleux des insectes. Jan Fabre en a constitué sa « base » de prolifération, en élaborant dans son œuvre des sculptures avec des scarabées-bijoux, en intervenant sur des insectes, en construisant des nouvelles Vanités, et en réinterprétant à sa manière ce qu’on nomme la Nature morte (Still life).
2. Jan Fabre est aussi un dessinateur insoupçonné dont l’imaginaire nous révèle des images qui permettent de rêver et de penser aux multiples imbrications de sa volonté de dire. Il suffit de voir l’ensemble de son œuvre dessinée depuis une vingtaine d’années, qui fut montrée tout d’abord au SMAK de Gand (2002), puis au Musée d’art contemporain de Lyon en 2004, intitulée « Gaude succurrere vitae », pour s’en rendre compte. On en verra une partie à Avignon cette année. Cette exposition sans chronologie présente une cinquantaine d’œuvres, montrant sa trajectoire multiple des débuts (avec des films-performances) jusqu’à ce jour.
3. Les scarabées occupent une place privilégiée dans le travail plastique de Jan Fabre. Le Mur de la montée des anges est cette fameuse robe conçue entièrement de scarabées, sans tête, tel un mannequin de magasin, présentée toujours suspendue en l’air. Symbole de la métamorphose, du passage de la vie à la mort, mais dans la perspective d’une autre vie. L’artiste a imaginé des cocons, des armures, des têtes, des crânes faits de ces innombrables scarabées. Jan Fabre s’est approprié à sa manière la thématique et la symbolique de la vie des insectes pour engager un dialogue sur la mort. L’artiste met en scène quelques clins d’œil aux œuvres du passé. Il rappelle, à travers ses signes, que toute œuvre d’art possède un sens plus ou moins visible, plus ou moins destiné à être déchiffré par le spectateur ou le lecteur. Les séries initiées par Fabre interviennent comme des phrases, des gestes, des mouvements chorégraphiques : apiculteurs, masse de chair suspendue, armures de guerriers évaporés dans l’espace-temps. Ré-habités par des milliers de scarabées. Puis viennent les objets-insectes qui illustrent son discours : urinoir de Duchamp, la croix, les robes, la bicyclette, toute une imagerie qui met en scène une contradiction : le monde ancien, un certain Moyen Âge, et le nôtre, traversé par les effets du Baroque, à travers les siècles. Tel cet écho de Rimbaud écrivant : « Depuis longtemps je me vantais de posséder tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. (…) Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont on n’a pas de relations, républiques sans histoires, guerres de religion étouffées, révolutions de mœurs, déplacements de races et de continents : je croyais à tous les enchantements. »