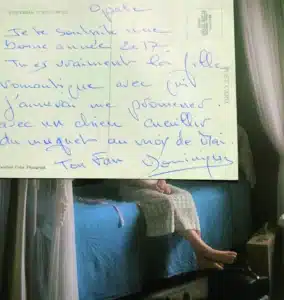ERWIN JANS : Dès votre premier spectacle WHAT THE BODY DOES NOT REMEMBER en 1987, les termes d’énergie physique et de risques physiques ont été associés à votre œuvre. Vous avez vous-même utilisé l’expression « catastrophe imaginaire ». Quelle est la place du risque dans votre œuvre scénique ?
Wim Vandekeybus : Je ne considère pas le risque comme un but en soi. Le risque, c’est avant tout une question d’investissement personnel et de confiance. Quand des danseurs se font confiance mutuellement, ils osent aller beaucoup plus loin dans leur engagement vis-à-vis d’eux-mêmes et vis-à-vis des autres danseurs. Un corps qui danse doit se fier aux corps et aux objets qui l’entourent. Le risque est une notion très relative : ceux qui descendent un escalier quatre à quatre courent parfois plus de risques que mes danseurs. Quand j’ai commencé à réaliser des spectacles au début des années 1980, ce n’est pas la danse qui m’intéressait. J’étais à la recherche d’une « authenticité » dans le mouvement – à l’époque, Jan Fabre était lui aussi préoccupé par la différence entre quelque chose d’«authentique » et quelque chose de « faux », mais c’est surtout l’art de la performance qui l’a inspiré. Le public percevait un danger, un risque dans ces mouvements. La scène où des briques sont lancées dans WHAT THE BODY DOES NOT REMEMBER nous en livre un bon exemple. Dans mon travail, je voulais avant tout revenir aux gestes basiques du corps, au contact physique entre les danseurs, aux réflexes et aux réactions instinctives. Nous vivons dans une société obsédée par la sécurité et le contrôle. Partout nous voyons poindre la menace et le chaos.
E. J.: Est-ce que vous vous en libérez lorsque vous prenez un risque ?
W. V.: Dans le risque, on cherche un rapport à l’autre, à l’incertitude. La notion de risque est sans aucun doute liée à la peur du chaos et de l’incontrôlable. Je m’intéresse moi aussi à la maîtrise, mais j’aime mettre en scène une pagaille : ce moment où l’on perd le contrôle de la situation, où l’on n’a plus une vue d’ensemble. On ne sait plus comment se dépêtrer du chaos. Le risque a aussi à voir avec la liberté : celui qui se sent libre appréhende le risque à un tout autre niveau que celui qui se sent oppressé. Plus on est libre, plus on est capable de prendre des risques, plus on ose en prendre. Le risque n’est pas non plus sans rapport avec l’air du temps : les sports dangereux ont la cote, les gens sont placés dans des situations extrêmes… L’aspiration à la sécurité et la fascination de la peur et du risque sont les deux faces d’un seul et même phénomène.
E. J.: Cela fait près de vingt ans que vous créez. Pensez-vous qu’il soit encore pertinent aujourd’hui d’aborder votre œuvre à partir de la notion de risque ?