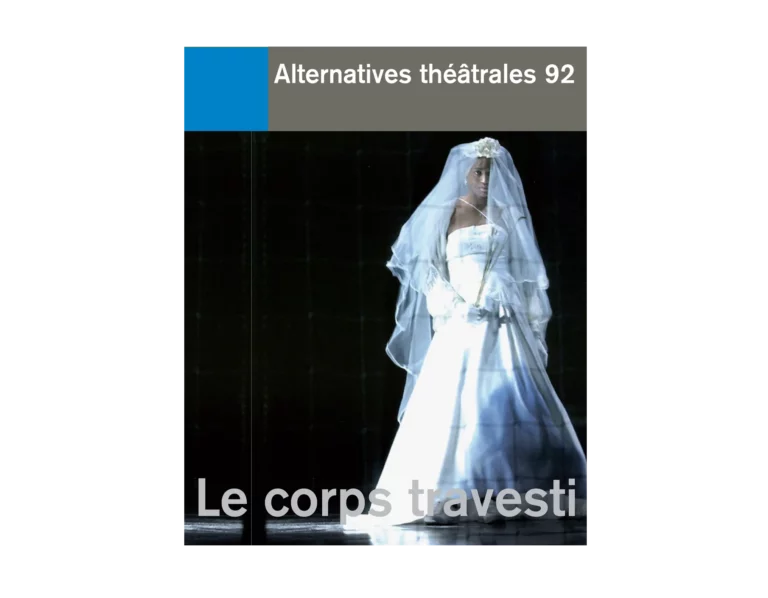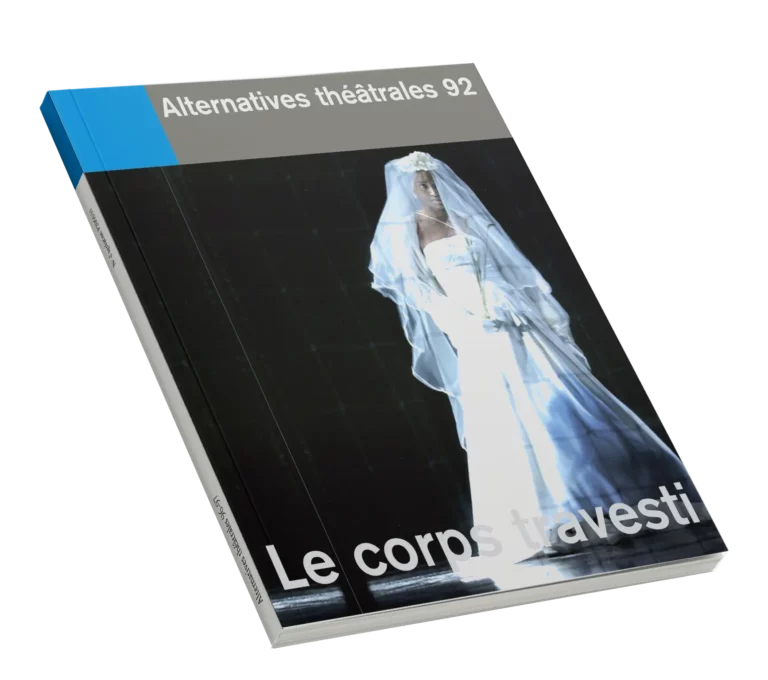ANGELINA BERFORINI : Comment avez-vous accueilli la proposition de jouer un rôle de femme ?
Laurent Poitrenaux : Le texte a été écrit pendant RETOUR DURABLE ET DEFINITIF DE L’ETRE AIME. Il se présentait comme une suite logique, en particulier dans le personnage de la fée. Si Valérie était distribuée dans le rôle de la fée, les deux autres nous étaient logiquement dévolus. Ensuite, en consultant les documents et les photographies, nous avons été frappés par des ressemblances physiques entre nous et Gertrude Stein et Alice Toklas. J’ai accepté la proposition comme un challenge. De plus, ayant déjà réalisé deux spectacles avec Olivier Cadiot et Ludovic Lagarde, je savais que le rapport au réalisme, à la crédibilité, ne seraient pas un vecteur de travail.
A. B.: Quelle différence faites-vous entre challenge et performance ?
L. P.: Dans performance, je mets une notion de caricature, de foldingue ; quelque chose qui aurait à voir avec la manière drolatique dont on montre souvent l’homosexuel en scène. Or, dans FAIRY QUEEN, on est dans l’univers du conte, donc dans l’irréel. Il fallait à la fois éviter le réalisme en caricaturant les personnages qui ont inspiré Olivier Cadiot et ne pas les idéaliser non plus ; être dans le conte, plutôt dans le registre ALICE AU PAYS DES MERVEILLES, Reine de Cœur et Fée Carabosse me semblait être l’endroit juste.
A. B.: Cependant, Gertrude Stein et Alice Toklas avaient ceci de particulier qu’elles étaient probablement lesbiennes. Elles se situaient dans une problématique de confusion dans les genres. C’est troublant, cette distribution.
L. P.: Il y a un système de double signes : des hommes jouent des personnages de femmes qui dans la réalité jouaient à être des hommes ; une femme joue un rôle de fée qui n’est pas un personnage réel. J’ai l’impression que ce système de doubles signes inversés renvoie à plus de vraisemblance. Valérie porte la parole poétique ; nous, hommes jouant des femmes, nous accentuons l’effet de réalité. Je dis bien réalité et pas réalisme Plus il y a d’artifices, plus il y a effet de réel.
A. B.: Comment un acteur travaille-t-il un rôle féminin ? Est-ce qu’on se pose la question ou est-ce qu’on commence à travailler sans y penser ?
L. P.: Avec Ludovic, on s’est posé la question. C’est subtil si on ne veut pas aller vers la caricature. On ne donne que des signes : j’ai joué sur la tessiture de la voix, en partant de temps en temps dans les aigus, sur la musicalité. J’ai souhaité très vite les chaussures. Si je n’avais pas eu les chaussures dès le départ, j’aurais eu la sensation d’être déguisé. Dès que les chaussures à talons ont été là, avec mon jogging, la sensation physique du plateau a changé ; en revanche, la perruque, la robe, les seins n’ont rien modifié. La gestuelle est venue avec les chaussures. Le long travail effectué avec Odile Duboc m’a été très utile, un travail très corporel.
A. B.: L’habit fait le moine, sur scène ?
L. P.: Le costume, ça aide indéniablement. Parfois, au moment où le costume est livré, il contribue à décoincer des situations bloquées dans le jeu.
A. B.: Vous avez chaussé la peau d’une femme ?
L. P.: Je ne suis pas de ceux qui parlent de « la peau du personnage» ; il n’existe pas une armoire où sont accrochées les peaux d’Hamlet. On est dans l’artifice. La peau, c’est le texte. J’ai été confronté à des textes non théâtraux, où « ça œuvre autrement », il faut faire confiance à son art. La langue est importante : la langue anglaise permet de mélanger tous les registres, par exemple passer sans se forcer de la poésie à la trivialité. Avec l’écriture de Cadiot, j’ai découvert le sens de certaines expressions tartes à la crème comme « être ici et maintenant ». Lui il dit : pourcentage de présent = cent. Être le créateur de son propre texte. À nous acteurs, il nous appartient de trouver une autre logique que celle de l’auteur.
A. B.: De quoi est faite cette logique dans le cas présent où, en effet, l’auteur et l’acteur ne coïncident pas à première vue ? Jouer une femme, cela implique-t-il d’aller chercher vers un ailleurs, une autre culture, pour activer son imaginaire ?
L. P.: Il faut être concret, il faut se poser la question comment ça parle plus que comment ça marche. C’est une vigilance permanente ; il faut se contraindre à être dans le texte avant d’inventer l’extérieur. J’ai eu deux inspirations : une tante et une grand-mère, en particulier pour le jeu des mains. À part cela, tout est dans le texte et dans le corps. Il faut donc être au plus près du texte, de ce qui se dit, de ce qui se joue. Je ne voulais pas être ridicule et je voulais respecter les femmes qui ont été réelles avant d’être réinventées par Olivier Cadiot. J’ai voulu faire aussi ce travail de réinvention. Cela a commencé par un travail de déréalisation.
A. B.: Le travestissement en femme, pour un acteur masculin, permet-il une potentialisation de la théâtralité ?
L. P.: De l’illusion que permet de fabriquer le théâtre oui, mais c’est un travail de densité plus que d’accumulation. Il y a beaucoup d’artifices mais dont les ressorts sont à vue, affirmés ; les repères donnés aux spectateurs sont simples, tranquillisants, il y a deux théâtralités qui coexistent : Valérie est dans la modernité et un code irréaliste, nous on est plutôt dans un code classique et réaliste dans le sens où je joue le même code que le spectateur, c’est-à-dire surtout ne pas laisser croire que je suis un homme et vice-versa. Valérie porte une parole poétique, nous, les hommes, nous restons simples, primaires. Dans ce spectacle, on était bien plus dans le concret que dans les deux autres où les codes étaient abstraits, où la technique son et lumière était très complexe et mettait à distance le spectateur.
A. B.: Ce que vous dites est très paradoxal. La multiplicité des artifices crée de la simplicité, du réalisme ou plutôt du vraisemblable. Comme si chaque effet créait l’extrême opposé de ce qui est attendu.
L. P.: Le paradoxe est le sujet même de FAIRY QUEEN. Un artiste du XXIe siècle (la fée) est confronté à une figure des années trente (Gertrude Stein). On parle de modernité alors qu’on est loin de pouvoir faire le compte de ce qui reste du passé dans le présent. Gertrude Stein disait qu’à la moitié du XXe, on avait à peine tué le XIXe. Nous, les acteurs, on devait aussi dire cela et nous sommes porteurs du lien entre ce qui est montré sur scène, ici et maintenant, et les effets de sens a posteriori pour les spectateurs ; nous ne jouons pas ce que nous savons mais avec ce que nous savons et que d’autres spectateurs savent peut-être : que Gertrude Stein et Alice Toklas vivaient ensemble, qu’elles s’habillaient en homme, que Getrude Stein avait un rapport au monde « d’homme à homme », qu’Alice Toklas restait dans un rôle de femme (la maîtresse de maison, les recettes de cuisine). Ce sont des effets de saturation, de densité de signes, qui créent le paradoxe, cette impression de signes qui s’annulent.