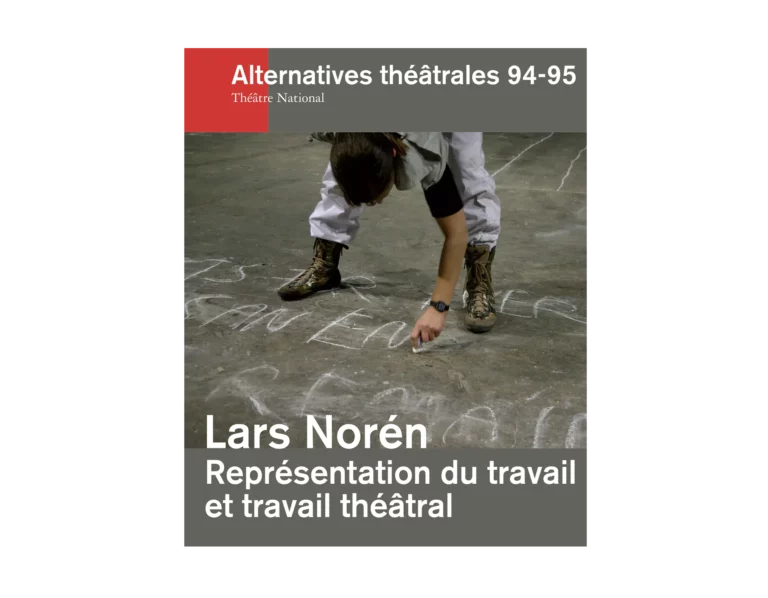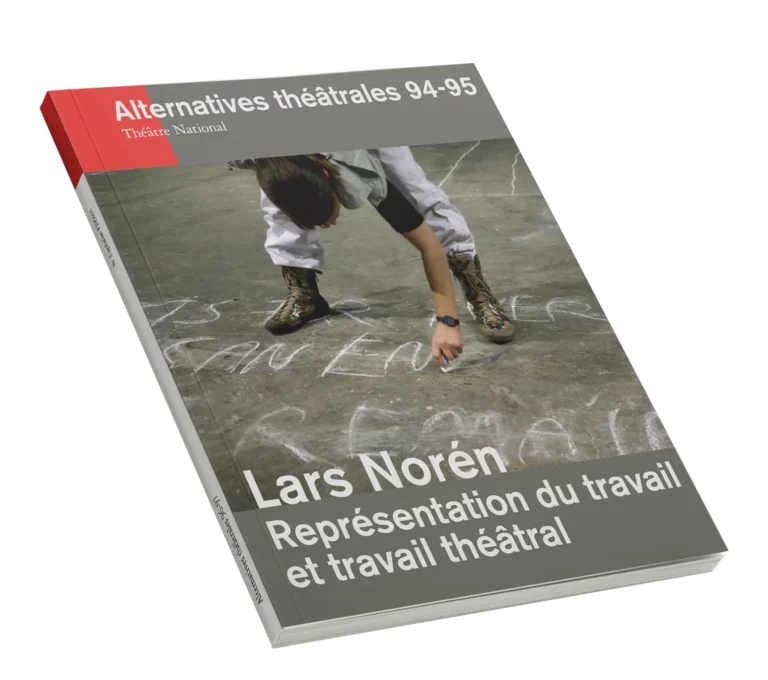Bernard Debroux : Après ces deux premières saisons et à l’aube d’une troisième saison, comment s’organise le travail dans une grande maison de théâtre comme le Théâtre National ?
Jean-Louis Colinet : Je suis aujourd’hui, après deux saisons, confronté à la même question que celle à laquelle j’étais confronté lorsque je suis arrivé, à cette différence que j’ai maintenant deux saisons de pratique de cette maison, de son fonctionnement et de sa relation à la ville et au public.
Cette question fondamentale, et que je me pose du reste de façon incessante, est celle de l’identité. Je pense qu’un théâtre se doit d’être un réel espace – au sens propre comme au figuré – de questionnement, de débat, et donc un lieu porteur de propos. Quand on regarde l’histoire de l’art depuis la plus haute antiquité, cette question du propos a toujours été au centre du rapport entre l’artiste et le public, et cela constitue le cœur même de notre travail. Or, au théâtre, comme dans la vie, du reste, il ne peut exister un réel rapport, une relation forte, en dehors de l’identité, et donc de la conviction. C’est précisément cette confrontation des identités qui génère la ferveur, la richesse, l’intensité d’une rencontre, qu’il s’agisse de celle de deux personnes ou de celle d’un lieu de création avec son public. Je dirais donc au risque d’être un peu schématique, que dans la relation au public, il n’y a pas de ferveur sans identité, pas d’identité sans conviction…
Aussi, mon travail dans ce théâtre s’est organisé autour de cette question du sens, du rapport aux réalités du monde et de notre identité.
B. D.: En parlant d’identité, est-ce que le lien du Théâtre National avec le Festival de Liège – qui s’affirme comme un festival engagé, on pourrait même dire politique – participe à l’identité du Théâtre National ?
J.-L. C.: Non, je ne le crois pas, ou en tout cas pas directement. Ce sont deux structures distinctes qui ont un point commun, c’est qu’elles ont le même directeur… Mais les pratiques d’un théâtre et d’un festival restent sensiblement différentes. En revanche, le fait que je dirige l’un et l’autre crée inévitablement une jonction entre elles dans la mesure où c’est une même sensibilité qui anime ces deux aventures. Ainsi, la question de l’identité que je viens d’évoquer, celle de la conviction comme élément fondateur, restent au centre de ma démarche, qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre de ces maisons.
Il m’apparaît que, dans la recherche du lien avec le public, par volonté ou par nécessité ou – pire encore – par obligation, on est souvent tenté d’agir en fonction de l’image que l’on se fait des attentes de celui-ci.
Je veux dire en cela que, fréquemment, on est tenté d’établir des programmations qui concilient à la fois ses propres convictions et ce que l’on suppose des attentes du public. On ne peut pas complètement éluder cette question, mais en même temps c’est un piège absolu, parce qu’essayer cette conciliation, c’est évidemment aussi se perdre.
Cependant, on réduit souvent la question du rapport au public à cette opposition entre la détestable course à l’audience, le clientélisme, et le droit – absolument légitime, du reste – de l’artiste à s’exprimer. Ce faisant, on élude, par le caractère binaire de cette équation,
un troisième élément, celui qui réside précisément dans l’intensité, la force du lien qu’un public, une ville, peut entretenir avec des œuvres et des artistes. Or, j’estime que c’est là que la notion d’aventure artistique peut prendre son magnifique et véritable sens. Quand on essaie d’être ce que l’on croit que l’autre attend de soi, on n’est fatalement plus soi-même et il n’y a dès lors plus guère de vraie relation possible. Dans un rapport, lorsqu’on ignore qui est l’autre, ou que l’on n’est pas soi-même, rien n’advient, hormis l’ennui. Cette question détermine à la fois le type de rapport que nous entretenons avec la démarche artistique, mais aussi le travail que nous développons à l’égard de notre ancrage dans la ville, vis-à-vis du public, et des autres institutions.
D’une façon plus pragmatique, mon souhait est de faire de ce lieu nouveau, qui constitue un outil théâtral exceptionnel, un lieu de vie, c’est-à-dire un espace qui ne soit pas figé dans un rôle unique, exclusivement dévolu à la représentation théâtrale. Un lieu qui, à partir de la dynamique créée par la représentation du théâtre, s’ancre dans la ville, s’ouvre aux réalités qui nous entourent. Un lieu qui se nourrisse d’une modernité véritable, c’est-à-dire de la sensibilité des artistes et des réalités du monde d’aujourd’hui, un lieu où toujours quelque chose se passe, un endroit où se développe un commentaire de la création proprement dite.
Quand j’examine nos programmations, je vois en fait assez nettement la différence entre les spectacles qui créent un réel courant, une authentique dynamique de pensée et de débat, une relation vive avec le public, et les spectacles qui sont seulement reçus – plus ou
moins bien – comme des spectacles, des moments que l’on a, dans le meilleur des cas, agréablement passés.
Une programmation, ce n’est pas une suite chronologique de titres plus ou moins bien agencés. C’est un propos, une adresse au public, un point de vue.
Yannic Mancel : Est-ce que tu as le sentiment de faire évoluer les missions initiales du Théâtre National de cette façon, dans quel sens et au prix de quel débat, par rapport aux tutelles notamment ?
J.-L. C.: Quand j’ai proposé mon projet pour le National, il ne m’a pas été formulé de cadre de mission préalable, ce qui pouvait sous-entendre que tout était possible… Je pense que tous ceux qui ont remis un projet l’ont fait en fonction de leur propre conception des missions du Théâtre National. En l’absence de tout cadre objectif, cela reste donc exclusivement une question de choix. C’est d’ailleurs ce projet qui a servi de base au texte du contrat qui nous lie au ministère de la Culture.
Il me paraît utile à cet égard de préciser un point, c’est celui de la singularité du statut de ce théâtre : à la différence d’autres pays, et même de la Flandre, le paysage théâtral belge francophone est particulier en ce sens qu’il n’existe ici qu’un seul théâtre qui possède l’appellation de « théâtre national ». Ainsi, c’est le seul qui soit correctement doté… Il en résulte donc une sorte de structure pyramidale institutionnelle. En Flandre, par exemple, trois théâtres possèdent ce statut : le KVS (Théâtre Royal Flamand), NT Gent (Théâtre National de Gand) et le Toneelhuis d’Anvers. Ce qui modifie considérablement les choses.
B. D.: Le Toneelhuis s’appelait auparavant le Koninklijke Nationale Schouwbourg (KNS)…
J.-L. C.: Absolument. Mais cette unicité de statut dans laquelle nous nous trouvons, génère en réalité, dans le tissu théâtral qui nous entoure, et de façon légitime, espoirs et ressentiments. Ce n’est donc pas seulement une maison à qui l’on donne les moyens de développer sa propre aventure artistique : ce caractère « unique » lui confère également de façon non explicite un statut particulier, qui s’apparente à une sorte de « ministère du théâtre », lequel se devrait, par exemple, de résoudre la question cruciale des très jeunes créateurs, mais aussi des vieux, d’être un lieu de recherche, d’expression des démarches les plus pointues, mais dans le même temps un grand théâtre populaire, parcourant le répertoire classique, remplissant pendant de longs mois notre grande salle et assurant des tournées dans des lieux prestigieux d’Europe, tout en étant intensément présent dans les lieux les plus modestes de la Belgique profonde…
Ce statut renforce malheureusement aussi cette notion d’institution, qui est également accentuée par l’état de pauvreté dans lequel se trouve le tissu théâtral belge francophone. Ici, dans ce théâtre, il faudrait tout faire parce qu’il y a plus d’argent qu’ailleurs. Le problème, ce n’est pas que nous ayons beaucoup d’argent, mais bien qu’il n’y en a pas assez ailleurs.
Y. M.: Le répertoire et le patrimoine ?
J.-L. C.: Oui… C’est pourquoi, quand il a fallu formuler un projet pour cette maison, face à cette conscience que j’avais de la cristallisation d’une série d’attentes contradictoires à son égard, je me suis dis que le pire serait d’essayer d’y répondre. Pour moi, l’essentiel a donc été de procéder de façon résolue à partir de mes propres choix. Ce théâtre – fut-il « National » – n’est pas une institution. Une institution, c’est un ministère, un service public. On observe là un glissement sémantique qui veut que les théâtres (un peu) plus correctement dotés soient assimilés à des institutions.
Je l’ai dit, ce que ce Théâtre National se doit d’être, c’est un lieu à l’identité forte et claire, doté d’une âme et porteur de convictions, générateur d’une aventure artistique, ce qui implique nécessairement des choix. Nous ne faisons donc pas « un peu de tout », nous opérons des choix. Nous travaillons avec la notion noble d’un théâtre de service public, mais cela ne nous identifie en rien à un service public. Je n’ai pas vraiment, en Belgique francophone, d’alter ego, alors qu’entre mon ami Jan Goossens du KVS et Guy Cassiers d’Anvers ou Johan Simons de Gand, il existe une réelle altérité, comme il peut en exister en France entre des centres dramatiques ou des théâtres nationaux.
B. D.: Pour terminer avec la question du public : son information, sa sensibilisation par rapport notamment à l’envahissement médiatique, reste une question centrale pour le théâtre, l’art et la création en général. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour tisser cette relation avec le public ?
J.-L. C.: Cela reste de fait une question primordiale. Mais en préambule, je souhaiterais dire à ce propos qu’à mon sens, démocratiser le théâtre, c’est bien entendu développer des dispositifs qui facilitent son accès auprès d’un large public, mais c’est aussi et surtout générer auprès de ce public un véritable désir de théâtre. C’est une question qu’une certaine classe politique élude souvent : elle demande : « faites-vous une promotion active de votre travail, pratiquez-vous des prix abordables, des formules d’abonnement engageantes, des horaires adéquats ? etc. » Toutes choses, qui, à l’évidence, sont pratiquées par la quasi-totalité des théâtres. Elle pense que la dimension quantitative doit prévaloir. Ce faisant, elle ignore la dimension qualitative, qui est évidemment tout aussi importante. Elle nous demande : « faites-vous des programmations alléchantes ? », mais elle ne nous pose pas la question du type de rapport que celles-ci peuvent générer avec le public. Tout comme elle ne se pose pas non plus la question de quel type de public fréquente ce théâtre.
Par parenthèse, je crois que ce débat en France va se poser de façon de plus en plus cruciale…
Plus concrètement, nous pratiquons des prix très accessibles, mais je ne crois pas que l’élargissement quantitatif du public soit exclusivement lié à des dispositifs de « marketing », comme, par exemple, les prix des places ou des questions d’horaires… Au Théâtre National, le prix des places les moins chères est de 7,5 euros. Cela les rend donc accessibles à un très large public.
Le problème – non pas seulement du théâtre mais aussi de la culture en général – n’est pas tant le prix, le problème c’est le désir que le public en a réellement. Même si cela était gratuit, ceux que le théâtre laissent indifférents ne s’y rendraient pas. Ainsi, générer le désir du théâtre, ça dépasse l’information et la promotion.
C’est un travail fondamental que nous menons au quotidien, notamment avec le monde associatif, ainsi qu’avec, bien sûr, le monde de l’éducation, de l’école.
Un troisième volet sur lequel on devrait pouvoir travailler mais qui malheureusement reste souvent – et scandaleusement – une porte close, ce sont les médias. Non tant dans une optique de promotion, mais dans une optique de sensibilisation. Les deux lieux vitaux pour générer
ce désir de théâtre sont effectivement, selon moi, l’école et les médias.
Dans le lien au public il y a aussi un autre aspect qui est pour nous important, c’est celui de notre ancrage dans la ville. Ce lieu doit pour moi être un concept en soi, il doit parler comme parle une pièce. Il doit être porteur d’un propos politique, d’un univers poétique, ludique. J’œuvre petit à petit pour qu’il en soit ainsi, par les nombreuses activités que nous y développons parallèlement à la création, mais aussi par la façon même de le penser, d’en concevoir son aspect, son organisation spatiale. Ce lien avec la ville, c’est aussi le lien qu’on entretient avec la spécificité de cette ville ; je travaille beaucoup sur l’élargissement social du public, l’élargissement communautaire au travers de notre travail avec nos amis flamands du KVS. Je suis arrivé ici, venant de Liège, une ville dans laquelle les problèmes linguistiques sont peu présents ; j ai très vite affirmé une volonté de collaboration forte avec la dynamique théâtrale développée par le KVS. Ce travail n’a pu se développer que parce qu’il y avait des affinités de personnes, de sensibilités, des accointances idéologiques entre Jan Goossens et moi-même. L’ancrage dans la ville participe de la « modernité » du lieu ; un lieu est actuel s’il est un lieu de vie dans la ville, intimement lié aux problématiques auxquelles elle est confrontée. Par exemple, outre l’intense collaboration entre nos deux théâtres (six spectacles communs dont une création cette saison), nous allons développer avec le KVS, ainsi qu’avec le Morgen et Le Soir, deux grands quotidiens, toute une thématique de débats publics et bilingues et de réflexion sur cette question de la ville.
Nancy Delhalle : Quand on regarde l’histoire du Théâtre National, on constate effectivement que la rupture est très marquée. Dans les années cinquante, c’était effectivement une mission de type politique et idéologique d’amener un plus large public au théâtre, et cela correspondait à une manière de faire une programmation qui évitait les choix trop marqués, trop extrêmes. On a l’impression qu’il y a une sorte de déplacement, et qu’on a un peu une conception brechtienne d’élargir le cercle des initiés qui vient se substituer à cette idée qui s’est épuisée d’un Théâtre National qui correspondait tout à fait à un contexte social et politique des années cinquante. On peut se demander si l’idée même d’un Théâtre National aujourd’hui est encore valide, et si l’enjeu n’est pas plutôt international ?
J.-L. C.: Je n’ai pas bien connu l’expérience de Jacques Huysman, fondateur de ce théâtre, issue de l’aventure des « comédiens routiers » à laquelle il appartenait. Ce que je sais c’est que c’est l’État qui a choisi cette compagnie théâtrale pour lui donner le statut de Théâtre National. Il n’y a donc pas eu un « appel à candidats ».
N. D.: Mais les missions étaient définies…
J.-L. C.: Oui, sans doute, mais ce que je veux dire, c’est que l’on n’a pas créé d’abord une enveloppe, défini un concept et des missions, pour ensuite opérer un choix. Ce que je retiens de l’aventure de Huysman, c’est qu’elle correspondait fort à ses options personnelles, à une aventure artistique précise : Huysman a fait tout sauf du consensuel, il a amené des auteurs qui, à l’époque, n’étaient absolument pas connus et qui ont choqué les sensibilités, et il l’a fait à un moment où le statut du théâtre dans la société était complètement différent d’aujourd’hui. Ce n’était pas un espace marginal, mais un espace public, très fréquenté, ce que permettait le statut qu’avait le théâtre à l’époque. L’action de Huysman a été très polémique, la question de l’identité a toujours été fort importante chez lui, on lui a même reproché une trop grande identification entre l’homme et « son théâtre ». Il n’y a donc pas, selon moi, de glissement,
il y a des aventures différentes, des choix distincts qui se profilent selon les moments. Je crois que la pire des choses pour cette maison serait qu’elle se dise un jour qu’elle doit devenir le lieu de la diversité, de la multiplicité des sensibilités théâtrales. Ce serait effectivement la perte du sens, de l’identité.
Y. M.: Parle-nous de tes choix. Comment identifies-tu cette identité, cette identité plurielle, puisque tu associes à ta démarche des artistes très différents les uns des autres mais qui développent des lignes très engagées ? Comment s’est fait le choix, ce compagnonnage ?
J.-L. C.: L’identité artistique du Théâtre National aujourd’hui repose essentiellement sur le compagnonnage avec cinq artistes (quatre metteurs en scène et une chorégraphe): Jacques Delcuvellerie, Isabelle Pousseur, Ingrid von Wantoch Rekowski, Philippe Sireuil et Michèle Noiret. Le choix des quatre premiers faisait partie dès le départ de mon projet, lequel faisait reposer l’essentiel de nos créations sur le travail des artistes associés et d’entretenir avec eux une dynamique particulière. C’est un mélange de choix subjectifs et de choix objectifs. Subjectifs parce que je les ai choisis en fonction de ma sensibilité, mais objectif parce qu’ils m’apparaissent comme des personnalités qui, chacune dans leur démarche spécifique, ont atteint un réel degré de maîtrise et d’aboutissement de leur propre langage.
Y. M.: Tout en étant encore dans une dynamique de recherche…
J.-L. C.: Absolument. Je voulais travailler avec ceux dont la démarche m’apparaissait comme la plus aboutie. Aujourd’hui, on peut apprécier ou pas ce que nous faisons, mais le niveau artistique de notre travail me semble incontestable. Cela étant, il est vrai qu’une réelle complicité me lie de longue date à Jacques Delcuvellerie, qui m’apparaît comme l’une des personnalités artistiques les plus marquantes et les plus intéressantes du paysage théâtral européen. C’est, du reste, un compagnon de très longue date. Nous nous sommes rencontrés à l’INSAS en 1969, et il m’a accompagné au Théâtre de la Place dès 1988, théâtre dans lequel il a créé la quasi-totalité de ses spectacles… Son travail, son regard, occupent une place centrale dans notre démarche, depuis longtemps. C’est une complicité certes complexe, mais toujours
riche et productive.
L’âme de ce théâtre est donc liée pour moi à la personnalité et au travail de ces cinq artistes. Mais dans le même temps, un théâtre ne peut pas être un endroit clos. L’ouverture à d’autres créateurs est également nécessaire.
Ainsi, parallèlement à ces artistes associés, j’ai établi des liens de fidélité avec d’autres metteurs en scène, belges et étrangers. Ces metteurs en scène invités ont comme point commun leur volonté d’explorer un théâtre singulier, loin des modes et résolument engagé, ancré dans les réalités du monde.
Le métissage des pratiques me semble essentiel, surtout par ces temps sombres de repli sur soi que nous traversons. Dans cette Belgique multiculturelle, c’est un aspect auquel notre public est particulièrement sensible. J’ai donc créé de vrais compagnonnages avec des artistes venus d’ailleurs, de vraies rencontres de pratiques théâtrales. Ainsi, par exemple, Lars Norén, avec lequel je collabore depuis 2001 au Festival de Liège, répète pour l’instant dans ce théâtre sa dernière pièce avec des artistes belges, français et suédois. Il a par ailleurs écrit et mis en scène en février dernier au Festival de Liège Le 20 novembre, un monologue joué par Anne Tismer
– que nous tournons en français et en allemand. Je trouve très important que des artistes d’ici soient confrontés avec des pratiques autres, des sensibilités et des cultures différentes, et que des artistes d’ailleurs soient aussi confrontés avec nos démarches, nos sensibilités et nos artistes. Ce métissage est pour moi très important, c’est une véritable nourriture que nous allons largement développer à l’avenir.
Dans cette même optique de fidélité, nous développons une relation particulière et élaborons des projets avec ds artistes dont nous nous sentons proches, tels Jeanne Dandoy, Françoise Bloch, David Strosberg, Patrick Bebi, Jean-Benoît Ugeux, pour ce qui concerne les Belges, mais aussi avec Lars Norén, Joël Pommerat, Falk Richter, Ascanio Celestini, Emma Dante… Un important partenariat fondé sur le lien entre pédagogie et pratique professionnelle se construit avec Théâtre et Publics, une stucture liée à l’École d’Acteurs du Conservatoire de Liège. Cependant, ce qui s’est passé durant ces deux saisons appelle à un nécessaire questionnement sur la façon de faire évoluer ce projet initial. Comment créer cette identité forte à travers la multiplicité des sensibilités ? C’est une dynamique fragile, inconstante, difficile à mettre en œuvre, mais qui reste passionnante. J’observe que pour les metteurs
en scène associés, le fait de travailler régulièrement dans la même maison, de se rencontrer pour discuter des rapports entre l’artiste et l’institution, pour évaluer le travail mené, crée entre eux une curiosité, une ouverture à l’autre, un lien particulier.
Cette question du rapport entre l’artiste et l’institution est, à mes yeux, absolument fondamentale.
J’ai mené à l’interne un travail important pour que l’entièreté de l’équipe soutienne réellement la démarche de ces artistes, ce qui a évidemment impliqué dans cette maison qui n’avait jamais connu ce processus, une réforme de ses modes de fonctionnement à bien des égards, une modification des mentalités. Mais les résultats sont très positifs, même s’il reste du travail
en certains domaines…! Peu à peu, nous instaurons une réelle proximité entre ces artistes et l’équipe, une souplesse des pratiques, chose rendue nécessaire par la diversité des méthodes et des réalités très différentes qu’ils vivent. Il est important que les artistes sentent cette maison comme s’ils l’habitaient, y retrouvent leurs habitudes personnelles.
Mais ce rapport ne peut être univoque. Cette fidélité, cette proximité, impliquent une dynamique qui fonctionne dans les deux sens : quelle peut être la contribution de l’artiste à cette aventure ? On n’en parle sans doute plus rarement parce que l’artiste est légitimement plus « en besoin » que la structure elle-même. En revanche, c’est une question qu’on ne
peut éluder.
En ce qui concerne plus globalement la politique artistique de ce Théâtre National, mon intention est de faire évoluer notre pratique future. Je le disais tout à l’heure, je considère qu’une saison, c’est un propos, un ensemble duquel un sens se dégage.
J’observe que les programmations relèvent souvent de l’addition d’une série de titres dont le choix correspond lui-même à des opportunités diverses, souvent à des hasards. Pour ma part, je souhaite désormais procéder différemment.
Nous allons travailler chaque saison principalement sur base d’une série de « segments thématiques » établis autour des spectacles des artistes associés et invités.
Ces spectacles seront entourés, accompagnés, commentés par une multitude de propositions artistiques pluridisciplinaires, telles le cinéma, les arts visuels, les rencontres, les lectures, la publication des moments de fête, etc.
L’objectif de cette démarche est de faire de ce Théâtre National un lieu vivant de singularité, de créer un véritable espace de débat, d’occuper un fragment de la vie publique au sein de cette ville à travers des problématiques fortes et actuelles. C’est également de modifier réellement le rapport que le spectateur entretient avec les spectacles, de nourrir cette relation, de l’enrichir,
de lui conférer plus de sens, plus de singularité, d’en accroître le parfum de découverte. De faire en sorte que le spectateur ne vienne plus seulement acheter un ticket pour assister à un spectacle, mais prenne part à un processus plus large, plus complet, que son regard soit
nourri, qu’un sens soit conféré à sa présence.
Ainsi, par exemple, nous avons commencé cette saison 07 – 08 par un thème intitulé « Au travail ! ».
À partir des spectacles Les Marchands de Joël Pommerat et Appunti per un film sulla lotta di
classe (Notes pour un film sur la lutte des classes) d’Ascanio Celestini, spectacles qui ont été entourés de lectures, de rencontres, de films, d’une expo, qui ont généré une véritable dynamique de réflexion et de débat.
B. D.: Nous aurons dans le numéro un dossier important sur Lars Norén, et j’aimerais connaître ton regard sur l’homme et son œuvre ?
J.-L. C.: Il s’agit pour moi d’une des rencontres les plus fortes que j’ai faites sur le plan artistique et personnel. Quand je m’interroge à ce propos, je pense que dans la vie, plus on retrouve une part de soi dans l’autre et plus on se sent proche de lui. L’altérité est vraiment une chose complexe ; chercher dans la vie autre chose
que soi-même est difficile, c’est pourquoi je crois qu’il
est plus facile de donner que de recevoir. Donner est
un acte délibéré, et on peut donner à n’importe qui, n’importe quoi, n’importe quand et n’importe comment. En revanche, recevoir – apprécier ce que l’on reçoit –
est un acte qui implique paradoxalement la plus grande ouverture, une réelle disponibilité. La rencontre avec l’autre est souvent fort empreinte de ce désir de se retrouver à travers tout ce que l’on rencontre, qu’il s’agisse d’hommes, d’animaux, de paysages. Je me suis donc senti intuitivement proche de cet homme – pas de son immense talent, entendons-nous bien ! –, et j’ai découvert la personne autant que son travail, ce qui est indissociable pour moi.
À mes yeux, le terme de compagnonnage implique précisément une fidélité : on n’est pas dans une démarche rassurante de production de réussites mais dans la confiance envers quelqu’un à travers ses réussites et ses échecs, d’accompagnement modeste de sa démarche.
Ce n’est pas simple.
Lars Norén est un immense artiste, mais aussi un homme généreux, attentif, ouvert aux autres. J’avais entendu parler de ce qui lui était advenu lorsqu’il avait fait ce spectacle dans une prison, il y a sept ans, avec trois détenus et un comédien professionnel. Je lui ai alors téléphoné, il m’a proposé de venir chez lui et nous avons parlé très longuement. Ce fut notre première rencontre. Je crois que l’œuvre de cet homme est très intimement liée à sa vie, pas nécessairement de façon autobiographique. Je suis particulièrement touché par le regard qu’il pose sur la vie, sur ce qu’il cherche, ce qui le fascine, ce qui lui fait peur, son rapport au monde et aux êtres. Je l’ai vu rencontrer des artistes avec lesquels il allait travailler et s’intéresser à leur vie, non pas comme un psychanalyste mais simplement parce qu’il rencontrait des personnes et que cela l’intéressait d’un peu mieux les connaître. Quand il va quelque part il s’intéresse énormément à ce qui l’entoure, la ville, les gens, les bâtiments, les habitudes, même si on ne l’imagine souvent pas comme ça parce que son théâtre est en général plutôt sombre. Sur le plateau, il est intéressé par les mêmes choses que lorsqu’il écrit, et cela se sent.
Il n’est pas dans l’image ni la démonstration, c’est toujours extrêmement humble et donc fort, puissant, précis, au scalpel. C’est un travail chirurgical.
Y. M.: Pour moi, il y a deux catégories de pièces chez Norén : il y a les pièces intimes, un peu comme de la musique de chambre, qui sont effectivement plus sombres, et il y a les pièces chorales, dans lesquelles je trouve beaucoup d’allégresse, comme Catégorie 3.1 et Kliniken. Il y a là une pulsion de vie chorale et collective très forte qui pulvérise l’obscurité. As-tu une préférence entre ces deux tentations d’écriture ?
J.-L. C.: Je trouve que tu as tout à fait raison sur cette pulsion de vie. Je trouve que souvent, dans les mises en scènes de Norén, on monte l’idée que l’on a de Norén plutôt que la pièce elle-même, et c’est en général assez oppressant. Et pourtant, je trouve comme toi qu’il y a dans ce théâtre plein de pulsion de vie et surtout une profonde humanité. C’est un théâtre qui est plein de compassion et de fraternité, et peut-être encore plus dans les pièces chorales. J’ai vu trois versions de Catégorie 3.1, la sienne, celle d’Ostermeier et celle de Martinelli. J’y ai trouvé une dimension à la fois lyrique et de profonde humanité. Les spectacles qu’il a créés avec nous se situent effectivement plutôt du côté de pièces plus « politiques », que de celles qu’il appelle ses « drames bourgeois ». En fait je ne suis pas sûr qu’il y ait une réelle différence entre ces deux univers. C’est le même regard qu’il pose sur des gens différents. On le dit régulièrement héritier de Strindberg, mais lui, en fait, se sent plus proche de Ibsen, même s’il le prend comme un compliment!…
B. D.: Pour en revenir à quelque chose de plus anecdotique, y a‑t-il vraiment beaucoup de Flamands qui viennent au National, et beaucoup de Francophones qui vont au KVS ?
J.-L. C.: Pendant « Toernee General », le Festival que nous organisons annuellement avec nos amis flamands du KVS, les publics se mélangent réellement, parce qu’on se trouve dans le cadre d’une manifestation, d’un évènement qui a vraiment pour objectif de créer ce métissage entre les deux communautés linguistiques. Durant la saison, c’est un processus qui s’installe peu à peu, mais de façon tangible.
Cette collaboration, cette relation forte qui existe entre nos deux théâtres est souvent citée en exemple par la presse francophone et néerlandophone (surtout en ces temps de tensions politiques aiguës entre les deux communautés…) et chaleureusement saluée par nos publics. En revanche, elle ne correspond en rien à un acte de militantisme communautaire ni à un vieux réflexe « belgicain ». Une fois encore, rien que de la conviction…