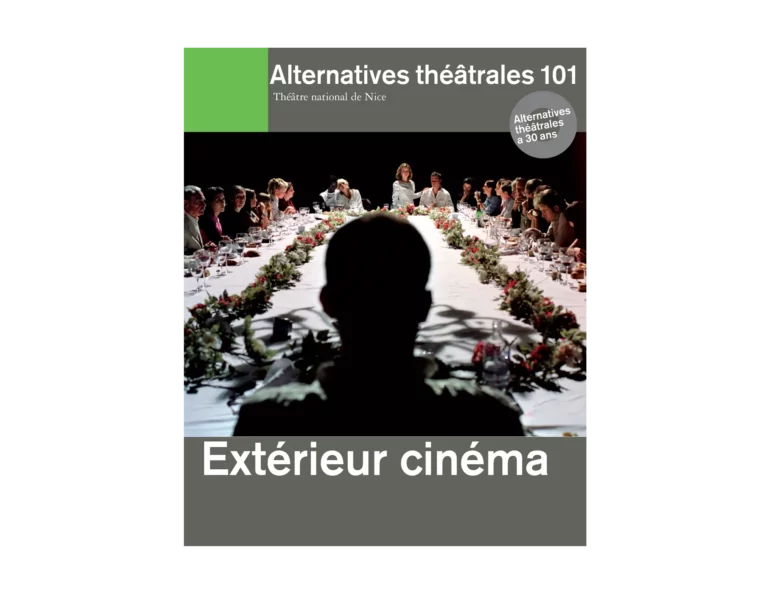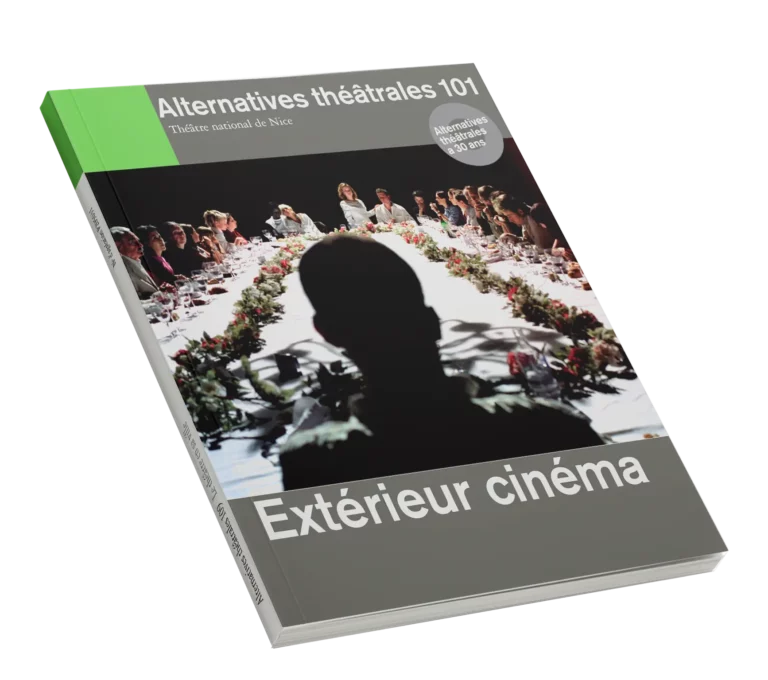Bernard Debroux : Comment as-tu découvert le film Grow or go et qu’est-ce qui t’a décidé à en faire une adaptation au théâtre ?
Françoise Bloch : Grâce à Unter Eis de Falk Richter. La matière de cette pièce est puisée dans le film documentaire Grow or go de Marc Bauder.
La décision d’en faire un spectacle vient, pour moi, dans la continuité d’une préoccupation pédagogique. J’ai commencé, il y a quelques années, à l’école d’acteurs de Liège, à travailler sur base de documentaires. Il s’agissait uniquement de films de Raymond Depardon.
Je n’étais plus d’accord avec le rapport que les jeunes acteurs dans les écoles entretenaient avec le réel, avec le type d’attention qu’ils lui consacraient, plus pressés d’imiter un film, la télévision ou un autre acteur (à un extrême du champs) ou d’être naturels (à l’autre extrême du champs) que d’imiter, de capturer, de rendre compte, avec leur moyen à eux, du réel. Comment, avec un regard aussi peu attentif, aussi peu désirant, aussi superficiel sur la réalité, un acteur-artiste pouvait-il avoir, au sens premier du terme, une « vision du monde » ? Dans le meilleur des cas, on avait affaire à un rapport de l’ordre de la prédation : prendre des morceaux appauvris du réel pour parfaire un « moi en scène ». D’où l’envie de créer un outil pédagogique qui redonne du goût pour le réel.
J’ai cherché des documentaires qui ne posent pas un regard dominateur sur les êtres. Il devait seulement être question d’attention, de qualité du regard. C’est pour cela que j’ai choisi Depardon. Sa position, son attitude pouvait être un modèle pour les élèves acteurs. J’ai entamé avec eux, à partir des films, un travail très minutieux d’imitation. Lorsqu’on l’observe finement dans tous ses détails, la réalité est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche que ce qu’en rendent habituellement les acteurs sur scène. Il y a dans cette attitude une mine d’or, tant au niveau des formes qu’au niveau des contenus. Si on prend, par exemple, le registre des voix, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe, plus diversifiée que ce qu’en donnent les acteurs sur scène, de même pour les gestes dits parasites, et tout est à l’avenant. Un rapport différent à un réel différent produit une théâtralité singulière et un autre type de rapport avec les êtres dont on témoigne. Un rapport à la fois plus proche, plus empathique donc, mais aussi plus attentif, ce qui suppose une certaine distance. Cet espace de jeu m’a semblé très précieux.
J’avais envie de continuer à l’explorer.
Par ailleurs, je trouvais qu’il y avait urgence à parler aujourd’hui des élites politiques et (ou) économiques.
Unter Eis m’a donné l’idée et le matériau nécessaire au sujet. Jean-Benoît Ugeux a écrit ensuite à Marc Bauder, nous avons reçu le film et je l’ai visionné. Tant du point de vue du sujet que du point de vue de la démarche théâtrale, il répondait à ce que j’avais envie de faire. Le film était également porteur d’une réflexion sur le rapport au travail, sur l’envahissement du champs privé ou intime par le travail. C’est un sujet qui me passionne et que j’avais déjà abordé lorsque j’avais monté « La demande d’emploi » de Michel Vinaver.
B. D. : Le spectacle a un rapport très direct avec le film. Comment as-tu fait le travail de transcription au théâtre, du « scénario » du film ?
F. B. : Cela s’est fait de façon très empirique. J’ai commencé par extraire certaines scènes qui me semblaient fondamentales au niveau du contenu et potentiellement porteuses d’une théâtralité.
À partir d’un petit pré montage, j’ai ajouté d’autres séquences. J’avais cette idée aussi que je voulais m’éloigner progressivement du documentaire et j’ai finalement construit de façon très expérimentale ce qui est là pour l’instant et qui n’est encore qu’une étape de travail.
B. D. : Vas-tu rajouter d’autres éléments ou vas-tu rester fidèle au contenu général et aux portraits des différents protagonistes ? Par exemple la séquence du film entre la mère et la fille est très présente dans la version actuelle et c’est un élément très important du film.
F. B. : Oui, c’était une des premières scènes choisies ; c’est la scène liminaire du documentaire et du spectacle. C’est de là que tout part, de l’éducation. Toutefois, dans mon travail, il y a aussi des éléments extérieurs qui ne sont pas directement issus du documentaire, notamment, à la fin, les images vidéo qui mettent les scènes issues du documentaire en perspective. Il s’agit d’une tentative de confronter le monde des consultants, sujet central du film et du spectacle, au monde extérieur. J’essaie toutefois, dans toute la mesure du possible, de ne pas rajouter trop.
B. D. : C’est peut-être la différence avec Unter Eis où les consultants sont présentés comme vivant dans une bulle complètement fermée. Toi, tu apportes des éléments qui viennent de l’extérieur.
F. B. : Je suis plus proche du scénario de Bauder que Unter Eis ne l’est. La théâtralité chez Falk Richter est dans l’écriture, il a construit à partir du film un tout nouveau scénario.