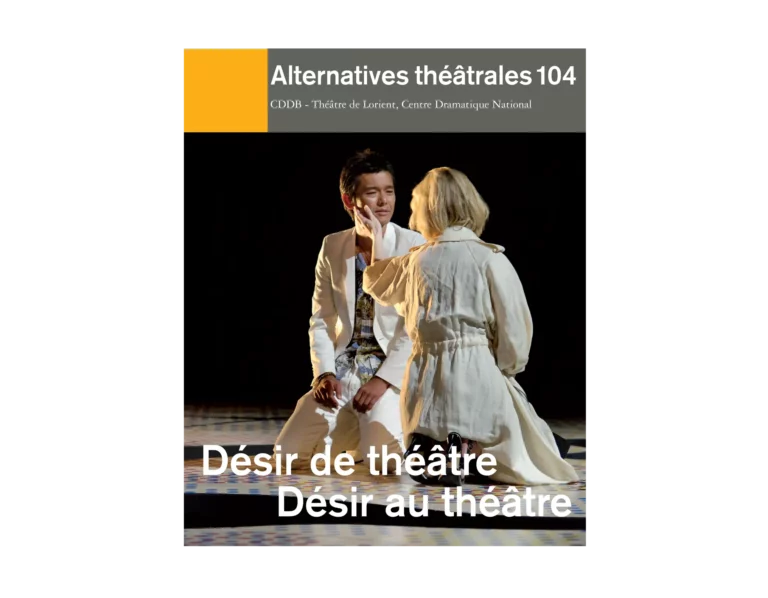QUELQUES NOTIONS, essentielles à la définition de l’humanité de l’homme peuvent rendre sourd et muet, à moins de se livrer à la longue patience philosophique. Cela veut dire qu’à moins d’élaborer des concepts et des hypothèses, de les confronter à l’observation et à l’expérience, d’en construire et d’en éprouver la raison et la logique, on ne peut rien dire, et difficilement entendre. À celui qui voudrait se dispenser, ou ne pas se contenter de cet exercice, il faut un bien particulier langage des signes pour saisir ce qui laisse sans voix.
Le théâtre pourrait être ce langage, cet art qui s’adresse précisément au sourd-muet que je puis être. On objectera que c’est un art de la parole, qu’on ne cesse d’y débattre et d’y argumenter. Oui, bien sûr, mais on répondra qu’il est depuis longtemps défini comme « action », que ça dure, et que c’est sans doute pour cela qu’il s’exerce depuis si longtemps dans nos contrées.
S’il y a une « action » représentée, c’est que quelque chose échappe au domaine strict de la parole, qui ne lui est pas réductible, qui se loge dans son défaut, s’adjoint à sa limite. Le théâtre comme « action » est réflexion de ce que la langue ne satisfait pas. Cela ne veut pas dire que les acteurs sont des animaux : leur langage silencieux, leur être pantomimique suppose la parole. Il faut la parole en tant qu’elle ne suffit pas pour qu’existe le langage silencieux de l’action. Il n’y a que l’animal parlant, soit l’homme, qui peut se taire.
Lacan dit, et tout un chacun peut l’éprouver, que « le désir, fonction centrale à toute l’expérience humaine, est désir de rien de nommable »1. Si le théâtre, comme la cure analytique d’où le psychanalyste tire cette leçon, est une pratique qui tourne autour du pas nommable, alors il se pourrait bien que, dans ses machineries, il ait rapport au désir. Et que, peut-être, sans que l’on y prenne garde et qu’on ne l’envisage pas suffisamment selon cette perspective, il ne parle que de cela.
Pour le démontrer, prenons une pièce au hasard, ou presque, L’ÉVENTAIL de Carlo Goldoni. La pièce est écrite à Paris à la fin de sa vie, et à l’intention d’un théâtre vénitien, elle est créée en 1765, ne connaît pas un grand succès, et passe quelquefois pour un simple exercice de virtuosité. Or la pièce est un des chef‑d’œuvre de Goldoni, pour cette raison précisément. Dans une lettre au marquis Albergati Capacelli de Bologne, il écrit : « Je pense maintenant à un nouveau genre de comédie pour voir si de ces acteurs, je réussis à tirer quelque chose de bon. Ils n’apprennent pas les scènes écrites, ils ne jouent pas les scènes à canevas quand elles sont longues, alors j’ai fait une comédie aux scènes nombreuses, brèves, piquantes, animées d’une action incessante et d’un mouvement continuel afin que les comédiens n’aient rien d’autre à faire qu’à donner vie à des actions plus qu’à des mots »2.
Voilà, les mots ne sont là que comme éléments d’une action, agents d’une force plus que d’un signe, ils sont là pour accélérer, pas pour nommer. On ne s’étonnera donc pas qu’elle mette en jeu « rien de nommable », autant dire le désir.
Une jeune fille, nommée Candida, aimée d’un Evaristo, laisse tomber du balcon son éventail qui se brise. L’amant n’a alors de cesse que de vouloir le remplacer, mais il faut toute la longueur de la pièce, et d’odysséennes péripéties, avant qu’il ne revienne en ses mains initiales. Il est confié, transmis, volé, acheté, repris, caché, donné, et passe entre les mains d’à peu près tous les personnages de la pièce. Or, il se trouve qu’à un moment, l’amant irrité de tant de malentendus à propos de cet éventail qui a joué la fille de l’air, malentendus qui risquent de lui faire perdre l’objet de son amour, casse le morceau, explique à Candida que c’est elle qu’il aime, que les tribulations de l’éventail ne sont pas de son fait, et qu’il peuvent donc s’aimer tranquillement. Il est convaincant, Candida accepte ses explications, mais elle met une condition « à l’accomplissement de (son) bonheur »3, qu’il lui remette l’éventail qu’il n’a pas. L’amour est avoué, entier, réciproque, mais il est sous la tension d’un désir prédominant, obtenir l’éventail.
Ce n’est pas grand-chose qu’un éventail, du vent, et il faut sans doute qu’il en soit ainsi : si le désir est « désir de rien de nommable », alors il n’y a que presque rien qui puisse le représenter. Dans le film d’Éric Rohmer, LE GENOU DE CLAIRE, le personnage joué par Jean-Claude Brialy confie à son amie Aurora que, à l’apparition d’une jeune fille prénommée Claire, il a été saisi d’un immédiat et intense désir, mais un désir « de rien ». Séduire et posséder la jeune fille serait alors inutile, car inadéquat. Quoique ce soit elle qui le suscite, l’objet de son désir n’est pas Claire. Alors il faut bien lui donner un nom pour machiner une action qui donnera consistance au désir, un geste vicaire de l’innomé. Le nom est « genou », et l’action consistera à le toucher sans susciter rebuffade ni toute autre conséquence. Éventail et genou sont les prête-noms de ce qui n’a pas de nom.
Dans L’ÉVENTAIL, Evaristo est un amant parfait : il connaît la différence entre l’amour et le désir, et il évalue parfaitement la valeur de ce pas grand-chose d’éventail : « Il ne vaut rien, mais pour moi, il est sans prix »4. L’amour se monnaye, pas le désir ; l’amour est une histoire, le désir un destin. À la fin de la pièce de Bernard-Marie Koltès, DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON5, les deux protagonistes sont sur le point de s’étreindre dans un combat, et ceci, après un long échange ouvert par un des plus beaux débuts de la littérature dramatique : « Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c’est que vous désirez quelque chose que vous n’avez pas…».
Que ce soit dans la comédie, la tragédie ou le drame, la mort n’est jamais loin des trames du désir. Même la plus banale des civilités le dit : « Voici l’homme qui meurt du désir de vous voir »6. Quand Evaristo se présente sans l’éventail devant Candida, elle s’évanouit. Puis, lorsque Candida le lui réclame en vain, c’est à son tour de défaillir, et il faut un vin à « ressusciter les morts » pour le ranimer. C’est pourquoi, quand a été éprouvé ce que l’éventail met en jeu, l’objet est rendu à sa nature de chose, et il disparaît sous ses effets : « Quelle drôle de chose, cet éventail ! Il nous a tous fait tourner la tête du premier au dernier ». L’innomé fait également retour, et Candida, ayant retrouvé son éventail, déclare « Je ne saurais exprimer l’excès de mon contentement ». Ce qui veut dire, bien sûr, qu’elle est satisfaite, mais aussi que l’objet de son contentement n’a pas de nom.
- Jacques Lacan, LE SÉMINAIRE, LIVRE II, LE MOI DANS LA THÉORIE DE FREUD ET DANS LA TECHNIQUE PSYCHANALYTIQUE, Éditions du Seuil, Paris, 1978, p. 261, 262. ↩︎
- Cité par Ginette Herry dans son introduction à la pièce. Dans Carlo Goldoni, LES ANNÉES FRANÇAISES, introduction, traduction et notes de Ginette Herry, volume III, Imprimerie nationale éditions, collection « Le Spectateur français », Paris, 1993, p. 108. Les citations de la pièce sont tirées de cette édition. ↩︎
- III, 6, p. 225. ↩︎
- III, 10, p. 243. ↩︎
- Les éditions de Minuit, Paris, 1986. ↩︎
- Molière, LES FEMMES SAVANTES, III, 3. ↩︎