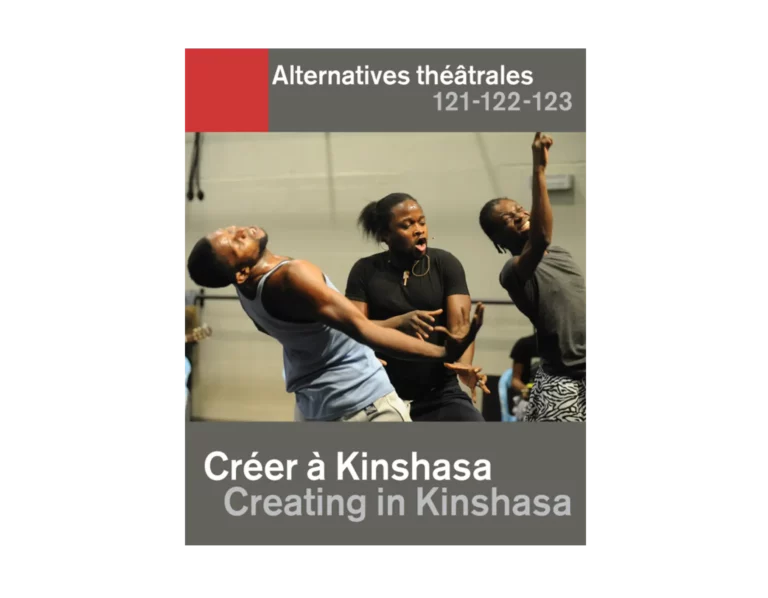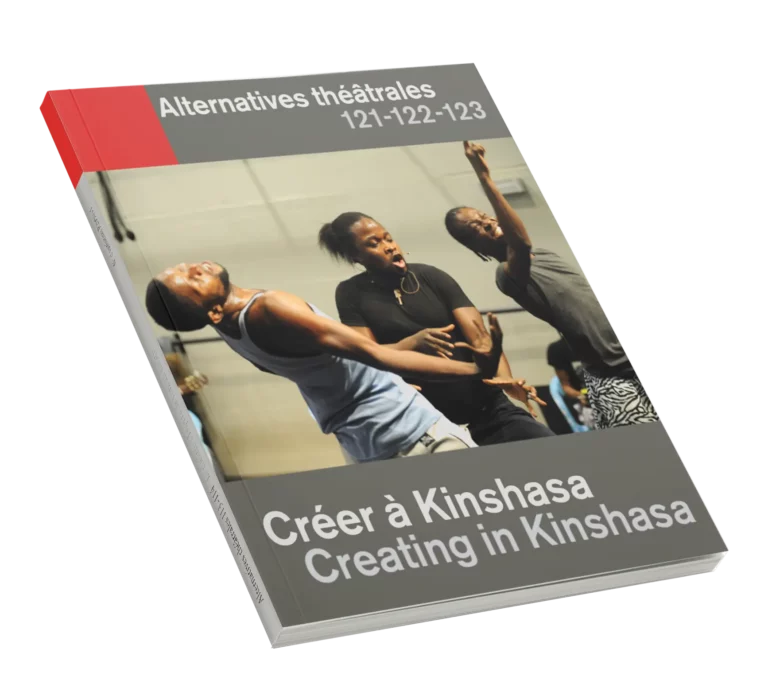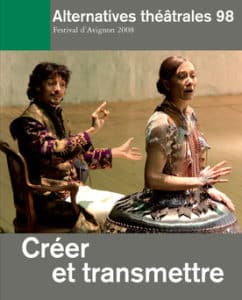Bernard Debroux : Comment est venue cette vocation qui t’a conduite à exercer ce métier d’artiste, de chanteuse, de musicienne ?
Maryse Ngalula : Normalement, je ne devais pas être musicienne. Je suis née dans une famille très traditionnelle et intellectuelle. Mon père est prof de mathématiques et physique. Il enseigne à l’université. Ma mère est enseignante. Pourtant, si je me trouve aujourd’hui à faire de la musique, de la guitare et du chant, c’est grâce à eux. Ils étaient chanteurs, choristes à l’église catholique. Mon père chantait les chœurs latins. Ma mère, les chants protestants. Chaque soir, à la maison, on se rassemblait et on chantait. Mon père jouait de la guitare. Il a joué avec un des grands guitaristes congolais, Nico Kasanda. On l’appelait Docteur Nico. Ils ont étudié et joué ensemble mais mon père a arrêté pour faire des études.
Je suis la huitième de la famille sur douze. Enfant, j’ai aussi beaucoup écouté mes aînés qui jouaient. Le frère qui vient juste avant moi m’a vraiment poussée à m’exercer à la guitare. Ensuite, j’ai commencé à composer. À l’âge de quinze ans, j’ai commencé à l’accompagner dans des concerts. Il était soliste et guitariste. Mon père ne voyait pas ça d’un bon œil, il disait que c’était un travail de voyous ! J’ai donc poursuivi et terminé mes études secondaires et passé mon bac. En 1998, un ami me propose de participer à une émission pour la télé. Le directeur du centre culturel français de l’époque m’a vue et m’a invitée à participer à un festival, sorte de concours pour jeunes talents.
B. D. : Où se déroulait ce festival ?
M. N. : À Kinshasa. Tout s’est passé à Kinshasa. C’est de là que tout est parti. C’est Kinshasa qui m’a influencée, cette vie particulière de la société kinoise. Je ne me rappelle pas avoir pris une décision du genre « aujourd’hui, je commence ». Tout s’est mis en place progressivement. On me disait que ce que je faisais était intéressant, on m’encourageait. J’ai commencé à jouer à Kinshasa, à donner des concerts : au Centre Wallonie- Bruxelles, au centre culturel français. Je le faisais surtout pour le plaisir de jouer avec mes amis.
En 2001, j’ai reçu une invitation pour aller au Sénégal, au festival Banlieue Rythme, à Guédiawaye. Ensuite, ce fut Bangui, en République Centrafricaine. Puis, l’Association Française d’Action Artistique (AFAA, l’ancêtre de Culture France) m’a proposé de faire une démo, une maquette de mon travail. C’est grâce à Culture France que je suis partie en Afrique du Sud en 2002.
Là, j’ai commencé à jouer avec des artistes sud africains. On est allé à Soweto, travailler avec des enfants et des jeunes gens. En même temps, j’ai poursuivi des études.
B. D. : Des études musicales ?
M. N. : Non, j’ai étudié la sociologie à Soweto (j’habitais Johannesburg) et spécialement la « résolution de conflits ». On y enseignait la non-violence.
B. D. : Les cours se donnaient en anglais ?
M. N. : Oui, je commence à parler parfaitement l’anglais et influence même mon usage du français. J’étais très engagée dans ce travail auprès des jeunes enfants où je donnais des cours de résolution des conflits.
B. D. : Comment faisiez-vous pour leur enseigner la non violence ?
M. N. : J’allais parler avec des jeunes, je leur expliquais la notion de non-violence. Ils vivaient encore dans le souvenir de l’apartheid. J’utilisais le support musical, je jouais de la guitare, je pouvais parler facilement. Les gens écoutaient…
J’ai reçu le prix « Découverte Francophonie 2004 » en Afrique du Sud. En même temps, j’ai trouvé un producteur sud africain qui m’a proposé d’enregistrer dans son studio. À la même époque, j’ai rencontré l’association de jeunes King Luthuli Transformation Center, qui travaillait dans la philosophie de Martin Luther King. C’est comme ça que je suis restée en Afrique du Sud de 2002 à 2010.
Et puis finalement, j’ai décidé de rentrer à Kinshasa. B. D. : Pourquoi ?