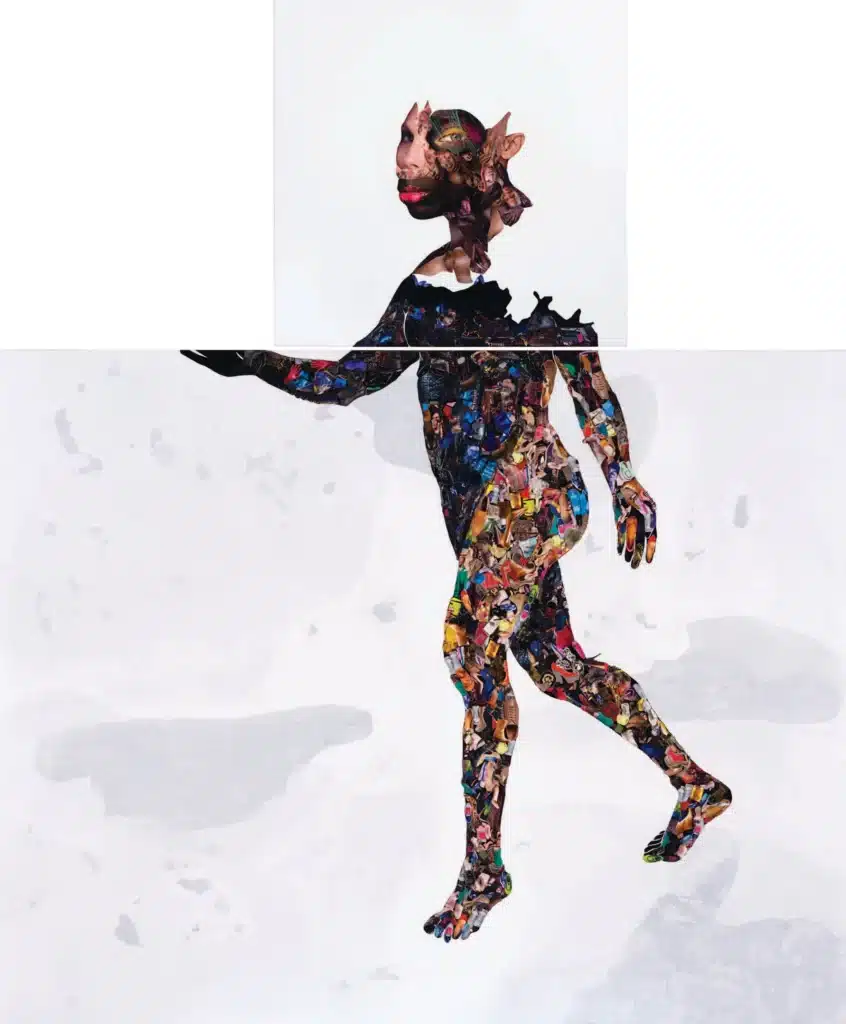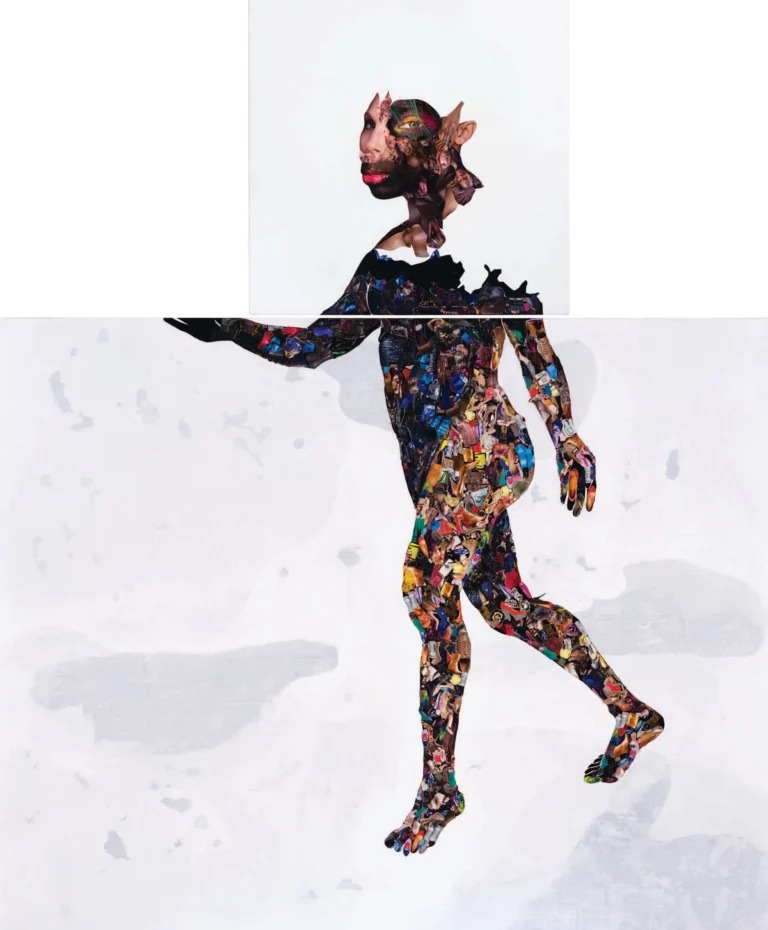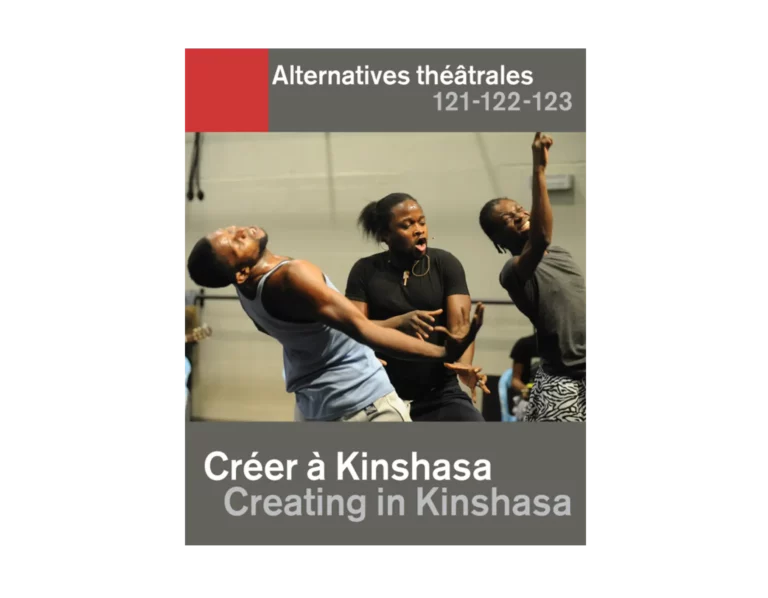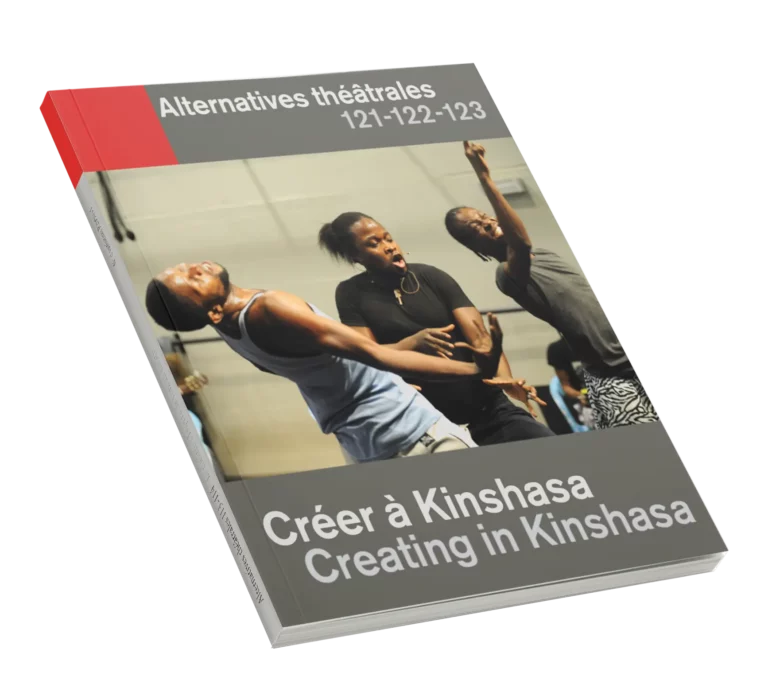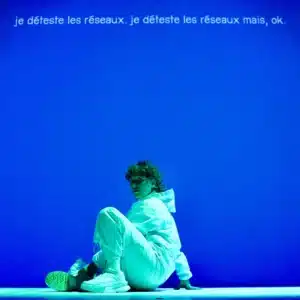Bernard Debroux : Peux-tu me raconter ton parcours artistique ? Comment est né ta vocation et quelle formation as-tu suivie ?
Vitshois Mwilambwe Bondo : Dès l’âge de sept, huit ans j’étais attiré par l’art, la sculpture et le dessin. Je faisais beaucoup de dessin à l’époque. Mes professeurs m’encourageaient dans cette voie. Je faisais aussi du modelage, des sculptures avec l’argile, de la céramique. J’avais un frère qui étudiait les humanités artistiques qui se dédiait à l’Académie des Beaux-Arts. Je lui dérobais les dessins qu’il faisait à l’école, je m’en inspirais. Quand il a découvert cela il ne s’est pas fâché, il était très étonné, il trouvait qu’il y avait quelque chose d’intéressant. Il m’a encouragé, épaulé. Moi je ne faisais que dessiner, dès que j’avais du temps, pendant les récréations à l’école, tout le temps. C’était moi qu’on appelait quand il fallait dessiner quelque chose au tableau, par exemple. À douze ans j’ai demandé à mon père de pouvoir suivre l’Institut des Beaux-Arts pour avoir un Bac en arts plastiques puis continuer à l’Académie des Beaux-Arts. Au départ j’avais envie de faire du cinéma, mais il n’y a pas d’école de cinéma ici à Kinshasa. Donc j’ai étudié six ans à l’Institut des Beaux-Arts, les arts plastiques, la peinture, l’histoire de l’Art, l’esthétique, la musicologie et d’autres disciplines liées au cinéma.
Après cela, je me suis inscrit à l’Académie, et j’ai fait de la peinture pendant quatre ans. À la fin j’ai reçu une bourse, je suis allé étudié à l’École de Strasbourg. Avant de partir j’ai rencontré quelques artistes qui venaient en résidence à l’Institut français. À l’époque, le directeur Jean-Michel Champault invitait régulièrement des artistes. C’est en discutant avec eux que j’ai découvert l’art contemporain. Surtout grâce à un artiste camerounais, Pascal Marthine Tayou qui était envoyé à Kinshasa par Tomas Muteba Luntumbue. On a créé un collectif autour du concept du « librisme », dans cette lignée de l’art contemporain, conceptuel, des performances, des installations. C’est là que j’ai appris à faire de l’art autrement, en prenant mes distances par rapport à mes études qui avaient été très classiques. On a travaillé pendant une semaine ; je me suis posé beaucoup de questions, sur ma personnalité d’artiste, ma ville, les réalités qui m’entourent… Mon travail a évolué aussi, il a pris une autre forme. Je faisais des petites expositions ici à Kinshasa et j’ai eu ma première exposition hors Congo, à Cape Town et à Bruxelles. Après le départ de Tayou, j’ai monté un collectif avec quelques amis dont Wantina qui vit maintenant en France. On a développé un travail très différent, avec des installations, des performances, des vidéos. En 2003 je suis allé pour une année académique à Strasbourg, continuer mes études. Mais là, à chaque fois que je faisais quelque chose on me rappelait que j’étais Africain et que je devais donc faire un art « africain ». Moi j’avais déjà l’esprit ouvert, des connaissances sur l’art contemporain, je n’étais pas comme certains jeunes Africains qui débarquent en Europe. Il y a eu des discussions, des vrais débats avec
des professeurs. Je leur parlais de l’Afrique d’aujourd’hui, pas de celle du siècle dernier. L’Afrique d’aujourd’hui est confrontée à la nouvelle technologie, à toutes les nouvelles réalités, et je voulais confronter mon travail à cela. Ensuite j’ai eu envie de suivre une formation à la Rijksakademie à Amsterdam. Mes professeurs de Strasbourg ne croyaient pas que je pouvais y être sélectionné. Moi je le voulais coûte que coûte. J’ai beaucoup travaillé, préparé mon portfolio, mes projets, etc. J’ai fait des expositions en France et en Belgique et dans d’autres pays d’Afrique, des résidences en Afrique du Sud, à Maputo. En 2007 je suis allé à la Rijksakademie après le Festival Yambi, Congo-Wallonie-Bruxelles, organisé par la Belgique. Là, j’ai rencontré beaucoup d’artistes qui vivaient en Belgique et qui venaient de partout dans le monde. Les deux années à la Rijksakademie furent très intéressantes pour moi. J’ai rencontré beaucoup de curateurs de musées, comme ceux de New York, Philadelphie, Los Angeles, Hong Kong, des artistes, des théoriciens de l’art… Il y a eu de vraies discussions et échanges qui m’ont aidé à construire mon travail différemment et à avoir une vision. Après cela, j’ai trouvé une galerie à Bruxelles, la Nomade Art Gallery qui a exposé mon travail pendant au moins trois ans. Ensuite les portes se sont vraiment ouvertes. Un journaliste critique d’art, Roger Pierre Turine m’a beaucoup aidé aussi. Tout cela m’a permis d’avoir un carnet d’adresses. Après j’ai exposé à New York, j’ai eu un grand prix à la Skope Art Fair en 2012. J’ai été à Bâle, j’ai trouvé une galerie à Milan et j’ai commencé à circuler aux quatre coins du monde.
B. D. : Comment es-tu arrivé à développer ce travail d’ateliers, de formations et surtout d’implantation dans ce centre culturel ici à Kinshasa. Peux-tu nous raconter son histoire ?
V. M. B. : Ça fait presque huit ans que je pensais à cela. Surtout en 2005, quand j’étais invité aux Benin pour faire des performances. En résidence d’un mois, j’y ai rencontré certains artistes qui venaient d’autres pays d’Afrique, d’Europe, du Brésil et des Caraïbes. Nous avons travaillé ensemble et j’ai eu envie de faire ce genre de résidences aussi à Kinshasa. Mais le moment n’était pas encore venu parce que je devais avoir plus d’expérience et bien comprendre comment mettre tout cela en place. En janvier 2010, après mon séjour à la Rijksakademie, je me suis vraiment décidé à prendre ce projet à bras-le-corps. J’ai pris contact avec certains artistes que je trouvais intéressants, certains qui étaient avec moi à la Rijksakademie d’Amsterdam, d’autres qui étaient passé par là… J’ai commencé par louer un espace et j’y ai invité des artistes de Kinshasa à venir passer des résidences de deux à trois mois. Je finançais moi-même par la vente de mes œuvres en Europe. Le premier que j’ai invité a été un artiste allemand avec qui je travaillais depuis 2005.
B. D. : Dans quel espace était-ce ?
V. M. B. : Un lieu juste à côté de celui où on est maintenant. Il y avait des chambres et des ateliers.
B. D. : Pourquoi le choix de ce quartier de Kinsuka en particulier ?
V. M. B. : D’abord, parce que c’est un quartier calme et que ça ne coûtait pas cher. Puis, parce que toutes les offres culturelles sont très centralisées à Kinshasa. Je voulais aussi échanger avec cette population défavorisée et construire quelque chose de très contemporain, en lien avec le quartier. Pour que les artistes puissent interroger et rencontrer les habitants et se rendre compte des réalités sur place, à Kinsuka.