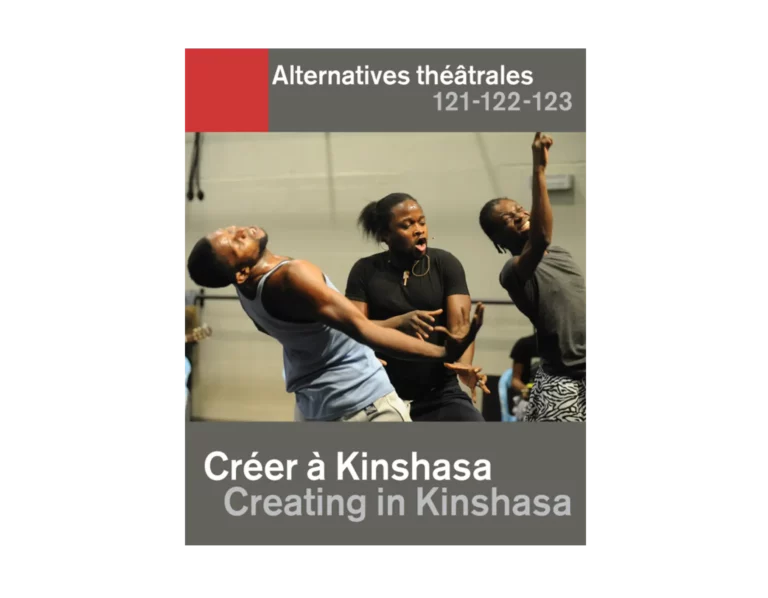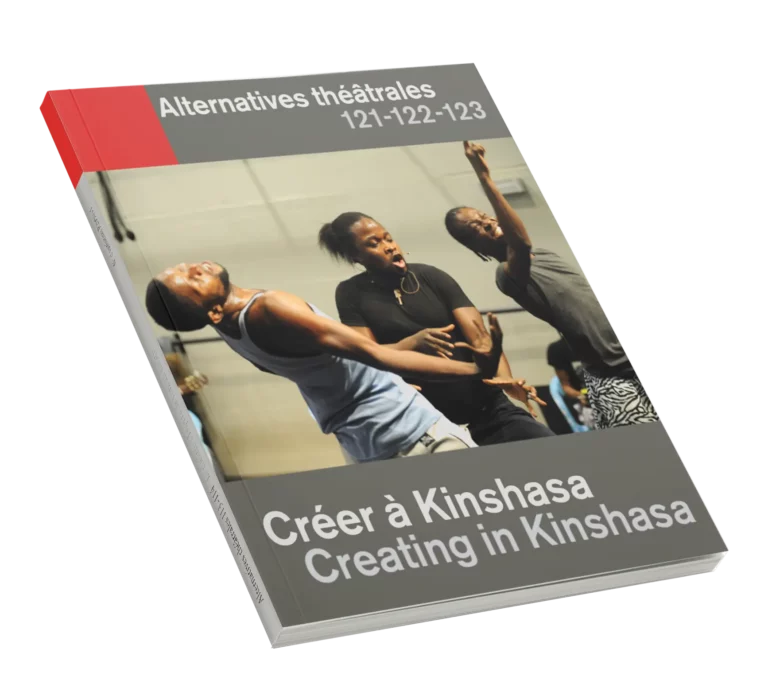Bernard Debroux : Comment êtes-vous arrivé au théâtre, quel a été votre parcours dans ce métier et que faites- vous aujourd’hui à Kinshasa ?
Nzey Van Musala : Lorsque j’ai commencé mes études, toutes les bonnes écoles avaient une troupe de théâtre. Les enfants apprenaient ainsi plus facilement à s’exprimer en français, à maîtriser le français ; le théâtre le plus dynamique était le théâtre scolaire. Et tout jeune,
j’ai été séduit par cet art et je n’ai plus jamais quitté la scène jusqu’à faire du théâtre mon métier. Je suis metteur en scène, comédien, professeur de théâtre (je suis à la tête du département de mise en scène à l’INA/Kinshasa, l’Institut National des Arts). J’ai écrit
de nombreuses pièces que j’ai moi-même mises en scène. Un de mes derniers textes, Zérocrate, a été publié récemment. Comme metteur en scène, j’ai travaillé des auteurs de différents horizons notamment des auteurs francophones de Belgique, parce que nous collaborons étroitement avec le Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. J’ai ainsi abordé des auteurs comme Charles Bertin (Christophe Colomb), Michel de Ghelderode (Le mystère de la passion), Fernand Crommelynck dont le texte, Tripes d’or, a été adapté par le professeur Yoka Lye, Jean-Marie Piemme (Toréadors) que j’ai rencontré et qui est devenu un ami, tout comme Eric Durnez (Cabaret du bout du monde). C’est sans doute Toréadors qui a eu le plus beau, le plus long parcours et j’ai reçu, pour cette pièce, les plus belles critiques. À Paris, après une ou deux représentations, la critique du Nouvel Observateur disait quelque chose comme : « Jean-Marie Piemme a l’habitude de se plaindre des comédiens qui ne font pas assez d’efforts avec ses textes et des metteurs en scène qui les montent avec les pieds, mais il a enfin trouvé en Nzey Van Musala un exégète à la hauteur de son talent. » Alors ça, vous savez, ça fait plaisir.
À Kin, je dirige une importante compagnie théâtrale, la Compagnie Marabout Théâtre. C’est une troupe avec laquelle on travaille beaucoup sur le rapport entre scène et public. Celui-ci est amené à participer, à jouer un rôle actif, mais sans qu’il ne sente qu’on le sollicite pour cela. Le public européen est souvent plus passif, il ne s’exprime qu’à la fin, avec ses applaudissements et les acteurs se rendent compte à ce moment-là seulement que les gens qui étaient dans la salle ont suivi et apprécié. Chez nous, on « accompagne » la pièce. Mais c’est vrai qu’avec Toréadors ou Cabaret du bout du monde, pour une fois, j’ai senti qu’il y avait dans les salles en Europe presque les mêmes réactions qu’on avait eues à Kinshasa. Ce fut un très grand plaisir pour moi, parce que ça voulait dire que quelque chose avait vraiment fonctionné. Comme à Kinshasa, comme à Brazzaville, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, et dans d’autres pays, on avait eu les mêmes sensations. En tant que metteur en scène, j’aime les textes qui me résistent, qui me donnent du travail. Par exemple Toréadors. La pièce est singulière : ce sont deux personnages, Momo et Ferdinand, qui s’envoient des tirades. Mais si le metteur en scène se laisse prendre par les belles phrases et les mots savoureux, peut-être qu’il va passer à côté de l’essentiel, tout cet univers que chaque mot transporte. Pour mettre en scène Toréadors, j’ai ressenti le besoin d’ajouter un musicien, d’avoir une sorte de griot moderne. Nous avons repris le texte, en le retravaillant avec ce musicien mais surtout par rapport au contexte congolais, très simplement. Lorsqu’à un moment donné les acteurs parlent de papiers, le musicien récupère la situation et vous savez, en Belgique comme au Congo, les papiers ça vous poursuit partout, ça vous enquiquine, ça vous embête.
Lorsque je prends un texte de Jean-Marie Piemme, ou d’un autre auteur, d’où qu’il vienne, je travaille d’abord en fonction de mon public à moi. Je ne peux pas dénaturer l’œuvre de l’auteur, mais il y a parfois des ingrédients nécessaires pour essayer d’atteindre mon public. Parce que je pense que si on ne peut même pas s’essayer à cet exercice-là, jongler avec les mots et les situations, ça sert à quoi le théâtre ? Donc je travaille sur ce genre de choses, à fabriquer un bon spectacle pour mon public avec des mots des autres auxquels je donne parfois quelques coups de pied. Je dois toujours lire, relire, tourner, retourner, contourner même le texte.
Les personnages aussi, je les étudie, je les remodèle s’il le faut, je les apprivoise. Ce que certains metteurs en scène ne font pas. Dans Toréadors, par exemple, on sait que Ferdinand
vient de la rue, que c’est une espèce de SDF, que c’est un étranger. « Étranger », pour nous, c’est une notion compliquée. En Belgique, c’est plein d’étrangers, mais chez nous, les étrangers sont rares. En temps normal, on est là avec nos frères africains et on ne voit arriver
les étrangers qu’en temps de guerre ou de troubles. On s’en méfie un peu, on ne les distingue pas bien les uns des autres (casques bleus, assistance médicale, caritative, droits de l’homme, journalistes… tout une faune ravageuse!). Sans que les Congolais soient racistes, la notion d’étranger a, on le voit, une importance toute particulière chez nous, elle peut avoir un sens particulier. Et dans un spectacle comme Toréadors, il y avait quelque chose à dire à ce sujet, et avec ça la pièce prend du relief. Autre exemple : le traitement du mot « fonctionnaire » dans la même pièce. Ce mot a souvent un sens péjoratif, chez nous comme en Europe. Et dans la pièce, le musicien joue avec ce mot, le déconstruit (fonction – nerfs). C’est comme ça qu’on essaie de pénétrer au cœur du texte et le public ne reste pas insensible à cela, comme ce jeune français, fils de fonctionnaire, ému aux larmes au Théâtre Varia à Bruxelles de constater qu’ailleurs le fonctionnaire était aussi chosifié, persifflé.
À Kinshasa, le théâtre est mon activité principale. J’enseigne, je forme des gens pour le théâtre. À l’INA, bien sûr, mais au-delà, à la compagnie Marabout Théâtre et aussi avec un autre groupe qui s’appelle Studio Mille Acteurs où je reçois des gens (surtout des jeunes) qui veulent se former aux métiers du théâtre.
Avant tout, le théâtre, c’est ma « meilleure distraction ». Je suis un homme heureux parce que j’ai fait de ma « meilleure distraction » ma profession. Je plaisante souvent en disant que ma capacité de travail est de 27 heures sur 24, parce que je ne suis jamais fatigué quand c’est pour le théâtre que je travaille. Pour moi c’est comme si je parlais avec des amis, comme si j’étais en famille.
B. D. : Comment est né le Marabout Théâtre ?