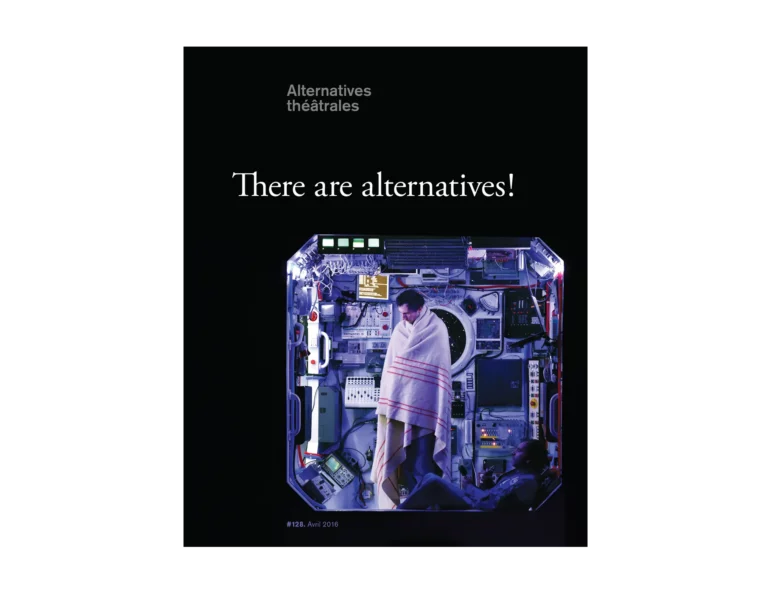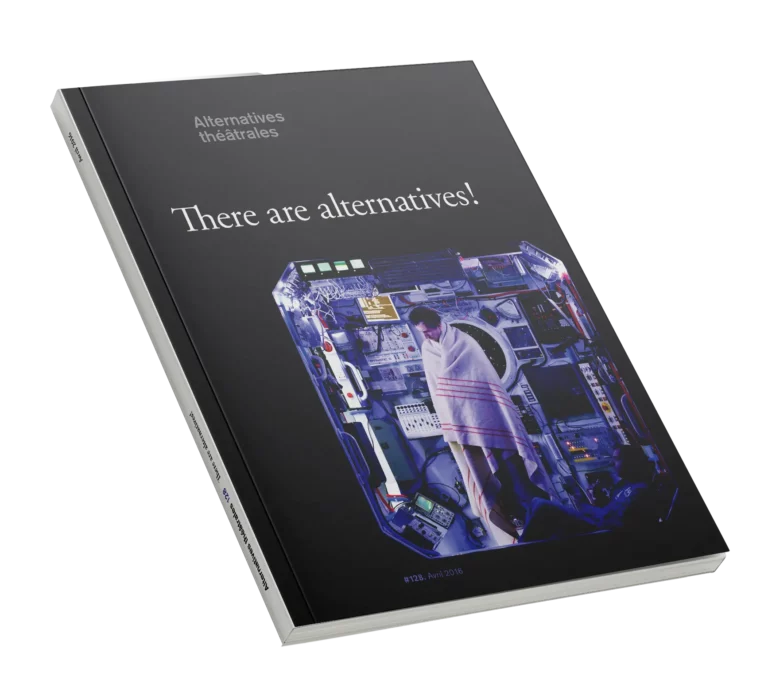PROLOGUE
Au Canada1, en 1980, puis en France, en 1991 – 1993, enfin en Belgique, en 1994, toute une masse d’intermittents du spectacle d’art vivant se rassemble pour postillonner, baver et cracher sur sa condition. Cela, pour mettre les États Généraux, de ce qu’on appelle encore faute de mieux, le « Jeune » Théâtre de la Communauté française de Belgique dans une perspective de francophonie. Cela, pour dire aussi qu’ils ne sont pas seulement l’initiative de quelques figures de proue éphémères, mais bien aussi l’effet d’une contagion. Rassembler ceux que tout sépare, sauf peut-être le titre générique de leur occupation, « gens de théâtre », était l’objet majeur des assemblées en vase clos belges2. Pendant sept journées, un peu partout à Bruxelles et en Province, des professionnels-de-la-profession se sont mobilisés parce qu’une rencontre « historique » se préparait entre le Ministre de la culture, un « Prince » élu, et des artistes à élire. Si l’on attendra longtemps encore avant de savoir ce que la rencontre « Prince » / Artiste du 29 mars dernier a eu de réellement historique, pour beaucoup, les plus jeunes surtout, c’était une première. La première fois qu’il faut faire état de sa profession, à la fois en voie de développement et de disparition, devant une autorité politique et avoir du poids et se faire entendre…
ACTE 1 :
Esthétique, aujourd’hui peut-être ou alors demain…
« Le théâtre a perdu son rôle dans l’imaginaire collectif de l’occident, on peut légitimement s’interroger sur son statut exact dans la culture contemporaine »3. Parce que cette question est aussi légitime qu’urgente, les aînés assis dans la salle, lourds des pavés de 68, légers de l’imaginaire engagé qu’ils y trouvaient en dessous, espéraient peut-être des États Généraux, de cet ensemble hétéroclite, de ce rassemblement d’individus unis par la négative (la précarité), un projet esthétique. Et bien non ! Risquant le jugement sans appel : « Le Jeune Théâtre n’a rien à dire ! », les États Généraux, reflétant encore une fois une position partagée d’un côté à l’autre de l’océan, ont refusé le débat esthétique. Pendant que l’interrogation sociale, économique et législative brûle le bas de ses robes à la rampe, la réflexion artistique est dans le trou du souffleur, aphone. Qui arriverait à définir une mouvance esthétique dans cette « foire du sens » ? Chacun peut « librement » s’emparer des images, symboles, mythes ou références de son choix. Aucun ordre symbolique n’est capable de structurer et d’unifier ces fragments épars, si bien qu’il devient très problématique pour les membres de nos sociétés contemporaines de donner une cohérence affective, imaginaire ou intellectuelle à leur expérience du monde4. Des points de repère flous et mouvants, un manque généralisé de discours, de formation politique, et la confrontation, presque journalière, avec un public qui a toujours envie de zapper (même au théâtre) ; voilà la société pour ou contre laquelle ils auraient dû se définir. En cette fin de siècle, seule l’impossibilité à caser le Jeune Théâtre dans un seul et même moule est historique. Est-ce vraiment dommageable ? Cette foire baroque n’est-elle pas « le terreau nécessaire au développement »5 ? À la question ministérielle « quel théâtre ? », la réponse, ce jour-là, a été de dire et redire la pluralité des esthétiques. À « quel public ? »6, qui soulève la sempiternelle et difficile question du Service Public, le silence, ou presque. Mais comment dire qu’à chercher son public avant de trouver son art, on triche ? Comment le dire sans désobliger celui qui gère l’argent public ? Comment le dire sans lui donner l’arme avec laquelle il peut tuer ? Comment dire enfin que le public est une affaire d’État certes, mais aussi de direction, d’intendance, de gestion, surtout une affaire de longue haleine et que le théâtre non subventionné annuellement en est au coup par coup sans savoir ni où, ni quand, ni combien de temps, il va pouvoir montrer sa « production » ? À la question sous-entendue, « Le Jeune Théâtre a‑t-il quelque chose à dire ? », la réponse tout aussi sous-entendue semblait évidente : plus qu’à dire, ils ont à faire. Et pour ce « faire », ils veulent d’abord en définir les conditions.
ACTE 2 :
On est trop nombreux, c’est la merde, qu’est-ce qu’on fait ? 7
Pour une même réalité, des discours différents. Structurer l’impossible, la pluralité des points de vue, c’est ce qu’ont essayé deux groupes.
- Josette Féval, La Culture contre l’art, essai d’économie politique du théâtre, Québec, Presse universitaire, 1990. ↩︎
- Les É. G. français ont cédé la parole aux intermittents de l’audiovisuel et àdes intervenants extérieurs au milieu (économistes, philosophes etc.), ce qui ne fut pas le cas des É. G. belges. Cf. « Libres prélèvements sur la parole qui s’est prise lors des États généreux du spectacle vivant et de l’audiovisuel, les 7, 8 et 9 mai 1993 à Lyon ». ↩︎
- Robert Abirached in Le Théâtre et le Prince, 1981 – 1991, Paris, Plon, 1992. ↩︎
- D’après Alain Birh in « L’agonie de la culture », Manière de voir n°19, le Monde diplomatique, 09/1993. ↩︎
- Robert Abirached, op, cit. ↩︎
- Question posée le 29 mars par Monsieur Éric Tomas, Ministre de la culture. ↩︎
- Ève Bonfanti, comédienne, metteure en scène, intervention lors des É. G. du 29 mars. ↩︎
- « Synthèse du groupe de réflexion « Pour une politique du Jeune Théâtre », mars 94. Signé par Michel Bernard, Frédéric Dussenne, Philippe Kauffman, Jean-Christophe Lauwers, Lorent Wanson, Benoît Blampain, Sylvie de Braekeleer, Benoît Vreux. ↩︎
- Le nombre des institutions théâtrales annuellement subventionnées en Communauté française de Belgique s’élève à 33. Cf. Étude du CIRCA. Roger Burton. ↩︎
- Jacques Huisman est resté à la tête du Théâtre National de Belgique de 1945 à 1986. ↩︎
- In « Pour une politique du Jeune Théâtre » op. cit. page 10. ↩︎
- « Dossier des États Généraux du Jeune Théâtre », mars 94. Signé par plus de 170 comédiens, metteurs en scène, scénographes, auteurs… ↩︎
- ClRCA, J. Sick et R. Burton. ↩︎
- Entre septembre 1989 et août 1993, 160 Cies ont présenté au moins un spectacle subventionné ou non par les Pouvoirs Publics. In dossier des É. G. ↩︎
- In « Dossier des États généraux : Propos, positions, propositions ». Op. cit. ↩︎
- In L’Artiste, le prince, Pouvoirs publics et création, un collectif sous la direction de Emmanuel Wallon, Grenoble Presse universitaire. 1991. ↩︎
- « Rien n’a été mis en œuvre pour que soit développée une réelle politique du Jeune Théâtre » , J. M. Piemme in L’avenir de la Communauté française, Éd. lnstitut Jules Destrée, asbl. 1976. ↩︎
- Claude Semal, comédien, in Lettre envoyée au comité pour l’organisation des É. G., mars 94. ↩︎
- Le Soir du 28 février 1994. ↩︎
- In Lettre envoyée au Ministre de la culture le 17 janvier 1994 par l’association « SOS acteurs ». Elle est signée par Catherine Claeys, Micheline Hardy, Bernard Marbaix, Luc Van Grunderbeek, Alexandre Von Sivers, Patrick Descamps, Janine Godinas, Nicole Valberg et Christian Maillet. ↩︎
- In L’Artiste, le prince, Pouvoirs publics et création, op. cit. ↩︎
- Une association représentant la Jeune Création Théâtrale en Communauté française s’est constituée en ASBL et entend continuer le travail, son premier objectif : obtenir une reconnaissance « comme partenaire officiel auprès des Pouvoirs Publics lors de toute négociation touchant, de près ou de loin, les décisions concernant la Création Théâtrale ». Contact : Théâtre Hypothésart (02) 522 45 24. ↩︎
- Titre du spectacle d’Isabelle Pousseur à partir « de l’histoire vécue » de ses acteurs. ↩︎
- D’après les propos de Jean-Christophe Lauwers, metteur en scène, in Le Soir du 13 avril 94. ↩︎
- D’après un poème de Louis Aragon. ↩︎