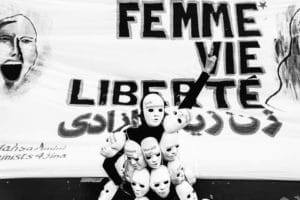Résumé
Qu’entendons-nous par vocabulaire du geste et de l’attitude du corps humain et mémoire somatique collective ? Que signifie l’incarnation corporelle d’un personnage ? Comment la connaissance de la formation socioculturelle du corps peut-elle aider le/la comédien.ne dans l’incarnation d’un personnage ?
En répondant à ces questions et à d’autres, le présent essai vise à développer la connaissance des éléments construisant le vocabulaire du geste et de l’attitude corporels ainsi que ceux de la mémoire somatique collectiveen se référant à un cas concret (le coaching du protagoniste du long métrage Pari). Nous montrerons ainsi comment cette connaissance peut être au service du comédien, surtout en ce qui concerne le corps, les gestes et les attitudes corporelles d’un personnage.
En nous appuyant sur cette expérience, ainsi que sur les observations et les résultats de celle-ci, nous chercherons à savoir ce que veut dire la formation sociale du corps.
La mémoire collective de gestes et d’attitudes corporels
La « mémoire collective des gestes corporels » de l’homme enregistrera, certainement, l’ensemble des pratiques, des rituels et des gestes sanitaires issus de la pandémie du Covid-19.
Il est indispensable, alors, de penser à l’impact de cette pandémie comme UN des éléments agissants parmi l’ensemble des facteurs déterminants de la formation de la mémoire des gestes et des attitudes du corps humain. À cet égard, la méconnaissance de l’assise locale et du contexte social nous fait dévier du chemin de la connaissance de cette mémoire. Ce qui signifie que cette dernière change, face aux mêmes facteurs, d’une société à l’autre, et que l’élément local joue un rôle important dans sa construction en termes de réception ou/et de rejet d’un ou des facteurs.
Cette prise en compte de la pandémie du Covid-19 comme UN des éléments constituants de cette mémoire présuppose l’existence d’AUTRES éléments essentiels à la formation de celui-ci.
Qu’entendons-nous par vocabulaire du geste et de l’attitude du corps humain ? Que signifie exactement la mémoire collective des gestes corporels ? Quels sont ces AUTRES éléments ?
Il s’avère que la réalité du corps humain n’est pas abstraite. N’étant pas dissocié de la notion de construction de la subjectivité, le corps ‑en tant que « lieu matériel »1- ainsi que sa morphologie, ses mouvements, ses conduites, ses gestes et ses attitudes ne sont pas des constructions prédéterminées, déjà faites et isolées. En l’occurrence, la référence à Karl Marx devient pertinente lorsqu’il définit l’essence humaine dans « l’ensemble des rapports sociaux » (Thèse 6).
À son tour, J.-M. Brohm confirme que le corps humain est « une institution politique définie par des rapports sociaux de classe et insérée dans l’ensemble des institutions politiques d’une formation sociale donnée ».2
Prenant cet ensemble d’observations comme point de départ, nous nous sommes orientés dans une direction qui nous rapproche des éléments agissants construisant ce vocabulaire du geste et de l’attitude corporels, de la mémoire somatique collective et enfin de la formation (sociale) du corps humain en tant qu’unité matérielle consciente.
Cet essai vise donc à développer la connaissance de ces éléments en se référant à un cas concret et à montrer comment cette connaissance peut être au service du comédien, surtout en ce qui concerne le corps, les gestes et les attitudes corporelles d’un personnage.
Il s’agit d’une expérience de coaching du protagoniste du long métrage Pari, réalisé en 2018 par Siamac Etemadi et présenté au festival Berlinale 2020.
Ceci n’a rien à voir avec les complicités, les complexes ou les défis psychologiques du personnage. Autrement dit, cette recherche concerne un stade prétexte où les réactions objectives d’un organisme (d’un sujet précis, ici, l’acteur.trice), ses mouvements et sa manière de se tenir dans l’espace commencent à se former dans un contexte particulier à la fois culturel politique et personnel.
En nous appuyant sur cette expérience, ainsi que sur les observations et les résultats de celle-ci, dans la présente recherche, nous chercherons à savoir ce que veut dire la formation sociale du corps.
Dans quelles conditions, une circonstance socioculturelle, voire politique peut-elle changer ou (re)construire une attitude corporelle ou rajouter un élément au vocabulaire du geste et des attitudes du corps ? Comment cet élément peut-il s’intégrer dans la mémoire somatique et collective ? Peut-on parler d’une intégration générale d’un élément gestuel ou d’une attitude dans la mémoire des gestes corporels pour tous les individus ? Que signifie l’incarnation corporelle d’un personnage ? Comment la connaissance de cette formation socioculturelle du corps peut-elle aider le/la comédien.ne dans l’incarnation d’un personnage ?
Le projet du coaching : le jeu d’acteur et la localisation corporelle du personnage
Pour répondre à ces questions et aux autres, nous avons recours à l’expérience pratique et concrète de coaching d’une comédienne germano-iranienne. Celle-ci permet d’établir un dialogue entre la théorie et la pratique.
La comédienne, Melika Foroutan, censée jouer le rôle d’un personnage féminin iranien, Pari, immergé dans un mode de vie traditionnel et religieux, est née en Iran, mais elle a grandi et a vécu en Allemagne dès l’âge de 6 ans. Étant donné qu’elle maîtrisait peu ce mode de vie et la culture de la classe sociale particulière d’où venait le personnage du film3, j’ai tâché de l’aider en tant que coach culturel. Le travail a pris un autre éclairage lorsque j’ai observé une différence considérable entre les gestes, les attitudes et les mouvements de son corps et les miens en tant que comédienne (chercheuse) née et élevée en Iran.
Cette différence parfaitement significative constitue le noyau principal de l’idée de ce qu’on considère comme la formation socioculturelle du corps.
Le long métrage Pari raconte l’histoire d’une femme-mère iranienne,Pari, dont la vie et le caractère sont bouleversés, par la recherche de son fils, Babak.
En effet, arrivant à Athènes pour rendre visite à leur fils, Pari et son mari, Farokh, constatent sa disparition. La joie de voir Babak qui a quitté l’Iran pour continuer ses études cède très vite sa place à l’angoisse et à la frustration issues de sa disparation voire de son absence volontaire ou involontaire. Pari et Farokh commencent alors à suivre les traces de Babak dans les rues d’Athènes afin de le retrouver. Cette recherche constitue l’axe principal autour duquel l’histoire du film se construit ; un long chemin, parfois sombre et étrange, parfois effrayant et angoissant qui va aboutir au décès de Farokh. Après la mort de celui-ci, Pari continue, toute seule, la recherche de son fils/d’elle-même. Celle-ci l’amène dans les rues glauques d’Athènes, la fait jouer au chat et à la souris avec des anarchistes et la police grecque, la fait passer par des souterrains où elle rencontrera des vendeurs de drogue et des prostituées. Cette recherche plonge Pari dans une aventure périlleuse. Finalement, Pari qui n’est plus la même personne qu’au début du film se rend compte que son fils a complètement décroché du système et qu’il a choisi une vie nomade ‑dans des espaces liminaux comme la mer, allant vers des destinations inconnues- mais libre. La recherche de Babak est, d’une manière ou d’une autre, pour Pari, une métaphore qui lui permet de se trouver et de revenir à ses pulsions perdues, réprimées par la religion et la tradition.
Quelques petits détails sur le caractère de Pari peuvent éclairer davantage en quoi consiste ce travail de coaching comme source pratique de la présente recherche.
Il faut tout de suite souligner que Pari et son mari Farokh sont issus d’une classe sociale aisée, religieuse et traditionnelle que l’on appelle Bazari (commerçant) ; une sorte de bourgeoisie iranienne ayant ses racines d’une part dans la société traditionnelle-religieuse iranienne et de l’autre dans le négoce (traditionnel).
Outre les dialogues et l’histoire, nous pouvons deviner cette origine sociale grâce à deux éléments du système esthétique et de marquage du film, et ce, dès la première séquence (scène de l’aéroport). Le premier élément réside dans l’apparence des personnages. En sus de l’obligation faite aux femmes iraniennes de porter le voile Pari porte le Tchador ; une sorte de long voile, de la tête au pied qui marque soit une adhésion pleine et entière à la religion de l’Islam, soit plutôt à un mode de vie enraciné dans la tradition et la religion. N’étant évidemment pas dissociés l’un de l’autre, ces deux types d’adhésion se différencient au niveau du degré de fidélité à la religion et aux modes de vie « religieux » ou « traditionnels-religieux ». S’agissant du personnage de Pari, il est plutôt question du deuxième mode (traditionnel-religieux). (Figure 1)

Quant à celui de Farokh, les codes vestimentaires, son apparence (barbe, trace de la pierre de prière sur le front) et ses accessoires (comme le Chapelet), etc. évoquent parfaitement le type masculin du commerçant de bazari. (Figure 2)