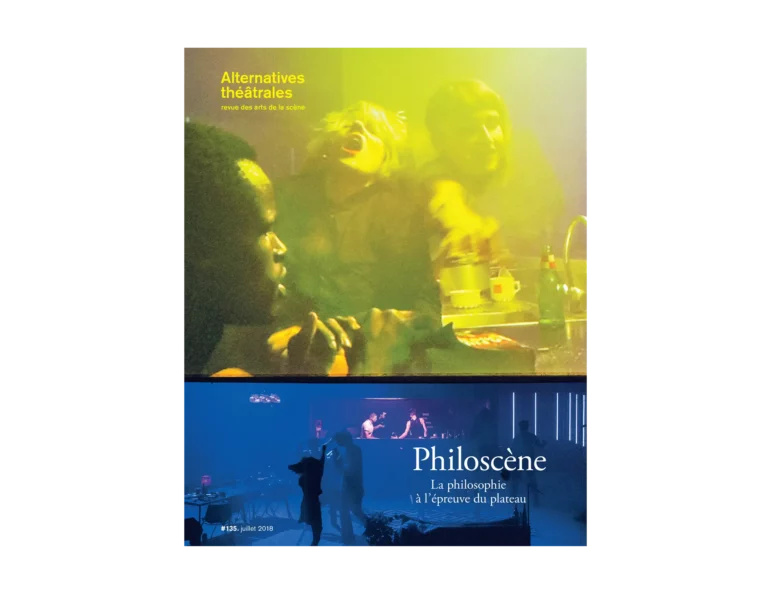Comme il paraît loin le temps des Armand Gatti, Antoine Vitez et Jean Vilar pour qui a découvert après des études de philosophie le spectacle vivant à travers les pièces d’Alain Platel, de Jan Lauwers ou encore d’Anne Teresa De Keersmaeker, ce temps dont aura eu raison les assauts conjoints de la gestion culturelle des années mitterrandiennes et les deuils successifs des politiques d’émancipation. Et pourtant le théâtre aura été le lieu rêvé d’une communauté à venir, celle des égaux, censée être incarnée par l’énigme d’un collectif égalitaire entre le spectateur et les acteurs, nourrie des idéaux de l’alliance de la philosophie et de la politique. L’effacement de la figure de l’intellectuel, telle que Sartre a pu magistralement l’incarner, qui pouvait passer du roman à la philosophie et écrire du théâtre en même temps, a rompu l’évidence d’un geste qui pensait pouvoir trouver en l’espace de la scène le lieu d’une transposition et d’une interprétation des visées de la philosophie concernant le vrai, le juste et le beau.
Aussi ne fut-il pas de lien entre la philosophie et le théâtre qui ne fut politique, c’est-à-dire qui ne pense un effet de présentation des idées auprès d’un ensemble d’individus en vue de les amener vers une prise de conscience, une connaissance, et une action qui en serait la conséquence. Alain Badiou et Bernard-Henri Lévy sont parmi les derniers, en France, à risquer ce lien qui s’estompe, alors que les fines analyses du premier ont cependant pointé la disparition du schème éducatif qui habitait la croyance de la philosophie à édicter à l’art, et au théâtre singulièrement, son horizon de pensée, comme celle du théâtre à être l’endroit privilégié d’une présentation collective en corps et en mots d’une vérité philosophique.
Cette disparition du schème didactico-romantique, pour reprendre le vocabulaire d’Alain Badiou, c’est-à-dire tout aussi bien l’extinction des avant-gardes qui voulaient mettre fin au caractère « inauthentique et aliéné » du théâtre, tout en préservant à celui-ci son « absoluité, comme conscience intégrale de ses propres opérations »1, est ce qui permet de poser à nouveau frais le lien entre l’art et la philosophie, et de rendre plus sensible à de nouveaux régimes de production du spectacle qui déplace le lien de la philosophie au théâtre ou le contourne, mais ne laisse en aucun cas une place vide, pour le pire comme pour le meilleur.