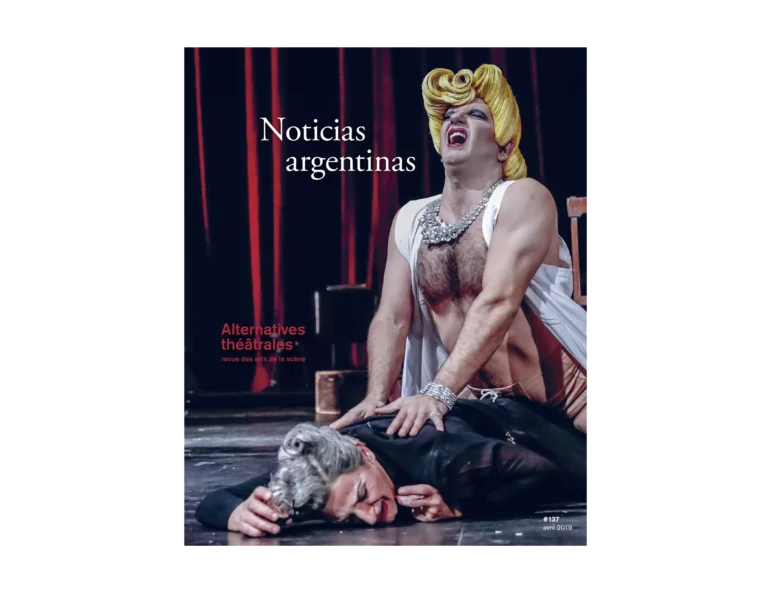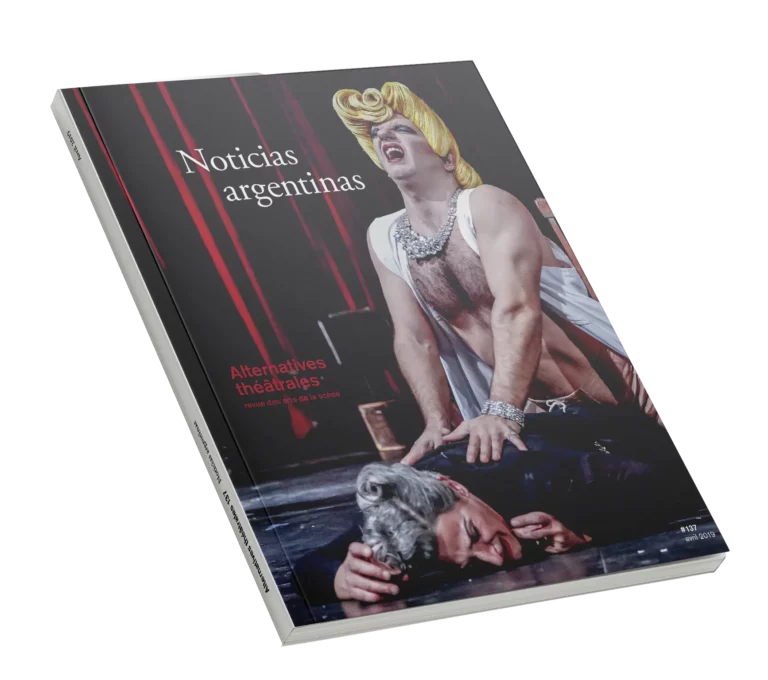Le circuit alternatif (ou indépendant) comprend près de quatre-vingts pourcent des théâtres de la ville de Buenos Aires. Il se configure comme un réseau interconnecté de micro-expériences théâtrales constituant un espace de subjectivité alternative, en opposition à la théâtralité sociale de la politique et des grands canaux d’information et de communication. « Le théâtre comme une forme de vivre d’une autre manière, de penser le monde d’une autre manière »1, comme ose l’affirmer le metteur en scène Ricardo Bartís. La scène alternative est aussi un contre-pouvoir concret, qui sait organiser des actions politiques contre les dérives du pouvoir en place, comme c’est encore le cas depuis l’accession de Mauricio Macri à la présidence en décembre 2015. La démission du ministre de la Culture de la ville de Buenos Aires et directeur de l’Opéra Colón, Darío Lopérfido, en janvier 2016 en fut un exemple2. Le champ du théâtre alternatif joua un rôle important dans ce qui constitua une victoire politique pour le secteur qui s’impose comme un espace politique alternatif face à la « colonialité 3 » du pouvoir médiatico-politique en Argentine. La création théâtrale et la lutte politique n’allant pas l’un sans l’autre, à Buenos Aires.
À travers les processus de création de différents teatristas/créateurs, on peut observer à l’œuvre une approche décoloniale de la création théâtrale. Celle-ci s’approprie, critique et dialogue avec l’héritage intellectuel et théâtral européen, rendant possible la formation d’un espace de subjectivité alternative qui vient questionner « l’argentinité4 ».
Le teatrista/créateur, une singularité argentine.
À la fois acteur, metteur en scène, dramaturge et pédagogue, la figure du teatrista/créateur s’est imposée dans la scène contemporaine argentine. Le théâtre alternatif de Buenos Aires adopte une posture politique clé en plaçant l’acteur au centre de la création. L’auteur ne représente plus le pouvoir et la « dramaturgie de l’acteur » se développe avec les teatristas/créateurs. L’acteur n’est pas considéré uniquement comme un interprète mais comme un compositeur à part entière, qui crée un langage par ses mouvements, ses mots et son corps, accompagné par le metteur en scène qui libère sa créativité par des exercices d’improvisation.
D’après l’étymologie de ce mot-valise (teatro et artista), teatrista serait un « artiste de théâtre ». Le mot teatrista fait son apparition dans les années 1960 en Argentine, lors de la consolidation et la professionnalisation du « théâtre indépendant ». Alors que l’idéal indépendant – la recherche d’un théâtre d’Art et du théâtre comme instrument éducatif et politique – s’est imposé dans les années 1930 avec Leónidas Barletta et le Teatro del Pueblo, cette pratique va se renforcer dans les années 1960, en plein bouleversement politique. De nombreux groupes se constituent autour d’un Maestro de actores (maître d’acteur) qui développe une école et une esthétique théâtrale et politique collectives en s’inscrivant dans l’idéal de Barletta. Ancêtre du teatrista, le maestro de actores a une pédagogie et une esthétique propre au groupe qu’il dirige, qui se conjugue à une activité politique et une organisation proche des groupuscules de la gauche radicale et de la guérilla de ces années de post-révolution cubaine. L’héritage de Stanislavski est revisité, le théâtre se modernise et découvre les idées de Meyerhold, Brecht, ou Artaud, et dans un contexte politique instable, qui connaît plusieurs périodes de dictatures, le théâtre devient un acte de résistance face à la répression. On peut citer, entre autres, Alejandra Boero, Juan Carlos Gené, Carlos Gandolfo, Augusto Fernandes, Agustín Alezzo, Raúl Serrano, Norman Briski, ou encore Alberto Ure. Le circuit alternatif va peu à peu se professionnaliser et le mouvement va quelque peu se désarticuler en s’ouvrant à d’autres formes d’organisation sans perdre son éthique fondatrice. Si le théâtre indépendant de Barletta divisait les tâches entre auteurs (comme Barletta), metteurs en scène et acteurs, la professionnalisation accentue la nécessité de la spécialisation en corps de métier. Toutefois, des personnalités comme Alberto Ure, Juan Carlos Gené ou Eduardo Pavlosky s’essayent à la fois à la mise en scène, au jeu d’acteur et à la dramaturgie, considérant le théâtre comme un tout et l’acteur comme le centre de la création. Ils donnent ainsi naissance à la figure du teatrista, sorte de créateur total.
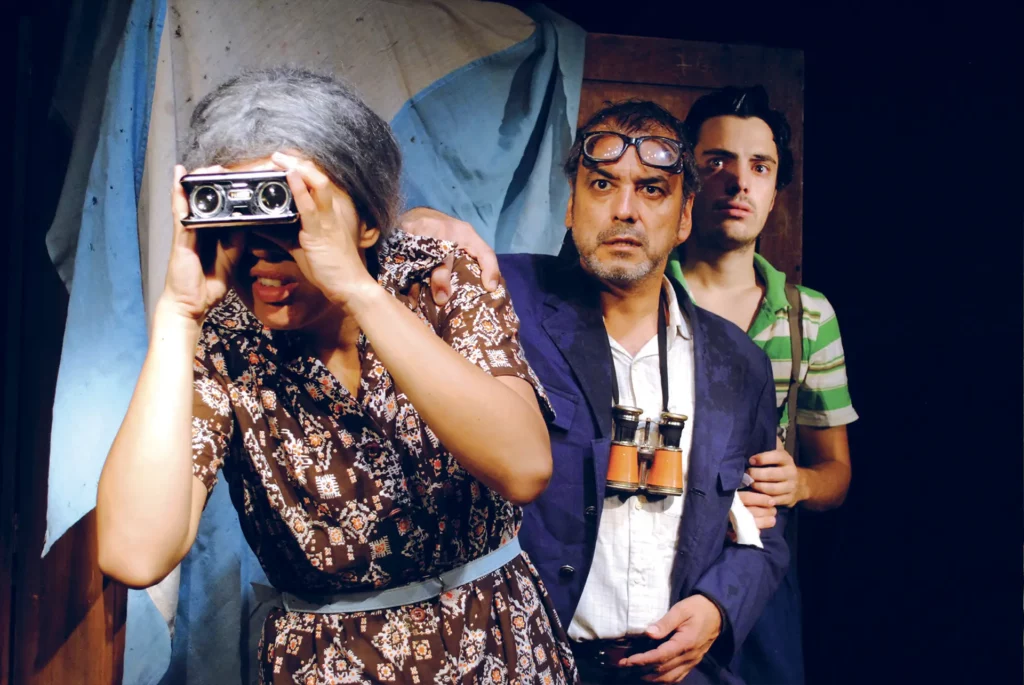
La pédagogie et l’enseignement sont aussi des tâches communes aux teatristas/créateurs, qui s’inscrivent dans l’héritage de la transmission du maestro de actores. Les cours privés représentent une des principales sources de revenus possible de la scène alternative et des espaces de création qui permettent d’enseigner, de créer et de programmer des spectacles, vont se multiplier. Ricardo Bartís et Mauricio Kartun, les deux pères de la scène alternative après le retour de la démocratie (1983), se sont formés dans les années 1960 et contribueront à la prolifération du terme de teatrista/créateur jusqu’ à aujourd’ hui. Les deux s’inscrivent dans la logique du maître et ont formé des centaines de personnes, Bartís par ses cours de jeu et Kartún par ses cours de dramaturgie. Ils développent une œuvre théâtrale propre au teatrista/créateur moderne, en mêlant direction d’acteur, mise en scène et dramaturgie au sein du même processus de création. Bartís, dans la lignée d’Alberto Ure (son maestro de actores) affirme :
« Il faut mettre en place une méthode criollo5 du teatrista/créateur : mélange, superposition, hétérodoxie et fusion, sans volonté de classicisme ou pureté, les accidents et les malentendus qui surgissent deviennent des événements théâtraux puissants et des métaphores significatives. Son théâtre [celui du teatrista/créateur] ne se fait ni avec le travail d’introspection ni avec les actions physiques ni avec le clown ni avec l’anthropologie théâtrale ni avec la biomécanique de Meyerhold, et à la fois avec des traces de tout cela, mélangé avec les savoirs des acteurs criollos, de la scène ríoplatense6. »
C’est à partir de ce mélange, de cette sopa criolla (soupe créole) des théories et techniques théâtrales que nous poserons l’hypothèse d’une posture politique décoloniale du teatrista : celle du ciruja (du lunfardo, dans l’argot de Buenos Aires) : « personne qui cherche en opérant les poubelles, tel un chirurgien avec un scalpel, pour trouver quelque chose de quoi tirer profit7 ».
L’anti-méthode du cirujeo d’Alberto Ure.
- Bartis, Ricardo, Cancha con niebla, teatro perdido : fragmentos, Atuel, Buenos Aires, 2003. ↩︎
- De nombreux théâtres et compagnies ont demandé la démission du fonctionnaire public qui avait minimisé le nombre de disparus durant la dictature de 1976 – 1983 et ont obtenu gain de cause en juillet 2016. À la fin de la plupart des spectacles du circuit alternatif, on diffusait un enre- gistrement des déclarations controversées de Lopérfido et on lisait une lettre – signée par plus de 250 artistes et intellectuels et envoyée au chef du gouvernement de la ville Buenos Aires – demandant la démission du ministre. Sign the Petition. (2018). Change.org. https://www.change.org/p/presidencia-de-la-nacion-argentina-lo-perfido-debe-renunciar-carta-abierta-al-presidente-mauricio-macri-y-a-larreta‑2 ↩︎
- On entend « colonialité » au sens d’Anibal Quijano : « le modèle structurel de pouvoir (puissance) spécifique de la modernité, provoqué à partir de la conquête de l’Amérique et l’hégémonie subséquente planétaire européenne ». Quijano, Anibal, Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. En Edgardo Lander, comp. Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales. CLACSO- UNESCO 2000, Buenos Aires, Argentina, p. 201 – 246. ↩︎
- On entendra ici « l’argentinité » au sens critique de Luis García Fanlo comme une série de pratiques et de dispositifs constituant un régime de vérité (Foucault) ou d’autorité qui produisit au fil de l’histoire du pays une manière et une forme supposées d’être argentin. Garcia Fanlo, Luis, Genealogía de la argentinidad. Gran Aldea Editores, Buenos Aires, 2010. ↩︎
- Criollo — qui signifie « créole » en espagnol : natif du continent américain à la suite de la colonisation. ↩︎
- Du Río de la plata. Se réfère à la zone géographique proche du fleuve de la Plata, entre l’Uruguay et l’Argentine. Bartis, Ricardo, dans SAGASETA, Julia Elena, Miradas sobre la escena teatral argentina en democracia, UNA, Buenos Aires, 2010. ↩︎
- http://www.wordreference.com/definicion/ciruja. ↩︎
- Dubatti, Jorge, Apuntes sobre Ricardo Bartíscreador, Saquen una Pluma Dramaturgia Rodante. 2011. Web. 19 Feb. 2018. ↩︎
- Ure Alberto, Sacate la careta, ensayos sobre teatro, política y cultura, Norma, Buenos Aires, 2003. ↩︎
- Ure, Alberto, Ponete el antifaz, INT, Buenos Aires, 2009. ↩︎
- Mignolo, Walter, La désobéissance épistémique : rhétorique de la modernité,logique de la colonialité et grammaire de la décolonialité, Broché, Paris, 2015. ↩︎
- Kartun, Mauricio, Escritos 1975 – 2015, Colihue, 2015. ↩︎