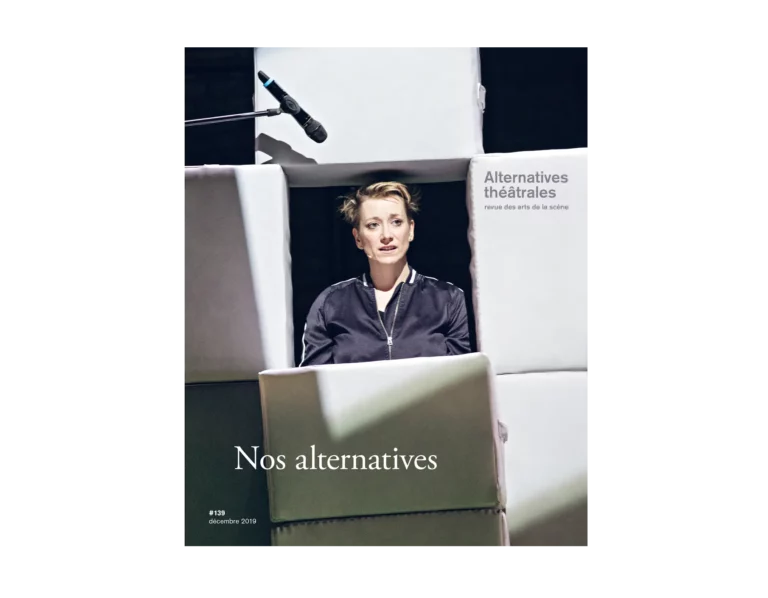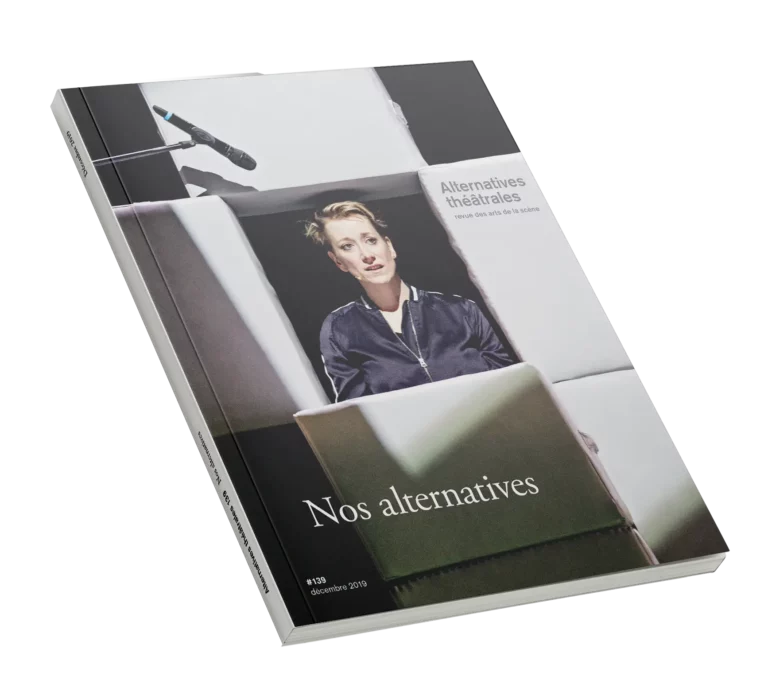BD
Quel regard porter sur ce qu’ont été les alternatives théâtrales des années 1970 à Bruxelles en les mettant en regard avec la situation actuelle des artistes émergents du paysage théâtral ? Faire du théâtre, quand on débute, c’est bousculer, inventer, revendiquer, chercher des voies nouvelles et aussi s’inscrire dans une histoire, être héritier d’autres artistes qui ont marqué leur temps…
Philippe Sireuil : Dans les années 1970 – 80, notre génération, celle qui avait entre vingt-cinq et trente ans, n’avait pas ce qu’on pourrait appeler l’inquiétude de l’avenir. J’ai aujourd’hui le sentiment inverse. Les générations actuelles ont peu ou pas de perspectives, alors que nous avons inventé les nôtres, bénéficiant de circonstances historiques favorables – notamment la création, au début des années 1960, des écoles de théâtre et de cinéma (iad et insas) qui s’ajoutent aux conservatoires, et qui forment actrices, acteurs, metteuses et metteurs en scène, lesquels ne se reconnaissent aucun cousinage, aucune filiation avec les théâtres en place de l’époque : National, Rideau, Parc, Galeries et Poche. L’éventail des possibles pour y pratiquer nos projets artistiques était très restreint. Très vite, conscients de cette émergence forte, les pouvoirs publics créent une enveloppe budgétaire et une commission du Jeune Théâtre (aujourd’hui appelée d’aide aux projets théâtraux) pour y répondre, et lui offrir des moyens certes limités, mais qui lui permettent de naître. Dans l’esprit et le désir de nombre d’entre nous, il s’agissait de proposer une alternative à ce qui se faisait : d’autres manières de pratiquer et de rémunérer, d’autres répertoires, d’autres langages et formes scéniques, revendiquant le théâtre comme acte de création. Nous étions fortement influencés par ce que l’étranger proposait, (et que nous ne voyions pas ici à l’exception du Théâtre 140, du Festival du Jeune Théâtre de Liège, et aussi de l’Atelier Théâtre Jean Vilar première formule), que l’on soit – pour reprendre les schèmes de l’époque – du théâtre du corps de filiation grotowskienne (Frédéric Baal, Frédéric Flamand, Alain Mebirouk) ou du théâtre critique de filiation brechtienne (Marc Liebens, Philippe van Kessel, Patrick Roegiers et moi-même), sans oublier les inclassables et singuliers comme Alain Populaire, Martine Wijckaert, et toutes celles et ceux que j’oublie – ce mouvement étant notoirement protéiforme –. Les théâtres existants nous étant fermés, beaucoup ont cherché des lieux pour y loger leurs pratiques : à la suite du Théâtre du Parvis (aujourd’hui C.C Jacques Franck), de nouveaux espaces naissent entre 1975 et 1985 : Raffinerie du Plan K, Balsamine, Ciné Rio, Banlieue (aujourd’hui Rideau de Bruxelles), Balsamine, Théâtre Élémentaire, Théâtre des Tanneurs, La Caserne, Théâtre Varia, créant à Bruxelles un véritable maillage alternatif. Il s’agissait non seulement de trouver des abris en phase avec nos pratiques, mais aussi de réfléchir à la relation du spectacle au spectateur, d’inventer un théâtre à la mesure de nos ambitions et/ou utopies ; le Théâtre Varia naît de celles-ci, en réunissant trois metteurs en scène (Delval, Dezoteux et moi-même) aux esthétiques et pratiques différentes voire divergentes au sein d’un même lieu.

BD
Aujourd’hui les institutions accueillent d’avantage de jeunes créateurs…
Philippe Sireuil Les frontières entre les théâtres et les compagnies sont devenues plus poreuses, c’est un fait. Au Théâtre des Martyrs, cette démarche est héritée d’une histoire (au Rio et au Varia, j’ai toujours partagé) et d’une envie forte : d’aider à naître à mon tour, et de transmettre.
BD
Les conditions historiques ont changé. Le maillage dont tu parlais a donné naissance à une multiplication de lieux.
Philippe Sireuil La singularité du Varia me paraît aujourd’hui non reproductible : à supposer que des metteuses et metteurs en scène comme Jean-Baptiste Delcourt, Pauline d’Ollone et Justine Lequette, ou d’autres, s’associent pour créer un nouvel outil, ils ne trouveraient plus le soutien que nous avons eus ; ce temps-là est révolu : il suffit pour s’en convaincre de se rappeler l’aventure du Z.U.T. arrêtée six ans après sa création, ou de songer aux huit ans de nomadisme qu’a connu le Rideau de Bruxelles avant de retrouver un lieu.
BD
Que va-t-il se passer quand les directions des théâtres à Bruxelles vont à nouveau être ouvertes ?
Philippe Sireuil Les arts de la scène sont traversés par de vives tensions : rapports entre les groupes artistiques sans lieu fixe (toujours plus nombreux) et les théâtres institutionnels, revendications légitimes d’un véritable équilibre entre les hommes et les femmes aux postes de direction, cinquantenaires solitaires qui n’ont pas trouvé leur place… Dans les deux ans à venir, cinq directions devraient changer (si je suis bien informé) : Rideau de Bruxelles, Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve, Théâtre Varia, Théâtre de Namur et Théâtre des Martyrs. Mener un projet artistique et assumer la gestion d’un lieu (et les contradictions inhérentes), ce ne sont pas les mêmes métiers : on peut bien sûr les mener de front avec intérêt et bonheur, mais on peut aussi trouver la charge lourde (car charge il y a). Il est pourtant besoin d’artistes à la tête des théâtres, c’est à partir du plateau qu’un théâtre se construit et se gère. Quels sont celles et ceux qui seront en capacité de s’y engager, sans craindre d’y perdre des plumes ? Aujourd’hui en France des artistes comme Joël Pommerat ou Jean-François Sivadier dédaignent les directions qu’on leur a offertes. Ils préfèrent leurs libertés et s’appuyer sur des grandes institutions pour mener à bien leurs projets. Fabrice Murgia, leur cadet aujourd’hui à la tête du National, a fait le choix inverse, c’est vrai… Mais nombre d’artistes émergents, comme on les appelle ici, n’ont pas, d’après ce que j’en entends, ce désir de la sédentarité responsable avec tout ce qu’elle entraîne, à la fois comme capacités de levier mais aussi de contraintes. Je ne suis pas devin, et je ne sais ce que l’avenir de notre profession sera ; si je regarde dans le rétroviseur, il me semble que nous avons échoué à cette transformation qui accompagnait nos pratiques artistiques, et que nous appelions de nos vœux trente ou quarante ans plus tôt : celle des moyens de production, des conditions d’exercice des métiers de la scène, de la revalorisation d’une profession.
BD
Je serais moins pessimiste : suite à votre travail et vos revendications, on peut dire que des transformations profondes ont eu lieu : répétitions payées, moyens augmentés, expérimentations soutenues, sans parler des nouvelles respirations apportées dans le champ esthétique, le jeu de l’acteur, le répertoire, l’évolution de la formation…
Philippe Sireuil Il y a plus de moyens et plus de lieux, oui, mais les besoins sont aussi plus denses, et la jungle plus touffue… « Les répétitions sont payées », dis-tu, il serait prudent dans de nombreux cas d’utiliser l’imparfait. L’art de la débrouille n’a jamais été aussi efficace… Je rencontre nombre de jeunes artistes qui jouent avec des bouts de ficelle, à la recette. Nous vivons une situation morcelée, comme dans de nombreux pans de la société, modèle à deux vitesses. Quand nous avons débuté, il y avait globalement moins d’argent, il y avait aussi des règles auxquelles nous ne voulions pas déroger, dont une essentielle, qui était que tout travail mérite salaire. Ce que nous avons un temps imposé, n’a pas tenu. La vague néo-libérale est passée par là, l’effet d’entraîne-ment n’a pas eu lieu. « Le train du monde a déraillé par rapport à nos attentes » comme l’écrit Régis Debray, dans Bilan de faillite.
BD
Les alternatives des années 1970 étaient aussi esthétiques…
Philippe Sireuil « Il faut des formes nouvelles ! » chaque génération porte le cri de Treplev, et la nôtre, profitant des bouleversements de l’Histoire avec un grand H, des utopies portées par les événements de soixante-huit, du vent de liberté qui régnait, n’a pas échappé à la règle. Au début des années 1970, j’ai dix-huit ans ; à l’insas (merci aux professionnels et professeurs rencontrés), je découvre, au travers des cours et des couloirs, le théâtre dans toutes ses composantes, dont le brechtisme qui me marquera durablement, et aussi la littérature ; à la sortie de l’école je milite pour un « théâtre de l’ère scientifique » comme l’écrivait Brecht dans son petit organon, un théâtre politique d’où le poétique n’est toutefois pas exclu, et qui accordait à la fiction sa pleine capacité à parler de la réalité : « Le théâtre ne peut exister que dans l’éloignement par rapport au sujet dont il traite », disait Antoine Vitez. Si je crois toujours à la force de la fiction, à ce détour qu’implique l’éloignement dont Vitez parle, je constate aujourd’hui un mouvement plutôt inverse : nombre de jeunes artistes (en solo ou en collectif) répugnent à traiter le texte, qu’il soit du répertoire ou contemporain ; nombre de projets théâtraux prennent appui sur des enquêtes, des voyages, des interviews, – plus on est proche de l’actualité, plus on est juste, en phase avec le monde, semblent-ils penser… L’ère numérique change de fait notre rapport au réel. Mais méfions-nous de toute certitude ou généralité, de jeunes artistes, comme Pauline, s’intéressent encore aux fictions du passé, au répertoire…
Pauline d’Ollone Je ne sais pas si les jeunes artistes ne s’intéressent pas aux fictions du passé. Ce que je pense, c’est que ceux qui s’y intéressent ont plus de mal à émerger. On va plus facilement donner une chance à des metteurs en scène qui viennent parler de sujets « sociétaux » collant immédiatement à l’actualité. Je me passionne pour les nouvelles écritures et je trouve essentiel de s’intéresser aux auteurs contemporains. Mais je crois aussi à la nécessité de connaître les « anciens » pour pouvoir penser le monde contemporain et y créer quelque chose de nouveau. Je crois que la création contemporaine, si elle n’utilise pas le détour et la métaphore, risque de s’étioler. Regarder une société ancienne et disparue offre une perspective qui permet d’interroger la nôtre avec une plus grande acuité. Inversement, se contenter de reproduire une société passée risque d’enlever au théâtre sa qualité de spectacle vivant pour en faire l’espace de déambulation de poupées de cire. C’est dans le dialogue entre hier et aujourd’hui que je trouve mon inspiration.
BD
Au départ il faut d’abord trouver des partenaires de production…
Pauline d’Ollone Les premières années de métier on s’est habitué à travailler avec très peu d’argent, comme si c’était normal… On l’a à peu près tous fait, mais je n’ai plus envie de le faire ! Pour ma part, je n’attends rien du politique. J’ai l’impression qu’ils ne s’intéressent pas à la culture, à l’art. J’essaye plutôt de convaincre des partenaires artistiques. Une des grandes questions qui me préoccupe, c’est de conjuguer une démarche artistique exigeante et une volonté d’intéresser et de rencontrer le public, le toucher. Si la culture, l’art n’intéresse pas les politiques, comment y intéresser les citoyens ? Pour mon premier spectacle Reflets d’un banquet, j’ai eu beaucoup de mal à trouver des soutiens financiers… On me disait que cela allait n’intéresser personne (sauf des philosophes, des intellectuels…). Quand j’ai voulu monter Roméo et Juliette on m’a dit : « écris plutôt quelque chose »… et j’ai écrit quelque chose malgré moi, ce n’était pas mon désir… Des citations de textes déjà écrits se sont retrouvées dans mon écriture et cette « collision » de différentes époques au sein d’une même œuvre s’est avérée plutôt intéressante. Aujourd’hui j’ai obtenu de l’argent pour un texte du répertoire : est-ce parce que les membres de la capt ont changé ou du fait que j’en suis à mon troisième spectacle et qu’on me fait plus confiance ?
Philippe Sireuil Il y a une curieuse idée aujourd’hui (qui ne date pas d’aujourd’hui) : le théâtre de texte est mort, la fiction est impuissante à interroger le réel de manière à concerner les spectateurs. Le cœur de la question esthétique, c’est le regard posé sur. Il me semble que ce qui est aidé, favorisé, financé, ce sont ces démarches que j’évoquais plus haut. Le texte suscite méfiance a priori, le répertoire n’en parlons pas… À nos débuts, on jugeait de la pertinence d’un projet au regard de sa singularité, quel que soit le terrain choisi.
Pauline d’Ollone Je viens de France où j’ai suivi des études de lettres avant de venir à l’insas. J’ai pu voir durant mes études françaises du théâtre très classique (Comédie française). Je ne le renie pas. À Bruxelles, j’ai été déroutée et intéressée par la manière dont certains metteurs en scène, actrices et acteurs pouvaient s’approprier ces textes (en voyant Poquelin par les tg STAN, par exemple, je redécouvrais Molière autrement et c’était plus vivant !). Je m’étais habitué à un Molière de musée et le choc des cultures permettait de le lire autrement. Eux n’avaient pas ce respect, ce n’était pas leur culture. Ils apportaient un coup de poing dans l’interprétation et en même temps on entendait la langue. La Belgique a été très importante pour moi par la découverte de ce genre d’expérience. il y avait à l’insas une irrévérence, une liberté que j’ai pu m’octroyer. Je ne dis pas qu’il ne faille pas respecter les textes. Parfois cette irrévérence devient de la désinvolture… J’ai à la fois cet amour des textes et de la langue et en même temps je suis fascinée parce que des Belges, Wallons et Flamands peuvent avoir d’irrévérencieux dans son traitement.
BD
Qu’est-ce qui te guide dans le choix des textes que tu veux monter ?
Pauline d’Ollone Il faut que le texte me questionne, m’intrigue, voire me choque. J’avais durant ma formation étudié Le Banquet de Platon de manière classique et respectueuse. On entendait les phrases les plus importantes, les plus profondes. En le relisant j’ai découvert que parmi les invités au banquet, certains disaient importe quoi, des choses hyperchoquantes, misogynes, racistes. C’est souvent un sentiment d’indignation par rapport à un texte qui me guide. L’envie de l’interroger de façon iconoclaste tout en l’abordant avec amour. Dans Roméo et Juliette que j’espère un jour pouvoir monter, il y a cette même démarche : une sorte de malaise par rapport à cette histoire d’amour, ce langage amoureux apparemment magnifique alors qu’ il y a autour de cela, une boucherie, un massacre. Les amoureux n’ont pas l’air de s’en émouvoir… Il y a une dichotomie entre l’image d’Épinal de ce texte qui fait référence à un amour apparemment parfait et la vision que j’en ai qui me travaille, me choque : il y a une tension, un nœud que je dois résoudre !
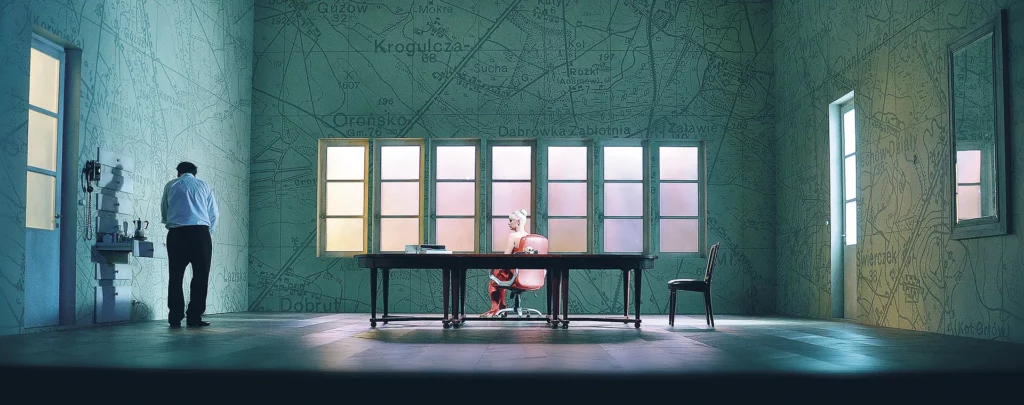
BD
Dans ta programmation du Théâtre des Martyrs, tu t’impliques beaucoup dans l’accueil de projets. La transmission joue pour toi un grand rôle…
Philippe Sireuil Quand on est en charge d’un théâtre, on se doit d’être curieux des autres, c’est une des nécessités du job. Jeune, j’ai bénéficié pleinement de l’intérêt que m’ont porté des aînés. Je m’efforce d’aller à la rencontre de celles et ceux que je ne connais pas, m’appuyant parfois sur des relais privilégiés. C’est par l’intermédiaire de Jean-Marie Piemme que je suis allé voir Reflets d’un banquet au Théâtre de la Vie et que j’ai offert à Pauline de le reprendre ; il ne s’agit pas d’un one shot, un projet Phèdre est en chantier pour la prochaine saison.
Pauline d’Ollone Il y a eu un pari de Philippe de prendre le risque de faire passer Le banquet de la petite salle du Théâtre de la Vie à la grande salle des Martyrs. Il a été un vrai partenaire artistique pour que le spectacle puisse se redéployer autrement. Résultat : il peut être diffusé. Et grâce à la reprise, le spectacle tournera ailleurs…
BD
Quelle est la part des « émergents » dans la programmation du Théâtre des Martyrs ?
Philippe Sireuil Le Théâtre des Martyrs ne peut être le lieu des premières fois. Il y a à Bruxelles des espaces plus appropriés qui, par leur gabarit, permettent le développement de premiers projets sans le souci explicite de l’audience. Le Théâtre des Martyrs qui héberge trois groupes artistiques résidents, n’a ni quota, ni missions définies qui soient tournées vers les artistes émergents. C’est affaire de rencontres, d’intérêts partagés, de sensibilités communes, la génération n’étant pas le seul critère : au cours de la saison 2018 – 2019, ont ainsi été présentés et/ou coproduits des projets d’Angèle Baux Godard et Clément Goethals (avec le Rideau), de Stéphanie Blanchoud et Daphné D’Heur, de Iacopo Bruno et de Salomé Crickx, de Justine Lequette (avec le TN), d’Héloïse Meire, de Virginie Thirion, d’Ingrid von Wantoch Rekowski, de Lorent Wanson, de Thibaut Wenger.
BD
Ce qui peut faire le lien d’une génération à l’autre ce sont aussi les acteurs…
Philippe Sireuil C’est d’eux que j’ai appris. La confiance que m’ont témoigné dès le début Janine Godinas, Gil Lagay ou Christian Maillet en me rejoignant, m’a véritablement porté, et fait grandir.
BD
Ce fut le cas de Janine Patrick pour Marc Liebens, de Pierre Laroche pour Philippe van Kessel, d’Idwig Stéphane pour Patrick Roegiers, de Claude Etienne pour Marcel Delval, d’Alexandre von Sivers pour Martine Wijckaert. Plus près de nous de René Hainaux pour Lorent Wanson et à présent d’Anne-Marie Loop pour toi Pauline…