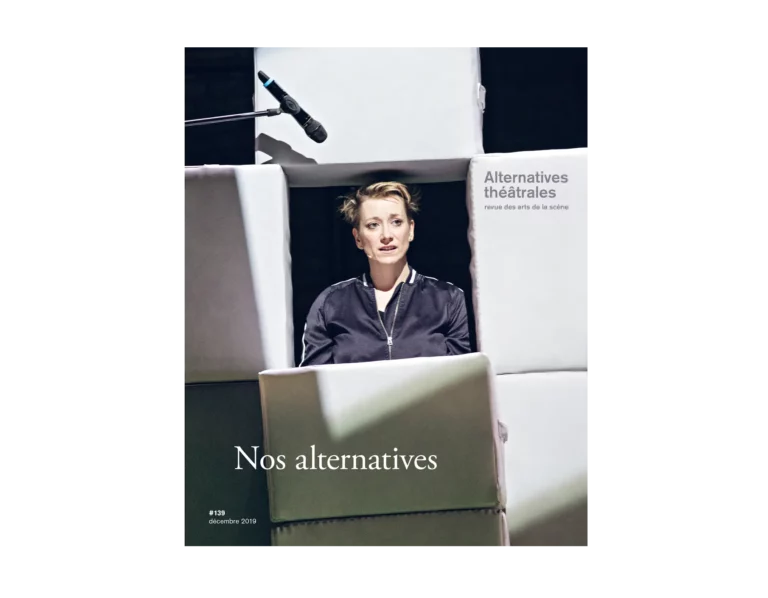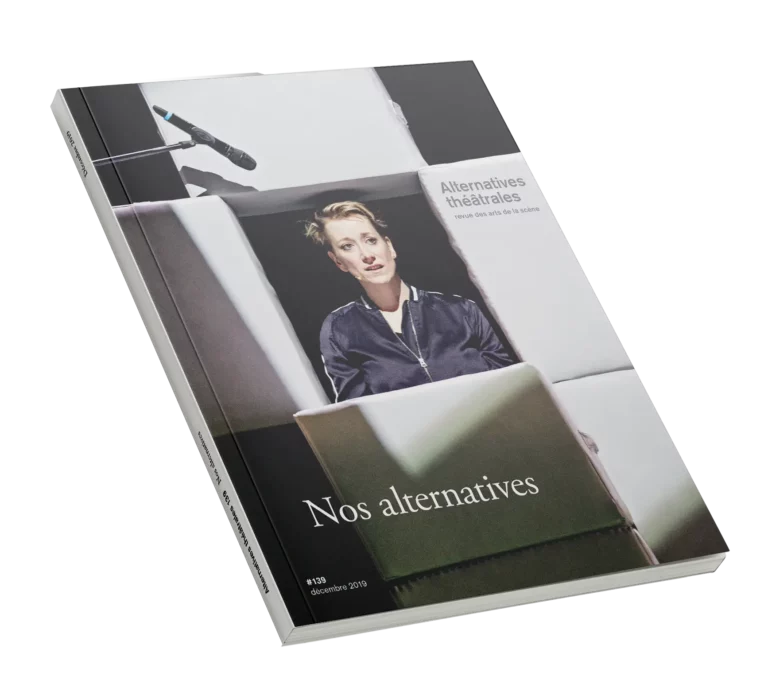CHANTAL HURAULT
Pourrais-tu nous raconter les débuts d’In Vitro ? Est-il né d’une impulsion collective ou d’un désir individuel ?
JULIE DELIQUET J’ai été à son initiative. Mon expérience de mise en scène ne me satisfaisait pas car j’avais le sentiment de perdre à l’abord de la représentation les enjeux du collectif. Cela m’habitait néanmoins et j’ai décidé de contacter une quinzaine d’anciens camarades, de manière très ouverte, pour retrouver la stimulation du faire-ensemble que l’on avait connue dans les écoles. Il s’agissait de nous rassembler autour de cette idée passionnante de la répétition et du désir de remettre la place de l’acteur au centre, quitte à ce qu’il n’y ait pas de postes à la lumière ou au son. Puis j’ai monté Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce avec six d’entre eux. Ont suivi d’autres spectacles pour lesquels je les rappelais jusqu’à rassembler cette quinzaine de personnes. Tout était donc en germe et s’est mis en place au plateau.
CH
Avez-vous eu besoin de penser ensemble des fondamentaux, d’écrire un manifeste ?
JD Nous n’avons pas intellectualisé ce que nous faisions. Si une charte est née entre nous, c’est uniquement au fil du travail. Ce que je peux dire c’est qu’au bout de sept ans, lorsque j’ai pour la première fois travaillé hors In Vitro pour monter Vania à la Comédie-Française, j’ai dû mettre des mots sur cette identité, expliquer une méthode. Je n’en avais pas eu besoin jusque-là puisque nous avions grandi ensemble. Je me suis également interrogée sur l’argent que l’on me donnait. Allais-je réaliser une scénographie, moi qui n’en avais jamais fait en bonne et due forme ? J’ai pris conscience qu’une identité existait, construite sur un manque d’argent mais qui correspondait à un choix auquel je devais rester fidèle. Je dirais même que de ce manque d’argent, nous avons fait un manifeste.
CH
Te sens-tu faire partie d’une génération ?
JD Je revendique avoir fait partie d’un mouvement, ce qui a été rassurant et jouissif. Avoir pu travailler dans des théâtres tel que celui de Vanves qui présentait les collectifs les uns avec les autres et non pas contre, a nourri un faire-ensemble quand nos parents l’ont peut-être éprouvé plus politiquement, après 1968. Le mythe des maîtres a perduré pour eux. La reconnaissance des trentenaires qui accèdent à des lieux subventionnés n’existait pas quand j’avais vingt ans.
CH
Dans cette génération qui vous a précédés, reconnais-tu des précurseurs ?
JD Le collectif des Possédés a été fondamental pour moi. Leur Oncle Vania a légitimé un théâtre libéré de ses fastes. J’ai été tellement transportée que je pensais ne jamais monter Vania car je ne pouvais pas le faire avec In Vitro. Je l’ai fait plus tard avec une autre troupe… Mnouchkine avait été un de mes grands chocs d’adolescence du point de vue de l’acteur. J’ai été fascinée par la pratique de l’écriture de plateau de Sylvain Creuzevault, sa façon de faire improviser ses acteurs sur des discours historiques tel que ceux du Comité du salut public pendant la Terreur. Enfin, si je suis loin de ses codes esthétiques, Frank Castorf m’a marquée pour l’insolence et la puissance des acteurs, la façon dont ils peuvent rompre la distance avec le jeu, avec le public. Ce furent des déclics qui ont animé mon regard de spectatrice, en me permettant de m’émanciper.