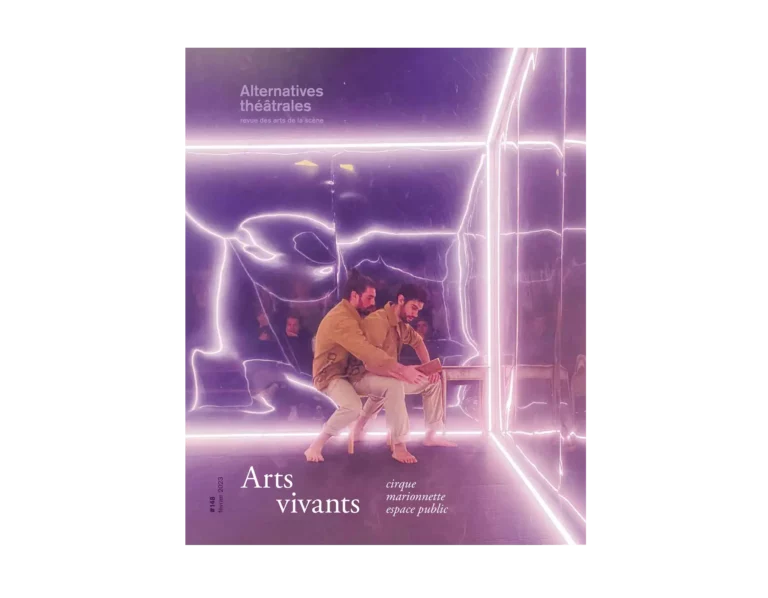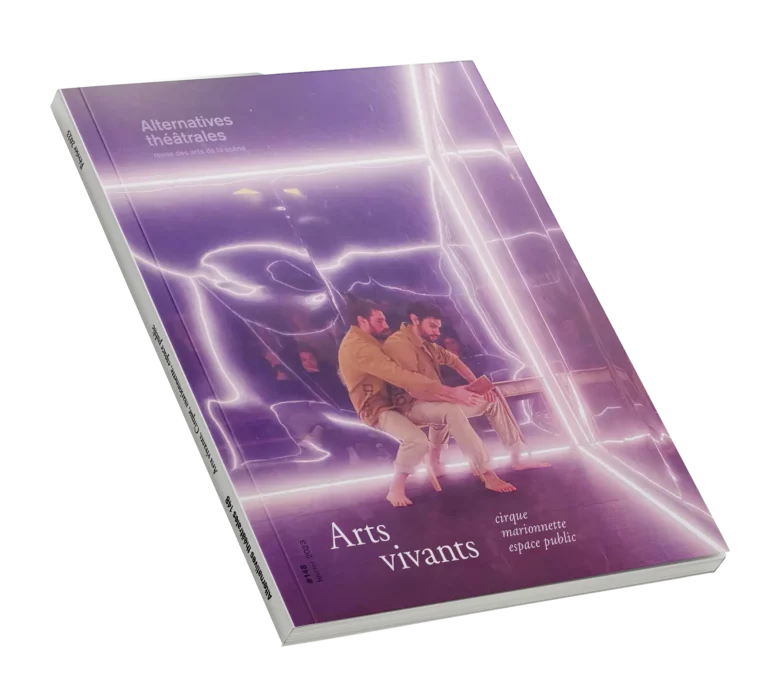Karel Vanhaesebrouck, l’expression « arts mineurs », utilisée en français pour désigner les formes que nous étudions dans ce numéro, est problématique. Vous êtes néerlandophone, quel mot utilise-t-on en néerlandais ?
Cette expression d’« arts mineurs » est vraiment très problématique et il est intéressant de l’examiner de près, car elle va droit au cœur des divergences entre Flandre et monde francophone autour de ces formes et de leur ancrage dans la société. En néerlandais, il n’y a pas vraiment de traduction de la notion d’« arts mineurs » ; on va parler de « populaire cultuur » mais ces mots recouvrent un territoire beaucoup plus large, celui de la culture populaire. En fait, pour parler du cirque, de la marionnette et de la création dans l’espace public, on dit toujours « podiumkunsten », les arts de la scène, comme on le fait pour le théâtre, la danse et l’opéra. La culture française a une conception centralisée et donc plus normée, plus hiérarchique, de la culture, et c’est de là que vient cette distinction entre majeur et mineur. En Flandre, on conçoit les différentes formes d’art scénique comme des langages artistiques ouverts et en circulation constante plutôt que des disciplines figées. En Fédération Wallonie-Bruxelles, comme en France, il y a un cloisonnement très fort dans la manière dont les institutions conçoivent les différents langages artistiques, avec des catégories de subsides bien distinctes pour le cirque, le conte, le théâtre-action, etc. Ce cloisonnement renforce une hiérarchie interne : entre la marionnette et le théâtre, ou entre le théâtre pour adultes et le théâtre jeune public, on va tracer des carrières différentes, avec des valeurs symboliques différentes.
Tous ces cloisonnements institutionnels génèrent des systèmes de valeurs hiérarchiques et donc de la violence symbolique.
En Flandre, il n’y a pas de catégorie de subsides à part pour les marionnettes ou la création dans l’espace public. Au lieu de cela, une compagnie va devoir se situer dans une des cinq fonctions suivantes : création, recherche, participation, programmation et réflexion. En d’autres termes, on se profile en fonction de la manière dont on veut contribuer à l’écosystème des arts de la scène en général plutôt qu’à une discipline particulière. Une seule exception : le cirque, qui bénéficie d’un décret à part, héritage de l’époque où Bert Anciaux était ministre de la culture. En 2008, Anciaux a voulu donner au cirque (et également à la musique populaire) un cadre décrétal spécifique pour que ces formes puissent se stabiliser et se développer à la fois dans leur dimension patrimoniale et de création artistique. Ceci a permis à des artistes passionnants, comme par exemple Circus Ronaldo ou Alexander Vantournhout, qui travaillent au croisement du cirque, du théâtre et de la danse, de développer des pratiques singulières, mais sans que ce soit aux dépens de circassien·ne·s qui pratiquent des formes plus traditionnelles. Il y a là un contraste très fort avec la France, où une hiérarchie symbolique entre différentes formes de cirque existe depuis les années 1980, avec le « nouveau cirque », qui se rapproche du théâtre (héritage des innovations à partir des années 1980), le cirque « traditionnel », et puis ce qu’on appelle le « cirque contemporain ». On assiste donc à une nouvelle institutionnalisation de l’avant-garde du cirque en France, avec une hiérarchisation qui pèse très fort sur le secteur, et qui est liée au pouvoir symbolique important d’une école comme le Centre national des arts du cirque à Châlons, qui décide à elle seule de ce qui forme le répertoire (notamment par le biais de reprises de spectacles iconiques du nouveau cirque). Indirectement, une institution décide ainsi de qui est « nouveau » ou « contemporain » et de qui n’est pas dans le ton. Cette volonté de catégoriser pour pouvoir institutionnaliser est bien moins présente en Belgique, parce que notre pays est décentralisé (et possiblement aussi parce que notre identité culturelle est trop caduque, ce qui nous donne une liberté joyeuse). Par exemple, Alexander Vantournhout jongle non seulement entre plusieurs formes, mais il est aussi actif dans les deux communautés, flamande et francophone, et son travail difficilement classable est un véritable casse-tête pour les programmateurs, notamment de lieux français, où l’on souhaite présenter chaque spectacle par des étiquettes de classification claire. On peut noter que c’est une des particularités du cirque dans le paysage culturel belge qu’il permet beaucoup de mobilité entre les communautés. On voit aussi du côté francophone une volonté de décloisonner qui passe par le cirque : par exemple, les Halles de Schaerbeek organisent depuis une vingtaine d’années le festival Hors Pistes, aux confins du cirque et de la performance, qui permet des rencontres entre des publics et des esthétiques variées. Malheureusement, la même chose n’est pas vraie de la marionnette, qui est peu présente dans les programmations et reste largement cantonnée à ses propres réseaux, malgré les efforts de certains lieux de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ces dynamiques sont-elles également présentes dans les écoles ?
Oui, complètement. Par exemple, du côté francophone, la marionnette fait l’objet d’une formation en master particulière au Conservatoire de Mons. C’est bien évidemment une très bonne chose qu’il y ait un programme spécifiquement dédié aux arts de la marionnette. Mais en même temps, je trouve dommage qu’il n’y ait pas de place pour cette forme dans les formations régulières, ce qui rend d’autant plus difficiles des pratiques (et donc des programmations) transversales qui incluent la marionnette. En Flandre, on opère avec une logique différente : dans les écoles, tout le monde, des comédien·ne·s aux metteur·euse·s en scène en passant par la régie, est vu comme « theatermaker », faiseur·euse de théâtre. En d’autres termes, on est toujours auteur·ice, et la responsabilité de la création est partagée entre les différent·e·s participant·e·s. Ceci ne veut pas dire qu’on travaille nécessairement en collectif, mais bien que la limite entre qui est un auteur·ice, créateur·ice ou interprète est floue : tout le monde est (co)créateur, quelle que soit sa filière. L’éducation passe beaucoup plus par une pédagogie de bricolage et beaucoup moins par une pédagogie de la maîtrise (du texte, du répertoire ou du registre comme c’est le cas en FWB ou en France). En Flandre, on considère que ce qui rend les artistes intéressant·e·s, c’est leur langage singulier. Il y a moins cette idée de « voilà le système, et on va vous aider à l’intégrer ».