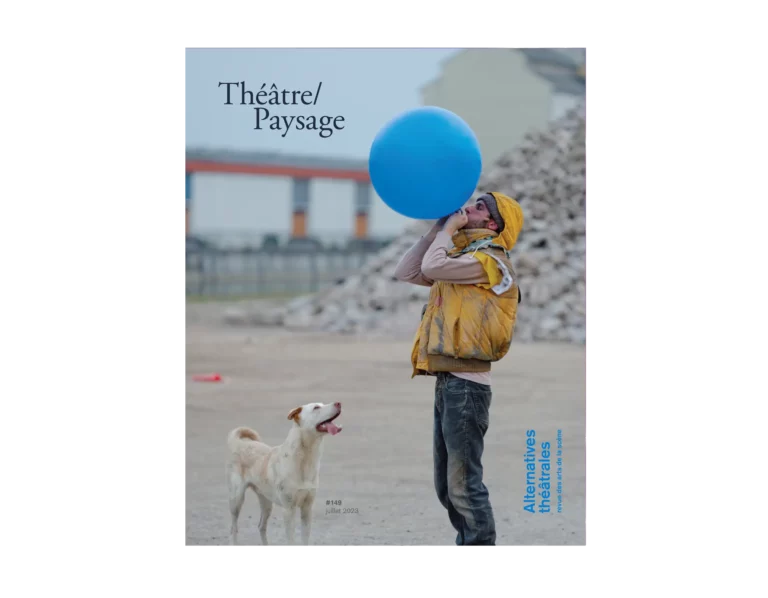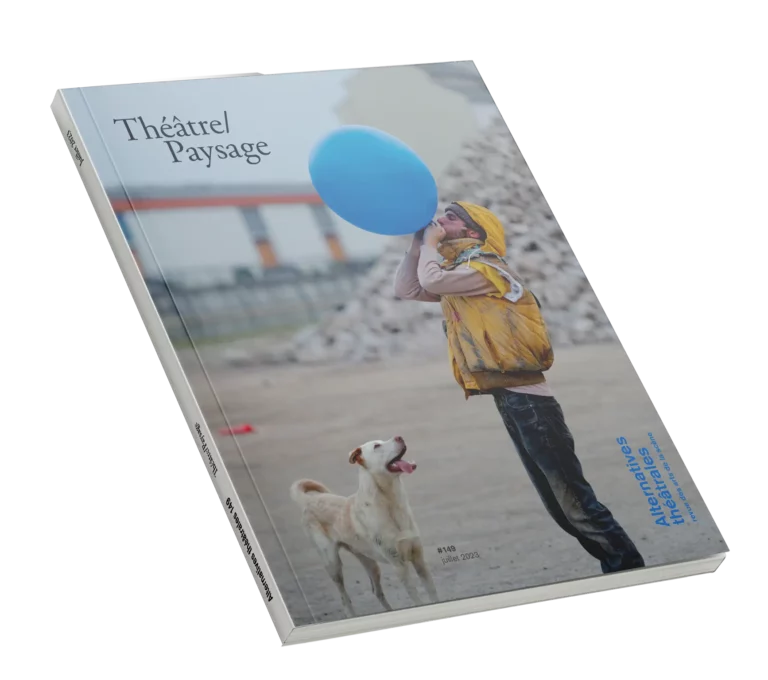Tu as une longue pratique théâtrale en extérieur, mais avec Que ma joie demeure il s’agit aujourd’hui de paysages non urbains. Qu’est-ce que cela change ?
Que ma joie demeure représente pour moi une nouvelle aventure après Les Trois Mousquetaires, La série – une saga de six spectacles en extérieur étalée sur six années de création – que j’ai mis en scène avec Jade Herbulot au sein du collectif 49701 et que nous avions co-écrit avec Romain de Becdelièvre, qui m’accompagne aussi sur cette adaptation du roman de Giono. C’est un nouveau défi : toujours faire du théâtre hors des boîtes noires, mais plus dans un contexte urbain. En ville, on fait du théâtre au sein d’architectures qui restent des cadres pour le regard ; ce ne sont certes pas les mêmes que ceux offerts par la cage de scène mais chaque fenêtre, chaque escalier, chaque porte avec lesquels on jouait pour les Mousquetaires restaient encore des éléments qui captaient le regard de la manière dont l’architecture peut le faire, dessinant des lignes géométriques qui font que l’œil et l’attention restent enfermés par un cadre, et cela même si dans les Mousquetaires on explosait tous les cadres, faisant changer le regard de direction en permanence, prenant le lieu à 360°. Là, en allant créer dans le paysage, on se rend compte que le regard n’est plus capturé spontanément : si on peut parler d’architecture du paysage, celle-ci est tellement plus vaste, et varie tellement avec la lumière, le relief, etc., que l’on s’y perd, visuellement, théâtralement donc, beaucoup plus vite que dans les villes.
On est donc confrontés à un nécessaire dépassement du cadrage, voire une impossibilité du cadrage ‒ relative car la mise en scène s’appuie malgré tout sur les lignes (plus ou moins discrètes) qui fabriquent le paysage. D’ailleurs, c’est intéressant : plus le lieu est redessiné par la main de l’homme (agriculture industrielle, grands champs rectangulaires infinis), plus c’est facile de penser la mise en scène, car on retrouve alors la logique géométrique qui depuis la Renaissance informe en profondeur notre manière de regarder les choses, notre perspective. On a déjà créé Que ma joie demeure dans trois endroits différents, et à chaque nouveau paysage il faut recommencer la création : dans l’Hérault, c’est-à-dire des paysages très méditerranéens, les plus sauvages auxquels on ait eu affaire, avec beaucoup de relief et peu cultivés, des espaces de jeu beaucoup plus petits qu’ailleurs ; sur la Côte d’opale, avec une culture beaucoup plus hégémonique, beaucoup de champs, de pâturages et d’aplats, et donc des lignes d’horizon qui apparaissent de manière très nette, et, comme il y a peu d’arbres, la présence très forte du ciel ; enfin sur le plateau de Saclay et la vallée de Chevreuse, un paysage plus hybride. À chaque fois des problèmes différents se sont posés.
Comment est venu le choix du roman de Giono ?
Je voulais continuer à faire le théâtre que j’aime, créer des épopées collectives en extérieur, mais en y invitant d’autres vivants, et en interrogeant les relations qu’on peut tisser avec ces derniers. J’ai alors cherché la matière littéraire qui me permettrait de prolonger et dépasser ce que l’on avait pu faire avec les Mousquetaires, en travaillant cette fois dans un dehors peuplé – habité d’autres présences vivantes. Et j’ai redécouvert Giono : des textes d’une prodigieuse qualité littéraire, un stylisticien extraordinaire, et un auteur qui sait faire parler le vivant. Il arrive à faire cette chose rare qu’on peut trouver chez certains réalisateurs, comme Terence Malick : chez lui, les personnages sont presque secondaires par rapport au paysage, qui n’est pas une image mais un monde qui bruit, qui vit. Giono s’attache à chaque perspective à l’intérieur de ce monde et c’est depuis cet intérieur pluriel qu’il parle. Par exemple, dans Que ma joie demeure, surgit un cerf à un moment de l’histoire : Giono embarque alors des pages durant le lecteur dans le point de vue du cerf ; un peu plus loin ce sera le point de vue d’une loutre… On n’est pas seulement face à un regard humain posé sur une image dont l’auteur décrirait les lignes et mouvements, on entre, d’une certaine façon, dans le « détail du monde », dans les perspectives de ceux qui le fabriquent.
Ce qui devient intéressant pour nous, acteurs, dans cette affaire, c’est aussi que chez Giono, les humains ne tiennent pas le premier plan de la fiction, et le paysage le second plan. C’est beaucoup plus riche et ambigu que cela. Les personnages humains sont des sortes d’éponges, imbibées des forces qui poussent dans le monde. C’est l’inverse de la projection romantique : ce sont les choses humaines qui sont les reflets du monde vivant qui les entoure, pas l’inverse. Il n’y a aucun intérêt à regarder les histoires de Giono d’un point de vue psychologique, même s’il crée d’incroyables personnages. Car ils sont toujours observés d’un point de vue plus éthologique que psychologique, autrement dit : ce sont des vivants parmi d’autres vivants, pour reprendre la formule de Baptiste Morizot, qui m’a accompagné dans ce travail. Par ailleurs, Giono silhouette des figures puissantes mais à un moment donné le fil dramatique s’effiloche, la psychologie se déconstruit, on ne sait plus trop où on est… les saisons passent, des métamorphoses ont bel et bien lieu, mais à une autre échelle de temps, beaucoup plus longue.…
C’est bien une autre échelle temporelle que propose le spectacle : par sa durée, le fait qu’il commence très tôt, presque à l’aube, et par l’expérience de la marche que sont amenés à faire les spectateurs entre les épisodes…
Oui, cette question rejoint celle de la marche, de la randonnée, qui est pour nous une traduction théâtrale de la force du temps dans les romans de Giono. Mais ce que la marche permet aussi, c’est le changement de paysage, de dispositif, de regard sur le territoire qu’on arpente. Quand on est dans un champ en friche, dans un sous-bois, dans le lit à sec d’une rivière, notre regard est modifié par la situation de notre corps dans le paysage. Être sur une crête, par exemple : ta vision est soudain panoramique, et ton vieux corps d’animal sait, sent, que tu es dans un état de regard sur le monde plein de cette sorte de maîtrise que donne la hauteur ; à l’inverse, dans des espaces à l’ombre et plus resserrés, on est dans une autre situation de corps, parfois presque à l’affût. C’est très intéressant de travailler avec ces intuitions-là, et d’essayer de faire voyager le spectateur d’une sensation animale à une autre. Quand on quitte la forêt et l’ombre pour entrer soudain dans une clairière ou une prairie, par exemple, il me semble que l’ouverture de champ, précisément, crée une sensation très forte, quelque chose comme une liberté, un appel, la possibilité du mouvement – presque une envie de galoper. J’adore imaginer cela pour le spectateur. Donc, on n’est pas seulement devant le paysage, on le traverse grâce à la marche. Et cette traversée implique des sensations bien différentes vis-à-vis du paysage que lorsqu’on est installés simplement « devant » lui ou « face » à lui comme devant une carte postale ou la toile de fond d’un décor.
Enfin la marche te met en mouvement ; elle fatigue, aussi. Comme elle implique la durée, le temps long, elle conduit à une expérience collective qui est teintée de cet effort physique, et de cette traversée singulière, dans un territoire singulier. Quelque chose de notre « théâtralité » va forcément s’épurer alors, se simplifier avec le temps et l’épuisement – à un moment donné on est juste là avec vous, dans cet état physique que l’on partage et qui nous rassemble. On bascule d’une certaine manière dans le temps présent et commun de la performance, qui prend le pas sur celui de la fiction. Mais c’est un marathon différent de ce que pouvait être Les Trois Mousquetaires : dans cette traversée « en pleine nature », pour le dire vite, il y a quelque chose qui non seulement se nettoie dans les formes, mais s’empare surtout de la question du corps, de notre corps vivant dans le milieu vivant qui l’a fondé, l’a nourri, l’a façonné au cours de l’évolution, et continue à le faire.
Jouer dehors, qu’est-ce que cela convoque comme rapport particulier au jeu ?
Il y a dans cette forme de théâtre, pour moi, un prolongement de l’enfance : on joue dans les collines, dans les forêts… Les Trois Mousquetaires, c’était déjà ça, avec la ville comme territoire de jeu. On se fabrique un terrain de jeu dans un lieu non dédié a priori au théâtre, un lieu qui vit, qui a son histoire propre. On y invente nos propres règles, et on entraîne le spectateur avec nous, dans le récit qu’on se raconte. Et comme il n’y a pas de « décor » importé dans les lieux, il faut tout inventer : « on dirait que » ce bâtiment c’est « chez d’Artagnan », que ce petit sous-bois est une vaste forêt, qu’ici c’est « le plateau Grémone » de Que ma joie demeure… On n’est jamais dans un rapport réaliste au paysage. À chaque fois on travaille avec des lieux qui ne sont plus, ne sont pas, n’ont jamais été les paysages racontés ; on leur redonne une qualification fictionnelle, et les deux jouent en permanence : le vrai et le faux coexistent. Par contre, ce rapport enfantin au jeu implique une dépense physique immense, une endurance : on passe nos journées dehors à l’infini… c’est une fatigue particulière. On parlait tout à l’heure du cadre du regard, mais c’est la même chose pour les acteurs lorsqu’on répète : sur un plateau, pour un acteur, il y a un sas et c’est simple : lorsqu’il entre sur le plateau il « travaille », il doit être concentré. C’est le noir et le silence qui donnent le cadrage. Mais en extérieur, en répétition, l’espace de jeu n’a plus de limite, et les acteurs ne savent plus forcément quand ils sont in ou off… Tout est in d’une certaine façon… Mais tout est off aussi. C’est troublant… et ce trouble peut créer beaucoup de fatigue… à moins d’être particulièrement discipliné, ce qui n’est pas mon cas !
Le spectateur peut éprouver un trouble du même ordre…
Un défi dramaturgique et de mise en scène qui se pose est donc celui de la fabrique de l’attention : comment tenir une attention de spectateur qui n’est pas celle d’un lecteur de roman, mais qui n’est pas non plus celle d’un spectateur dans une boîte noire dirigeant son attention. Dans un paysage tout est à regarder. On s’appuie sur une hiérarchisation de plans, bien sûr, mais aussi sur le texte de Giono, sur la parole vivante des acteurs qui le portent. Tous les acteurs sont en effet à la fois personnages, narrateurs et descripteurs – puisque l’enjeu est que le vivant ait une place de premier plan dans notre récit, il faut garder sa présence dans le texte et donc inscrire la description dans le jeu. Mais, malgré tout, l’attention continue à fuir, et quelque chose échappe en permanence. Le tourbillon de l’attention est concentrique dans une salle de théâtre, il s’y condense et fabrique de l’intensité émotionnelle, mais quand il n’y a plus de lieu théâtral, et lorsqu’en plus il y a de la marche entre les séquences de jeu, il se disperse, devient centrifuge. Il faut donc une architecture dramaturgique forte, un dispositif très clair à chaque fois. Mais cadrer plus, trop discipliner l’attention du spectateur serait aussi contreproductif, puisque c’est cette porosité qui est recherchée. Un mot, un geste, dans le paysage s’évanouit aussitôt prononcé ou exécuté : est-ce cet évanouissement qu’il faut travailler et assumer complètement ? À quel point faut-il se doter de points d’appuis pour capturer l’attention ? C’est un équilibre de forces à trouver, entre le paysage, les vivants qui l’habitent, les acteurs, et le texte, pour réussir à créer une expérience intense, émouvante, et finalement, par une autre voie que la voie romanesque, rejoindre cette espèce de vitalisme – païen, panthéiste, nietzschéen – qu’on trouve chez Giono.
Il y a chez lui des moments qui me bouleversent d’une manière inhabituelle, des émotions que l’on n’éprouve plus dans la vie parce qu’on n’est plus dans de telles relations avec le vivant : comme celle de traverser un bois seul(e), et de rencontrer un cerf. Des moments qui à l’échelle de notre vie d’homme ou de femme d’Occident sont des exceptions par rapport aux expériences psychologiques comme le deuil ou l’amour : on tombe plus souvent amoureux dans une vie qu’on ne voit un cerf dans un bois… Comment fabriquer de la présence alors, rendre sensibles pour le spectateur des choses qui ne le sont plus ? Comment faire que le monde redevienne sensible ?
Ce qui est aussi délicat, c’est que ces questions sont souvent polluées par des milliards de discours écologico-poético-didactiques où la sensiblerie guette dès qu’on parle de telles sensations ; or le vivant, ce n’est pas une petite chose mignonne à protéger, ni le miroir de nos psychologies meurtries par le monde industriel, ni non plus un simple décor matériel… Comment lui faire une place, alors qu’on sait à peine de quoi et de qui on parle ? Et comment lui faire une place dans une forme d’art qui est essentiellement et fondamentalement anthropo-narcissique, comme le théâtre ?
On cherche le chemin, comme un sentier ancien, perdu dans la forêt…