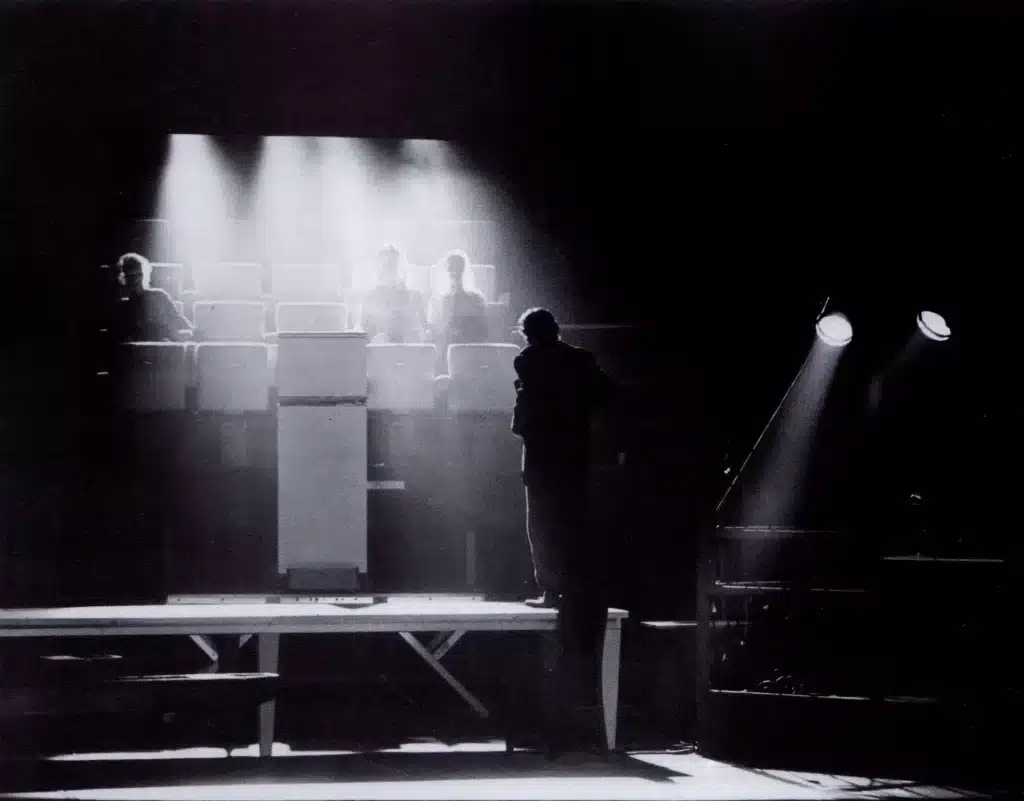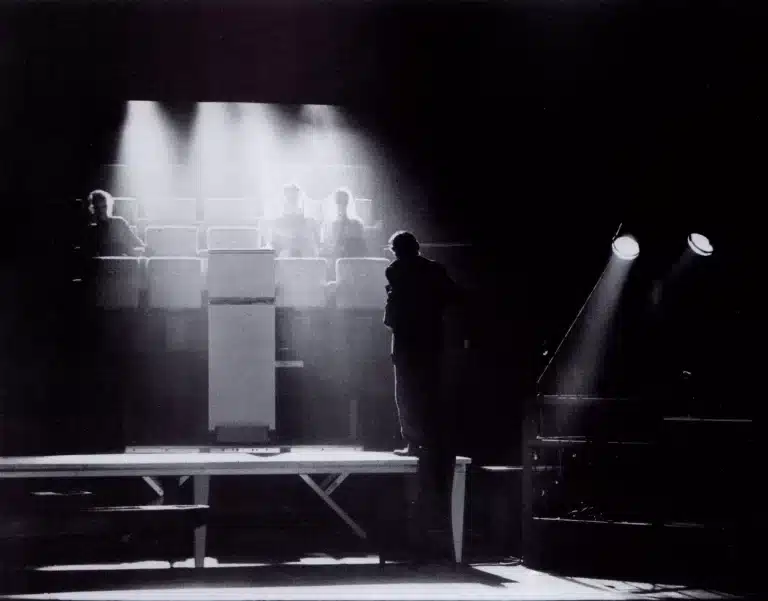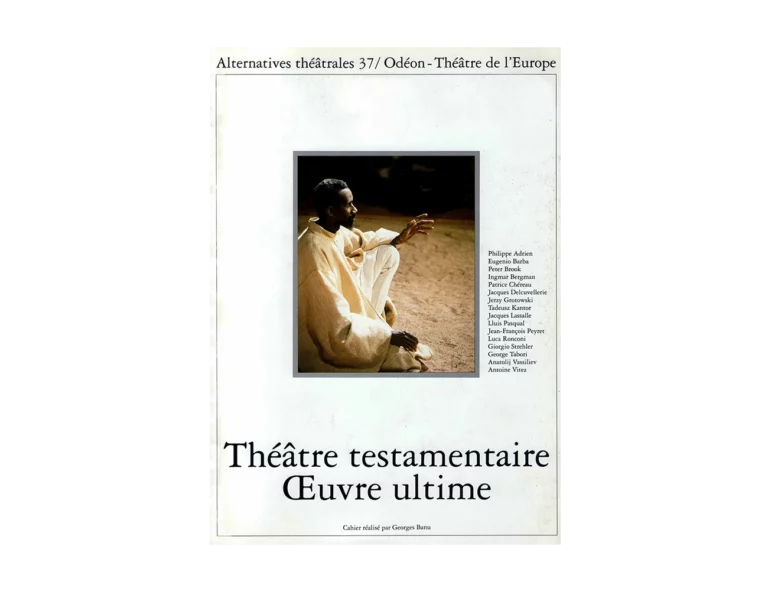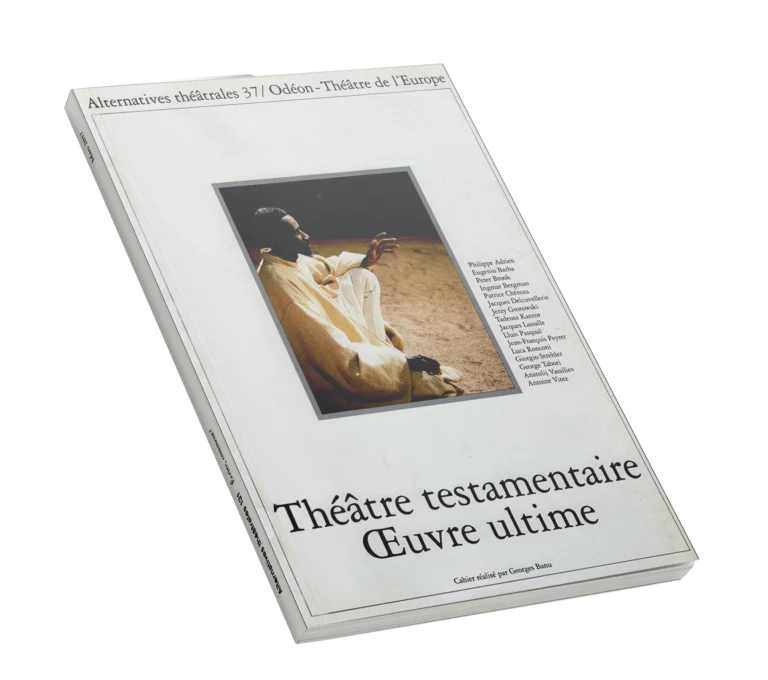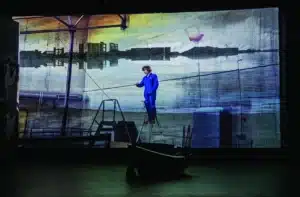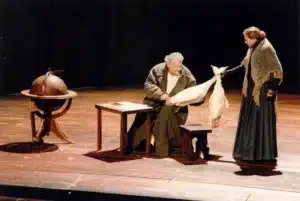JEAN-FRANÇOIS PEYRET : À propos d’HAMLET MACHINE que nous venons de monter, on ne peut parler de théâtre testamentaire, ni de beau testament (le côté baroud/bras d’honneur) ni de la fin d’une œuvre. D’abord parce que Müller n’a pas cassé, comme Prospero, son bâton de magicien ni sa pipe. Et puis HAMLET-MACHINE n’a rien d’une œuvre ultime puisqu’elle date de la fin des années soixante-dix et que Müller a pas mal écrit depuis, au demeurant, l’essentiel des textes par lesquels il est connu ici. Mais, de fait, la pièce traite de la fin de quelque chose. En vérité de deux choses : la fin (ou le blocage, l’arrêt de mort) du communisme (réel) et, corollairement sans doute, la fin du théâtre (d’un certain théâtre). Müller, considérant que le communisme est le vrai et seul matériau ou sujet tragique du XXe siècle, tout son théâtre est une entreprise pour donner représentation ou figure à cette catastrophe, surtout dans la mesure où l’Allemagne est prise dedans. Schéma tragique, celui du renversement du bonheur au malheur : comment on passe de la Révolution à la Contre-révolution ; comment on passe de Rosa Luxembourg à la RDA, et à la mort de la RDA, le héros tragique par excellence du théâtre müllerien. Ou encore : comment on en arrive à ce que l’on pourrait appeler, par une alliance de mots, la dialectique tragique des chars, ces chars qui sauvent le communisme en 1953, 1956, 1968, mais, le sauvant, le tuent. L’achèvent, si on veut.
HAMLET-MACHINE est un moment important du parcours. L’hamlétisation des événements de 1956 à Budapest permet de donner forme, existence théâtrale, au déchirement dans lequel est pris le communisme qui est des deux côtés : du côté du soulèvement populaire en tant qu’il est révolutionnaire et émancipateur, en tant qu’il est la Révolution et du côté de la répression par les chars en tant qu’ils sont les représentants du communisme réel, de la Contre-révolution. Hamlet est condamné à l’inaction (son drame n’a pas lieu). Et Hamlet ce n’est pas tel ou tel, pas Müller en tout cas, contrairement à ce qu’on a pu croire ou ce qu’il a peut-être cru lui-même, Hamlet, si l’on tient absolument à ce que ce soit quelque chose, c’est le communisme lui-même. Aujourd’hui, on ne peut dire évidemment que la pièce prophétisait les événements tels qu’ils se produisirent, mais elle permet de saisir une image désormais du passé (qui n’est plus d’actualité), image comme immobile sur le seuil de notre présent ; elle permet l’intuition d’une situation particulière ouverte par la fin d’une histoire (et non la fin de l’Histoire) par ce que peut être ou ne pas être l’après communisme. Elle montre le cadavre de ce communisme-là après Budapest et comment il peut se décomposer et comment aussi on le laisse sans sépulture. La mort de ce communisme-là était comme programmée par l’œuvre ; elle était esthétiquement programmée mais, encore une fois, pas historiquement « prévue ». Müller n’est pas devin. Il montrait que le communisme était fini mais aussi qu’il pourrait bien n’en pas finir de finir. La situation était encore plus bloquée à la fin des années soixante-dix, particulièrement en RDA (nous sommes après l’affaire Bierman). On ne pouvait pas imaginer de solution, de résolution. C’est l’aspect fin de partie de HAMLET-MACHINE. C’est fini et ça n’en finira pas de finir. Müller regarde le cheminement des vers dans le cadavre mais ce corps en décomposition est en même temps pétrifié, momifié. Ça pouvait durer.
HAMLET-MACHINE marque aussi la fin d’un certain théâtre, d’une certaine théâtralité de l’Histoire et du coup de la Révolution : la fin de la théologie de la Révolution marque la fin de la dramaturgie de la Révolution. Ce qui a des conséquences formelles importantes pour l’œuvre de Müller. Hamlet-machine inaugure quelque chose par sa rupture formelle avec le théâtre müllérien précédent. Abandon de ce qu’on pourrait appeler la forme-théâtre, fable qui se développe, même si c’est de manière plus brechtoïde qu’aristotélicienne, forme dialoguée. Dans toutes les pièces précédentes et surtout les pièces dites de la « production », des traits annonçaient cette rupture, signalaient des fractures, mais avec HAMLET-MACHINE, le saut est accompli. Et un saut dans l’épique, le narratif : « J’étais Hamlet », etc. Seule LA MISSION reviendra à ce que j’appelle cette forme-théâtre mais comme pour un adieu à cette théologie/ dramaturgie de la Révolution. C’est peut-être cette pièce qui serait vraiment testamentaire .. .
Georges Banu : Le spectacle offre l’image d’une fin violente, la fin des pères du marxisme, la chute de leurs statues. Cette image emblématique est celle d’un arrêt brusque que je perçois comme pouvant s’inscrire dans cette galaxie du communisme, comme Barba finissant TALABOT avec des déchets, ce qui reste ce ne sont que les déchets des années soixante —dans HAMLET-MACHINE, il y a les bustes qu’on a vus longtemps sur les bureaux dans les pays de l’Est et qui sont là fendus et ensanglantés.
J.-F.P. : Si on y regarde de près, il n’y a pas, après l’épreuve de la peste (peste à Buda), celle du soulèvement impossible, celle de Budapest où le narrateur-Hamlet (qui, en bon Hamlet, est Hamlet et n’est pas Hamlet …) fait l’expérience d’un déchirement schizophrénique (il est à la fois du côté de la foule et dans la tourelle du char, etc), comme issue, sortie, comment dire?, ligne de fuite ? Seulement le geste raskolnikovien de planter des haches dans les crânes de ces trois vieilles usurières du communisme que sont Marx, Lénine, Mao. C’est seulement une de ces hypothèses : tuer les spectres, s’en prendre à eux et se venger sur eux de l’échec du communisme. Nous connaissons. (Simplement il y a des haches plus ou moins matérielles, plus ou moins théoriques). C’est un des effets de la mort du communisme : des Hamlet-Raskolnikov plantent des haches dans les têtes des pères fondateurs. Mais ce n’est pas le seul effet de cet arrêt de mort du communisme : il y a la sortie terroriste (ici marquée par Electre, celle qui traversera nos chambres avec des couteaux de boucher) mais aussi l’effondrement dans le rien, dans l’ère du vide : on rentre chez soi et on regarde la télévision, cette grande déterreuse de spectres. HAMLET-MACHINE pointe cette chose décisive pour nous aujourd’hui : la « sortie » hors de la dramaturgie de l’Histoire (ou sa théâtralité) est une rentrée dans la vision (ou absence de vision) médiatique de l’Histoire. Dans l’impossibilité de vivre son drame dans le soulèvement de 1956, Hamlet rentre chez lui et regarde la télévision. C’est en ce sens que la pièce a une énergie actuelle, pour maintenant, et qu’il y a peut-être quelques raisons de la monter aujourd’hui, et d’en faire un autre usage qu’il y a onze ans quand Jourdheuil la créa. Elle est à la couture de ce passé (le communisme, sa mort, son cadavre, son spectre) et de notre présent qui est confronté à cette question : que reste-t-il après le retrait des grandes dramaturgies, des grandes visions dramaturgiques de l’Histoire, de la vie qui s’achèvent par hamlétisation ? Peut-être même pas des mots, des mots, des mots, mais ce qui est pire encore, des images, des images, des images et, par surcroît, des criminels, des Raskolnikov. Les grandes dramaturgies meurent sans laisser d’autre testament que l’œuvre de Dostoïevski. HAMLET-MACHINE nous dirait aujourd’hui quelque chose dans cette direction.
Est-ce que cela a un rapport avec l’idée de déchet ? Oui, si les spectres sont des déchets parce qu’ils sont ce qui reste ou ce qui revient de ce qu’on croit mort ! À mon avis ces coups de hache confirment plutôt l’idée d’un testament impossible, ou plutôt introuvable. L’injonction des pères, ce qu’ils donnent en un sens à hériter est intenable. Là réside une autre lecture du thème hamléticoraskolnikovien. Il n’y a pas de testament ; voilà pourquoi l’héritier est (devient) un assassin (comme papa ?). Comment hériter de ce qui ne passe pas ? Le testament serait censé assurer le passage, la passe, la passation. Mais comment faire passer ce qui ne « passe » pas ; que les pères soient criminels (tout autant que les oncles qui ne sont que leurs doubles mimétiques) ? Mais voyez Raskolnikov ne peut pas hériter de Napoléon : tuer l’usurière n’est pas dans le testament de Napoléon. Donc ce testament ou cet héritage n’ont plus de sens. Et il n’y a rien de pire que cette forme d’impossibilité du testament. C’est sans doute ce qui arrive avec notre héritage dans lequel le communisme, malgré qu’on en ait, est un gros morceau : on ne sait plus quel sens lui donner. Même pas de travail de deuil : on laisse le cadavre se décomposer en feignant de l’oublier parce que la télévision (dont la dramaturgie n’est pas le fort) a déjà autre chose à s’occuper !