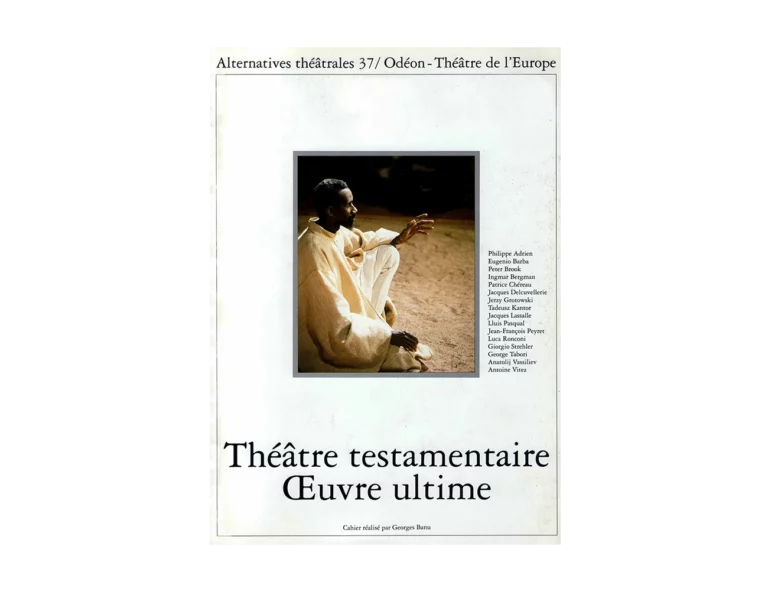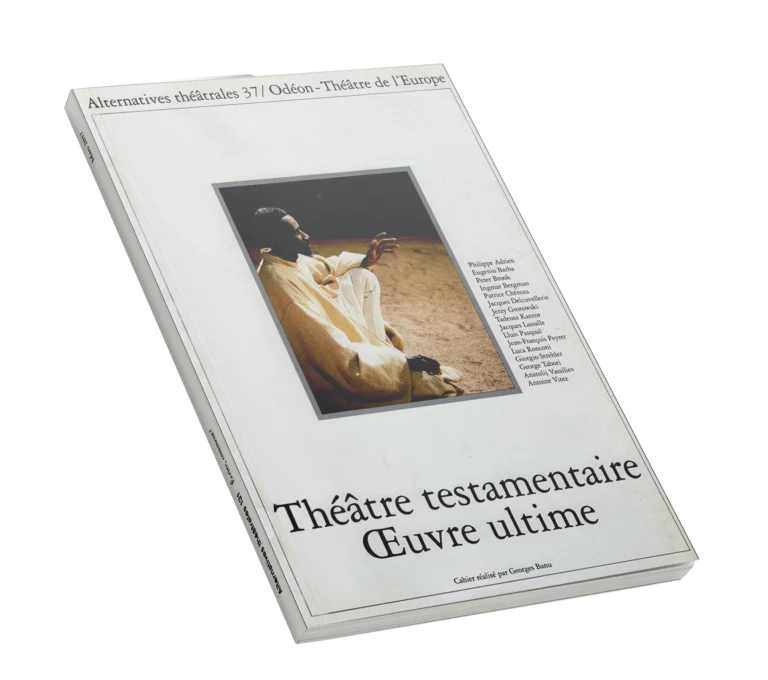ŒDIPE À COLONE est incontestablement l’ultime pièce de Sophocle. Il l’écrit à l’âge de quatre-vingts ans et meurt peu après. Elle ne sera jouée qu’après plusieurs années et remportera le premier prix du concours des tragédies. C’est la plus longue des tragédies grecques connues. Au lieu des trois acteurs traditionnels, elle en exige probablement quatre pour être jouée. Son sujet est la mort d’Œdipe, derrière laquelle il faut sans doute voir en filigrane la mort de Sophocle lui-même. À plusieurs reprises, elle affirme qu’Œdipe n’est pas vraiment responsable des crimes que mettait en scène la tragédie, bien antérieure, d’ŒDIPE ROI. Le dernier Œdipe, certes criminel, n’en est pas moins admirable et manifeste ainsi l’ambivalence du sacré. Son corps même est un enjeu politique considérable, car un oracle a prédit que le pays où il mourrait obtiendrait la victoire. Mourant, Œdipe dispose donc de deux pouvoirs de portée internationale : il peut protéger Athènes contre Thèbes, ce qu’il accepte, ou protéger Thèbes contre Argos, ce qu’il refuse. Thèbes, sa patrie, est donc condamnée. Par l’élection divine, l’individu s’est désolidarisé de sa cité. Sa mort est ainsi le lieu du problème le plus vaste et le plus émouvant.
LA TEMPÊTE est-elle la dernière pièce de Shakespeare ? Ce n’est pas évident. La date de sa création est tardive, mais incertaine : 1611 ou 1612. Shakespeare ne mourra qu’en 1616. Mais un HENRI VIII a été joué en 1612 ou 1613. Toutefois, il n’est peut-être pas de Shakespeare. L’incertitude chronologique nous contraint à admettre que la position de LA TEMPÊTE comme ultime est moins attestée que mythique ; comme telle, elle jouit d’un assentiment universel. Cette contradiction ultime — non ultime est loin d’être la seule. La structure de la pièce abonde en contradictions non résolues. Tragédie ou comédie ? La pièce est en général classée comme comédie, mais les éléments tragiques n’y manquent pas. L’action ne dure que trois heures, non par un souci de concentration alors inconnu, et pourtant, pas plus qu’avant, la cohérence n’est recherchée ; y est substituée une démarche pleine de loisir. Le poétique et le comique s’y juxtaposent et s’y entremêlent, bien plus que dans l’œuvre antérieure. Même duplicité au niveau des personnages : il y a à la fois Ariel et Caliban, et ce dernier est lui-même dédoublé en deux images, une belle, dont il se vante, celle du colonisé, et une vilaine, formée et répandue par le colonisateur. La contradiction ainsi érigée en principe s’avère confortable. Shakespeare la manie avec une souveraine aisance. En renonçant à la magie, Prospero se met lui-même en question. La fantasmagorie était l’âme de la pièce et son abandon signifie la fin du théâtre. Les dieux déchus n’ont plus qu’à entrer dans un crépuscule wagnérien, justifiant ainsi que LA TEMPÊTE soit ultime.
La dernière pièce que Corneille ait écrite est la tragédie de SURÉNA. Son héros, général parthe, a sauvé le royaume, et le roi Orode veut, pour se l’attacher autant que pour le récompenser, qu’il épouse sa fille. Mais Suréna aime ailleurs et préfère se laisser tuer par son roi plutôt que renoncer à son amour. Ce sujet est traité avec autant d’austérité dans la rigueur que dans la passion. Il prêtait à des évocations pittoresques, que Corneille n’avait pas méprisées dans ATTILA. Plutarque disait que Suréna avait toujours avec lui mille chameaux pour ses bagages et deux cents chariots pour ses concubines. Corneille, lui, a évité à ses personnages tout mouvement inutile. Ne se divisant qu’en dix-huit scènes, la pièce est la moins découpée de toutes ses œuvres. Le lieu, comme souvent, est un palais ; mais ce palais est hermétiquement isolé du monde extérieur ; aucune opinion publique, aucune émotion populaire n’y parviennent jamais ; il n’est que le lieu abstrait d’une expérience dramaturgique. L’action, subtile et insistante, est impitoyable comme un théorème. Mais SURÉNA est aussi une tragédie d’amour, justement parce qu’il ne triomphe que par la mort. Corneille a soixante-huit ans quand il l’écrit. Pour ses personnages, l’amour, bien que condamné par le pouvoir, inutile et même dangereux dans le contexte politique, est la valeur suprême. La tendresse, le dialogue brûlant de passion contenue, malgré ou à cause de la pudeur de l’expression, illuminent toute l’œuvre d’une flamme nouvelle. Le vieux poète est-il ébranlé par un intérêt jamais avoué pour les créations de son jeune rival, ce Racine qui vient de faire jouer son Iphigénie ? Il ne renonce en tout cas ni au réalisme politique le plus cruel ni au sentiment le plus ardent. Mais le mélange de ces deux ressorts allait se révéler détonant.
Par cette structure, SURÉNA abandonne la tentative machiavélienne de mettre l’amour au service de la politique, qui avait si souvent servi Corneille dans ses œuvres antérieures. Ici, le pouvoir triomphe du sentiment sans lutte apparente. Il l’immole en silence, par une sorte de nécessité naturelle. Au niveau politique, le drame est aussi élevé qu’à celui de l’amour. Orode n’est pas plus méchant ni plus perfide qu’il ne faut. Il est conscient de la nécessité politique de la soumission ou de l’élimination de Suréna. Aucun accommodement n’étant possible, le problème, de politique, devient militaire. Suréna dispose de l’armée. On a su le faire entrer, seul, dans le palais ; par une ruse semblable, Athalie sera attirée dans le Temple des Juifs. Une « main inconnue » lui lance la flèche mortelle. Avec lui meurt l’éthique de la gloire, naguère triomphante.
Pouvait-il en être autrement ? Bien analysée, la situation ne permet aucune action. Un étrange non-agir s’installe, curieusement hérité des tragédies de la lamentation du XVIe siècle. On ne peut ni agir ni même parler ; on ne peut que mourir. De fait, le drame sentimental et le drame politique convergent vers la même solution. Que Suréna soit tué par un agent du roi ou qu’il meure de désespoir pour avoir accepté un mariage dynastique, la mort est au bout de toutes les avenues. Naguère, elle n’était qu’une menace aléatoire ; elle est maintenant inéluctable. Aussi la tragédie, dès son premier acte, est elle un hymne funèbre. Les personnages ne luttent plus ; ils chantent l’acceptation de la mort. Une conception si radicale ensevelit la tragédie sous sa propre ruine. SURÉNA est bien une œuvre testamentaire.