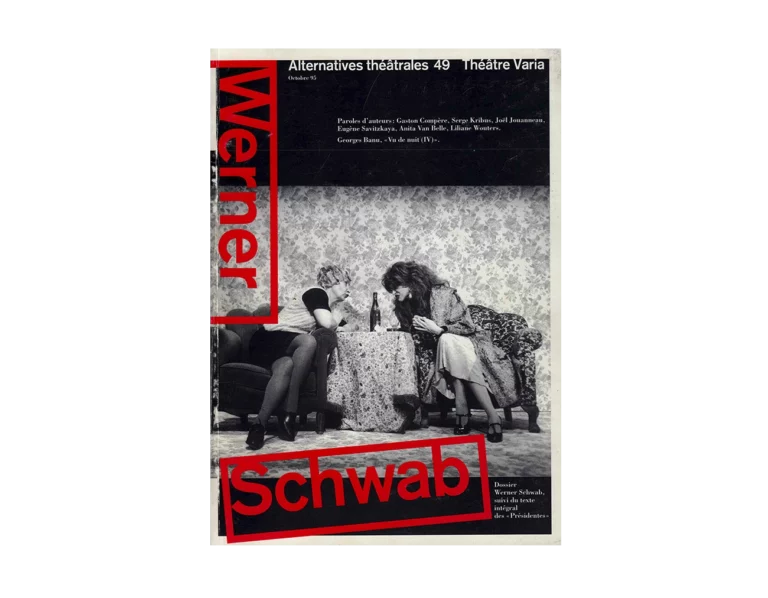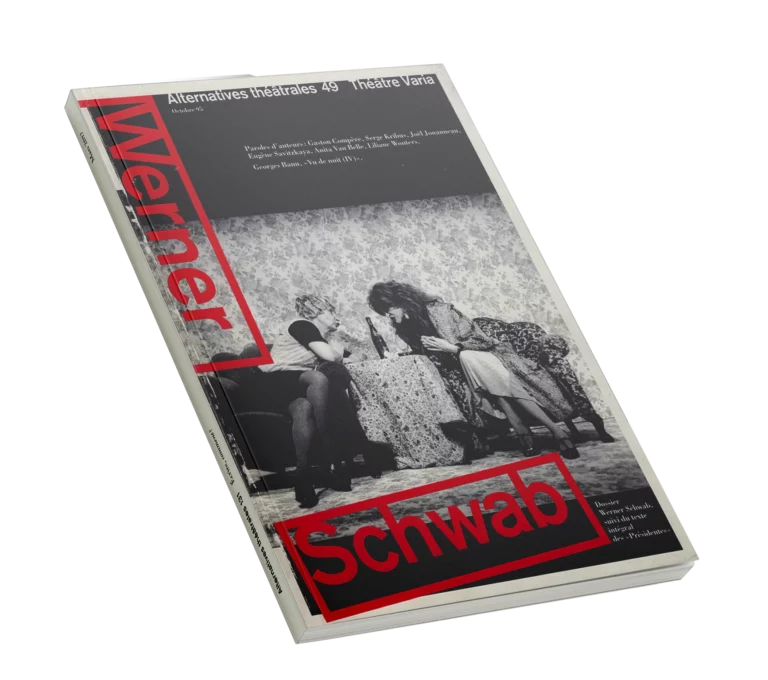11
« Sans questions, sans musique ! Je ne connais de belle absence de questions, que dans la fatigue… Jadis l’avenir n’était-il pas un continent ? Et la question des questions, en tout cas de mon temps, ‘Que devons-nous faire?’. Et pourquoi ce continent est-il de nos jours réduit à ton, à mon ilôt-questions : ‘Que dois-je faire moi, moi tout seul?’ (…) Qui pourrait appeler les temps actuels une époque ? »2
D’UN COTÉ, la Culture, celle que l’on dit de « masse », avec sa bonne santé, ses humeurs médiatiques, ses messages politico-pédagogiques, sa bonne foi désarmante, et son instinct grégaire : « Pendant que le public s’installe, on entend la retransmission d’une messe, que le Pape célèbre avec une masse quelconque. »3
D’un côté, « Toutes les institutions officielles du langage » qui « sont des machines ressassantes ; l’école, le sport, la publicité, l’œuvre de masse, la chanson, l’information, redisent toujours la même structure, le même sens, souvent les mêmes mots. »4 De l’autre, l’envie irrépressible de saper l’ordre moral, le besoin impérieux de tromper l’ennui avec l’horreur, l’obstination à vouloir surprendre la trivialité en débridant les plaisirs les plus pervers.
« D’où la configuration actuelle des forces : d’un côté, un aplatissement de masse (lié à la répétition du langage) et de l’autre, un emportement marginal, excentrique, vers le nouveau – emportement éperdu qui pourra aller jusqu’à la destruction du discours. »
C’est la représentation graphique que l’on pourrait faire de l’écriture de Werner Schwab et de celle de quelques autres. Une écriture qui, sous les apparences d’un réalisme affligeant qui mime fidèlement notre quotidien social, laisse percevoir des possibilités de belles échappées. Autant dire déjà que c’est dans ces possibilités, que cette écriture nous étonnera et nous arrêtera, car si la ligne, pour reprendre l’exemple du graphique, nous donne à voir le dessin général, c’est le point (croisement des données et des valeurs) qui nous donnera à comprendre. Au trait, on finira par préférer le signe symptomatique où se rejoignent et se nouent toutes les tensions : « L’artiste doit forcer la vision de la catastrophe, de sorte que le spectateur soit tellement touché par la réalité décrite qu’il développe sa propre énergie de résistance »5
Accumulant et reprenant les poussées de fièvre d’une société que beaucoup jugent « malade », les textes de Schwab, de Berkoff, ou de Magnin, et dans une autre mesure, Gabily ou Bond, nous font les témoins obligés d’une lente déformation du quotidien, vers ce qu’il a de plus vulgaire ou de plus monstrueux mais sans jamais vraiment céder à la violence pure, c’est-à-dire à la souffrance pure. On tue, on viole, on mange sa merde avec la plus douce des banalités et dans un sentiment quasi parfait de moralité bourgeoise :
«ERNA : Quel calme peut régner dans du sang rouge comme ça … J’ai toujours pensé que, lorsqu’on est mort, tout est sens dessus dessous dans un être mort.
CRETE : Et qu’allons-nous faire de celle-là, maintenant ?
ERNA : On l’enterre dans la cave, parce que les gens distingués aussi disent toujours : dans ce pays, chacun cache un cadavre dans sa cave. »6
La dérive progressive vers l’excès semble être, aujourd’hui, l’unique recours ou le seul moyen pour se sauver de ce qui ne nous convient pas, mais en attendant, il faut bien dire quelque chose sur le monde comment il va. Et pour parler du monde, on laisse dire les « gens », et très souvent les « petites » gens. Marie, Crete, Erna ou Sybil, Steve ou Thom n’en finissent pas de se ressembler : passifs, un petit peu déracinés, un petit peu inaptes au bonheur, un petit peu stériles ou génétiquement dangereux, un petit peu ennuyeux, apatrides, athées, a‑politiques et historiquement amnésiques. Le tout dans une incapacité généralisée, qui les plonge dans une stupeur apathique de laquelle on se demande, très souvent, comment et avec quoi, ils pourront bien s’extirper. « En cette fin de siècle, la plupart des jeunes femmes et des jeunes hommes grandissent dans une espèce de présent permanent, dépourvu de tout lien organique avec le passé public qui a pourtant façonné les temps actuels. »7