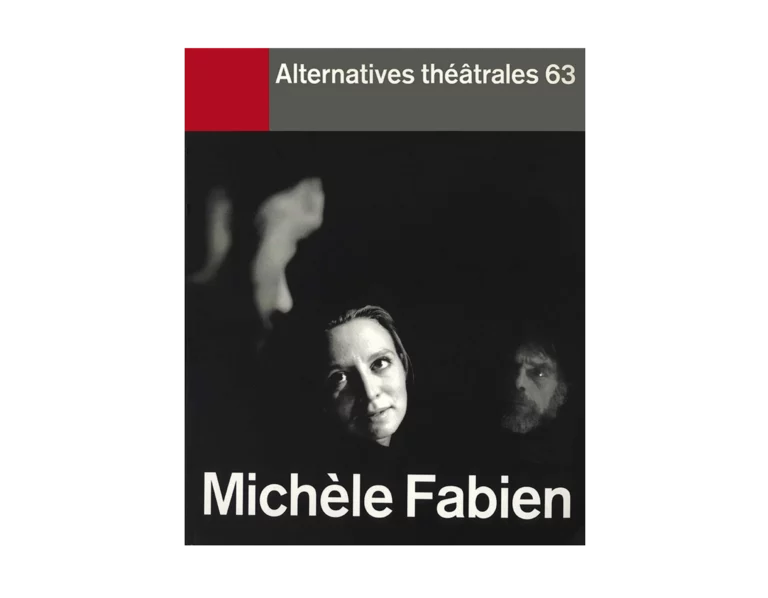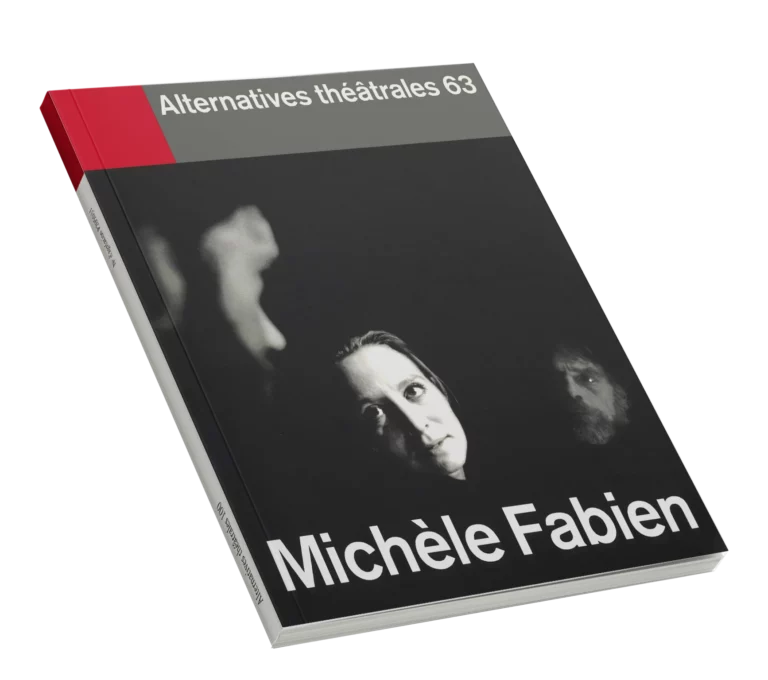FESTIVAL D’AVIGNON 1975. Théâtre Ouvert : Micheline et Lucien Attoun ont invité Marc Liebens à présenter ma pièce LE TRAIN DU BON DIEU aux Pénitents Blancs. Ils sont onze acteurs et actrices : Jean-Luc Debattice, Nicolas Donato, Janine Godinas, Claude Koener, Gil Lagay, André Lenaerts, Hubert Mestrez, Janine Patrick, Guy Pion, Philippe Sireuil, Philippe van Kessel… et Michèle. Michèle actrice ? Oui. Elle jouera notamment le rôle de « la vieille ». Elle assurera la dramaturgie avec Jean-Marie Piemme. C’est Armand Delcampe qui prendra la publication de la pièce dans les Cahiers Théâtre Louvain n° 2. Michèle a‑t-elle voulu elle-même faire partie de l’équipe d’acteurs et d’actrices ? Est-ce Marc Liebens qui le lui a demandé ? Je ne sais plus. Peu importe. À ma connaissance, elle n’avait pas une formation d’actrice. Je la regarde, je l’écoute jouer. Qui joue en elle ? Elle joue quoi ? LE TRAIN DU BON DIEU sans doute — l’histoire d’une grève générale. C’est là, assis dans les gradins des Pénitents Blancs que je me dis : « Un jour Michèle va écrire, ce n’est pas possible autrement. » Car il y a de la surchauffe, de l’excès, du trop dans son jeu. J’ai su là qu’elle écrirait. Ça débordait Le délégué-boulonneur reste seul ; entre une vieille portant un cruchon. La grève est perdue. C’est toujours ainsi. Ils rêvent de quelque chose, mais on ne leur apprend rien. Nous sommes toujours trahis. La vieille : Tu es le fils de Blanche ? Le délégué acquiesce. On entend un bruit La vieille : de pas. On te nomme partout. Tu veux de la soupe ? Le délégué-boulonneur : Attention ! Le délégué-boulonneur : Non, merci. La vieille : Les flics ! La vieille : Tu es jeune. Tu veux mon avis ? On entend un bruit de vitre brisée. du corps, de la voix qui n’arrivaient pas à contenir, à éponger la souffrance de ce jeu. Il y avait dans les traits de son visage quelque chose qui tient du manque. Quelque chose que ni la dramaturge, l’adaptatrice, la traductrice n’épuiseraient.
Une question simple (que je ne lui ai jamais posée): « Pourquoi es-tu venue au théâtre ? » M’’aurait-elle répondu ? Sait-on jamais pourquoi on est auteur dramatique ? On peut toujours avoir quelques éléments de réponse. J’ai essayé en ce qui me concerne, d’y répondre dans LE FIL DE L’HISTOIRE. Il devait peut-être aussi y avoir eu une petite fille qui parlait toute seule. Mal aimée. Allez savoir. Elle avait besoin de tant d’amour. Et un jour elle a dû être (sur)prise en écriture. Étonnée elle-même. Avec son sens de l’humour parée dans ses longues robes, avec ce lointain accent de Liège qui lui revenait et dont elle semblait jouer quand elle mettait de la distance entre le monde et elle.
Le délégué-boulonneur reste seul ;
entre une vieille portant un cruchon.
La vieille :
Tu es le fils de Blanche ?
Le délégué acquiesce.
La vieille :
On te nomme partout.
Tu veux de la soupe ?
Le délégué-boulonneur :
Non, merci.
La vieille :
Tu es jeune. Tu veux mon avis
La grève est perdue.
C’est toujours ainsi.
Ils rêvent de quelque chose,
mais on ne leur apprend rien.
Nous sommes toujours trahis.
On entend un bruit de pas.
Le délégué-boulonneur :
Attention !
La vieille :
Les flics !
On entend un bruit de vitre brisée.
Le délégué-boulonneur :
C’est du côté de la banque.
La vieille :
Tu sais qui a cassé les vitres ?
Un temps. Elle sourit.
Le délégué-boulonneur :
C’est moi.
Il s’apprête à fuir.
Coup de sifflet.
Deux gendarmes apparaissent.
Premier gendarme :
Le voilà !
Le délégné-boulonneur
veut s’échapper.
Les deux gendarmes empoignent
le délégué-boulonneur.
La vieille :
Ne tirez pas ainsi sur son
veston, vous allez le déchirer.
Premier gendarme :
On ne discute pas.
Ils emmènent le délégué
boulonneur.
La vieille :
Ils n’ont pas déchiré son
veston, C’est toujours Ça.
La vieille : figuration du prolétariat dans sa durée historique, elle matérialise la mémoire, l’expérience et la déception d’un grand nombre de défaites qui jalonnent l’histoire de la classe ouvrière. Sa réplique : « Tu es jeune …» : elle dit la vérité de la pièce qui vient de se passer ; mais en même temps il faudrait jouer cette vérité sur le mode de la résignation — et non sur le mode du savoir triomphant — pour provoquer la réaction inverse chez le spectateur. Chez le spectateur, ce qui doit dominer, c’est le refus de la résignation qu’on lui présente sur scène. Le pessimisme de la vieille est vrai pour la pièce, mais il ne doit pas se communiquer à la salle comme si l’échec de la pièce — et celui du prolétariat dans son histoire — était inévitable. La salle doit voir l’image d’une vieille résignée et pouvoir penser que « si nous sommes toujours trahis », un jour peut-être nous ne serons plus trahis. Son comportement vis-à-vis des flics et du délégué-boulonneur doit être joué à partir de cela : dans l’actuelle défaite, préserver ce qui peut encore l’être. Jouer moins la mémoire déçue du prolétariat que la vieille mère prolétatienne qui dans la défaite, cherche à préserver ce qui peut encore l’être. Au niveau du costume on pourrait peut-être même aller jusqu’à la citation de la mère/Weigel dans LA MÈRE.
Extrait du TRAIN DU BON DIEU de Jean Louvet, et de la dramaturgie écrite par Michèle Fabien et Jean-Marie Piemme.
On sait le rôle qu’a joué Marc Liebens pour imposer mon théâtre à partir des années 70 dans le champ théâtral francophone de Belgique. Pour mener à bien cette tâche — et bien d’autres —, dès le Théâtre du Parvis, il a eu l’intelligence de s’entourer d’une équipe étonnante. Il va s’illustrer notamment, en introduisant dans notre théâtre la dimension dramaturgique avec Michèle, Jean-Marie Piemme, André Steiger.
Dans ce contexte, Michèle m’a toujours étonné. Impossible d’oublier ce texte remarquable qu’elle écrit sur CONVERSATION EN WALLONIE (édition Jacques Antoine, 1978) où, forte de sa culture théâtrale, elle situe le texte par rapport à François-Xavier Kroetz, Jean-Paul Wenzel, Michel Deutsch. Paru dans Travail théâtral en 1978, son texte « Lire Louvet » reste, à mes yeux, une première approche de haut vol.
Ce qui va me frapper davantage, c’est son rapport à une sorte de dramaturfgie prospective.
Bruxelles. Un après-midi. Rue du Lombard. Il n’y a pas de doute : Michèle et Marc ont joué tous deux un rôle important dans ce projet, mais Marc me confirme à plusieurs reprises que l’idée vient de Michèle. Le propos se résume à peu près à ceci : quand un auteur a écrit ce qui commence à ressembler à une œuvre, il doit s’attaquer à un mythe. Je suis impressionné ! Un mythe… Inquiet aussi. Le sentiment que la tâche va me dépasser. Ils me rassurent. Ils savent de qui ils parlent. On sait combien ils sont attachés à des auteurs « à mythes ». Voir le rôle qu’ils vont jouer pour faire connaître Heiner Müller en Belgique. Un mythe donc. Elle m’explique, donne des exemples. C’est vers le mythe de Faust que je me dirige assez vite et assez naturellement :l’intellectuel traverse plusieurs de mes pièces. Je lui (leur) dois UN FAUST. C’est décidé. Marc sourit dans sa barbe. Il y a de la lumière dans les yeux de Michèle. En me quittant, Marc me dit : « Un auteur, ça doit écrire au moins trente pièces ! »
Difficile de ne pas parler de Marc quand on rassemble quelques souvenirs forts sur Michèle. Qui a fréquenté Marc connaît ses colères. Une sorte de rage le prend parfois, après minuit souvent. Il règle ses comptes. Il y va quoi ! Autant il peut faire montre d’une extrême tendresse, autant il peut être redoutable quand il a la rage. (Les jeunes disent aujourd’hui : la haine.)
La scène se passe en Normandie. À trois, nous avons lu, commenté toute la journée UN HOMME DE COMPAGNIE. Le soir nous dînons, apparemment détendus. Tout à coup l’orage éclate. En un éclair Liebens se met en colère. Une colère qu’on dirait comprimée et qui attend son heure. Il crie : « Elle (c’est Michèle) n’écrit pas ! Pas assez ! Mais écris, qu’est-ce que tu attends ! » Michèle ne sait plus où se mettre. Moi non plus. Timidement j’avance : « Mais, Marc, enfin, calme-toi, Michèle écrit. » Rien à faire il redouble : « Pas assez ! Pas assez ! » Je l’ai rarement vu dans cet état-lä. Elle s’écrase sur sa chaise, mal préparée à cette sorte d’accès d’amour-haine. Car il est malheureux, bien sûr, je le connais suffisamment. Et là je crois comprendre qu’il y a une sorte de pacte entre ces deux êtres, inséparables, là-bas, dans cette grande maison, au bout du monde.
Le lendemain Michèle et moi sommes seuls quelques instants. Elle me dit : « Tu sais Jean, il y a tant d’hommes qui ont plaisir à salir les femmes, à les empêcher de créer, d’exister. Marc, lui, n’arrête pas de m’encourager. » Il apparaît. Ils se regardent, se sourient. La crise est passée. Oui, elle va écrire, c’est promis, disent ses yeux embués.