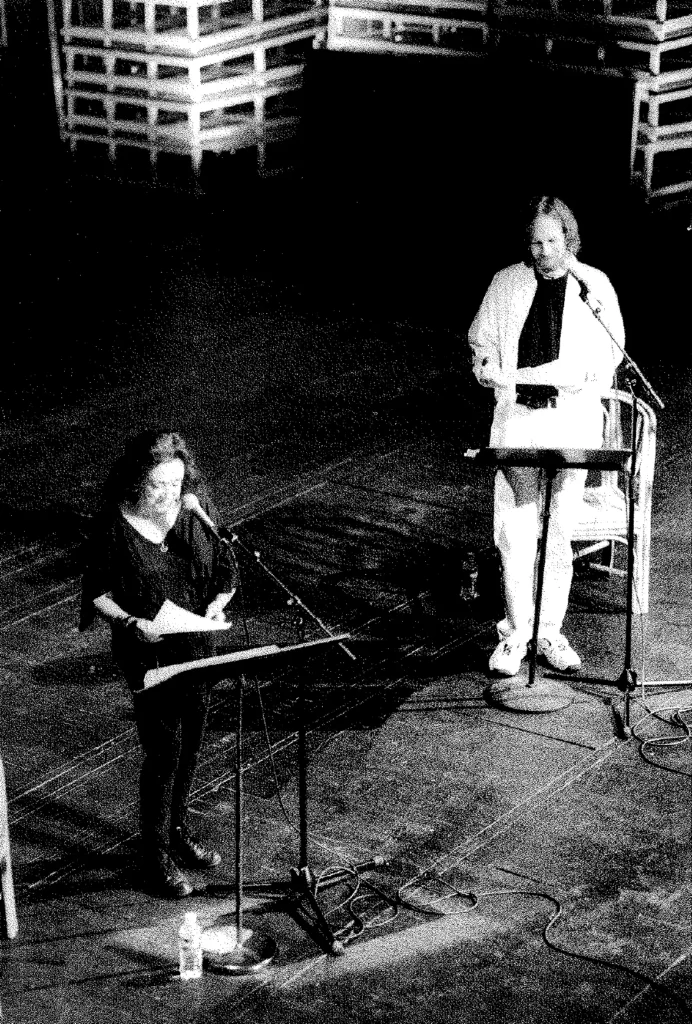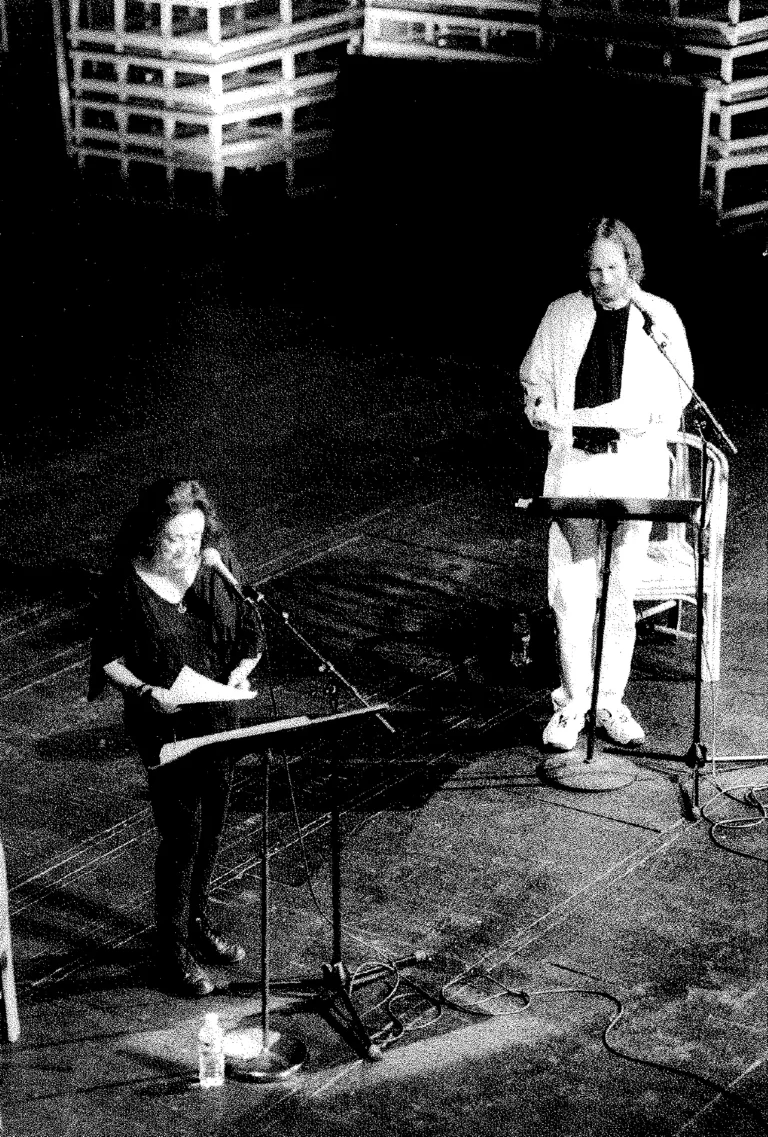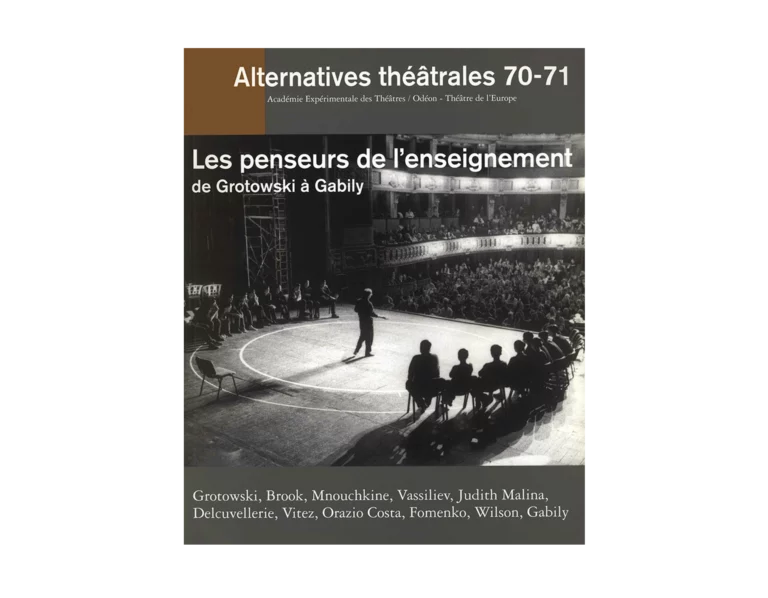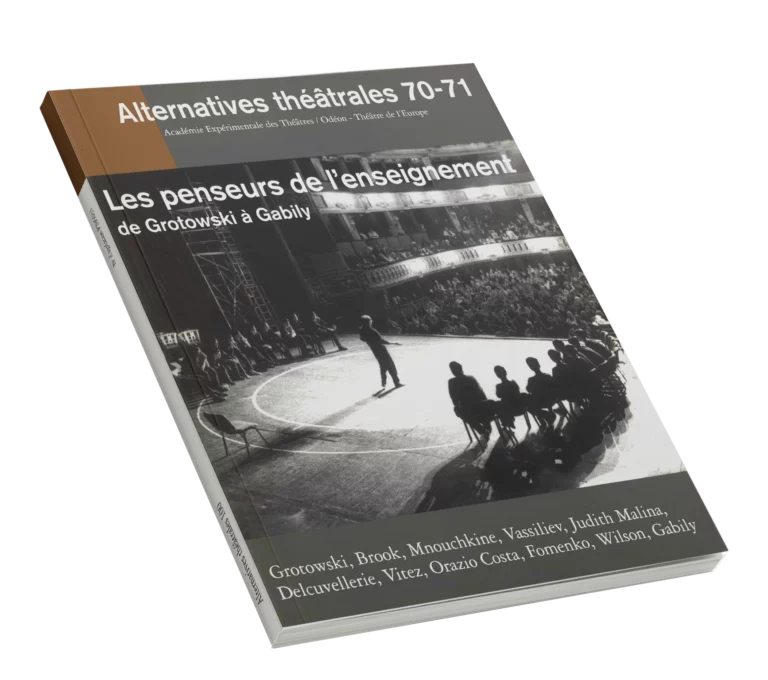JUDITH MALINA : Bonsoir. Nous voici encore ici, à l’Odéon.
Hanon Reznikov : Le Living vit toujours. Le Living continue. Le Living continue, après cinquante ans de création continue, de luttes, de joies, de malheurs, mais le Living est toujours là, et à qui nous demande : « Mais que fait le Living ? », la réponse serait celle-ci : Notre mission, c’est de questionner qui nous sommes dans l’environnement social du théâtre. Défaire le noeud qui engendre la misère. Nous mettre en mouvement comme un tourbillon qui enveloppe le spectateur dans l’action, mettre le feu au moteur secret du corps, traverser le prisme pour en sortir comme un arc-en-ciel. Insister sur le fait que ce qui se passe dans les prisons est significatif. Crier Pas en mon nom à l’heure de l’exécution. Nous déplacer du théâtre à la rue et de la rue au théâtre. C’est ce que fait aujourd’hui le Living, c’est ce qu’il a toujours fait.
J. M. : Aujourd’hui, nous fêtons le cinquantième anniversaire du Living théâtre et c’est peut-être le moment de faire un bilan provisoire, de regarder le passé, de regarder nos racines. Et aussi de regarder où nous sommes maintenant.
H. R. : Oui, parce que c’est un moment très heureux pour nous. Le Living a finalement acquis un siège permanent en Europe. Il y a quelques mois nous avons occupé un palais du XVIIe siècle en Italie, c’est le palais Spinola à Rachetta Ligure, une petite ville dans une très belle vallée entre Gênes et Milan. Et c’est vraiment la réalisation d’un rêve parce qu’on a un espace où créer, où travailler, et en même temps nous avons la possibilité de loger toute la compagnie, nous sommes quinze personnes qui travaillons là-bas, dont un coeur de six personnes comme moi qui participons à ce travail depuis trente ans environ. C’est donc très important parce que, pour nous, l’intégration de la vie quotidienne à la création théâtrale, c’est justement le centre de notre travail. Et ce centre nous permet cela. Cela ne veut pas dire qu’on abandonne le travail à New York : moi je pourrais le faire, mais Judith non ; elle considère comme trop importante au niveau politique notre présence à New York.
J. M. : Puisque nous parlons de l’enseignement, je veux dire quelque chose sur mon maître Erwin Piscator. Je suis élève de Piscator. J’essaie tout le temps, toute ma vie durant, de suivre sa grande expérience. Erwin Piscator est le grand metteur en scène qui, avec Bertolt Brecht, a inventé le théâtre politique moderne. Il a créé une école à New York, et de Piscator j’ai appris beaucoup, mais deux choses en particulier dont je veux parler parce qu’elles sont également centrales dans le développement du Living.
La première est l’idée du théâtre total. Qu’est-ce que cela veut dire ? Pour Piscator, cela signifie l’utilisation de tout ce que nous avons développé dans la civilisation. Il a utilisé sur la scène des machines, des films, des scénographies qui se meuvent, l’action mécanique. Mais cela implique aussi de dire que le théâtre est total, que le théâtre est tout le monde et tout ce qui nous fait. Que pour nous maintenant quand nous pensons le théâtre total, nous pensons le théâtre dans les rues, le théâtre dans les hôpitaux, dans les écoles, dans un supermarché … tout ce théâtre. Cela veut dire qu’où je suis c’est déjà du théâtre ; mais qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le théâtre est une forme par laquelle nous sommes élevés à un autre niveau de présence, de conscience. Quand un acteur rentre sur la scène, tous ses sens sont élevés, toute sa concentration est quelque chose d’autre, tout contact est important, impliquant plusieurs niveaux de réalisation. Si nous pouvons dans la vie vivre à un plus haut niveau, c’est cela qui fait de la vie le théâtre total : être toujours aussi vivants que nous le sommes sur la scène.
L’autre chose qu’a enseignée Piscator est la nécessité d’avoir quelque chose à dire si nous voulons parler. Si nous voulons être au centre, nous n’avons pas le droit de dire aux spectateurs : « Attendez, restez silencieux, je parle. Je suis très intéressant, j’ai une voix merveilleuse, j’ai une gestuelle fantastique. Je peux vous faire pleurer, je peux vous faire rire, je suis merveilleux » C’est un égoïsme de merde, c’est terrible. Ce n’est pas une raison pour être au centre. Piscator a dit : « Si tu n’as pas quelque chose à dire, reste sur le côté et laisse la place à ceux qui ont quelque chose à dire ». Finalement, c’est dire que nous avons un vrai besoin d’avoir quelque chose à transmettre, de communiquer. Nous avons besoin d’un engagement, un engagement vrai, un engagement personnel, un engagement brûlant, et s’il nous brûle, alors nous pouvons réciter nos messages. C’est ainsi que nous choisissons les acteurs, en fonction de leur désir brûlant de vraiment communiquer quelque chose, de leur croyance véritable en quelque chose. Cela veut dire avoir un engagement, une idée claire de ce que nous voulons dire, de ce que nous voulons explorer, de ce que nous ne savons pas et cherchons : c’est cela qui fait un théâtre qui signifie quelque chose. Nous, le Living, nous sommes anarchistes, pacifistes, féministes … nous avons beaucoup à dire. Nous voulons dire tout à tous, nous voulons changer dans chaque rencontre, à travers chaque personne que nous rencontrons. C’est cela le théâtre total, et l’engagement total. C’est cela l’enseignement que Piscator nous a donné.
H. R. : Ici, nous voudrions vous lire un petit extrait d’un livre de Julian Beck, parce qu’il s’agit d’une question qui reste au centre de son discours et de son dernier livre qui s’appelle THEANDRIQUE : « Comment le théâtre peut-il instruire ? S’il est bon, il ne peut pas instruire. Que peut le théâtre ? Si la longue file des coeurs lacérés produite par tout le XXe siècle ne peut pas instruire, que peut le drame ? ( … ) Le fourgon qui tangue fait tanguer la corde convulsée, électrifiée par la torture, pauvreté des espoirs psychologiques, lapsus d’amour, défaillance mentale, trous familiaux, démonologie politique, fous à la barre, épaves après épaves chacun de nous traîné comme le corps d’Hector autour de la cité en flammes, exhibant la défaite. Toute gloire réduite en perte. Si toute l’angoisse amassée du XXe siècle dans son drame inégalé ne peut pas nous instruire, que peut une pièce ? »
J. M. : Libération m’a demandé d’écrire quelque chose sur le futur et comment nous le voyons. J’ai écrit : « Le moment est venu d’espérer. L’optimisme du Living Theatre est d’autant plus grand que nous venons d’ouvrir notre quartier général permanent en Italie, le Centra Living Europa, à Rachetta Ligure, où nous travaillons à la formation d’une avant-garde culrurelle susceptible de révolutionner le monde. Nous sommes aujourd’hui en mesure de mieux comprendre ce qui a affaibli la vague d’énergie et d’espoir des années 60 et 70. D’abord nous n’étions pas prêts à mettre en oeuvre notre grand idéal d’un monde en paix. L’idéal multiculturel de cette époque est demeuré bien vivant. Mais nous étions incapables de mettre partout en pratique notre solution au problème, nos modèles non hiérarchiques. Socialistes et communistes restaient enfermés dans des modèles dixneuviémistes. Les anarchistes proposaient certainement de bonnes solutions, mais notre unité et notre efficacité furent diminuées, comme partout à gauche, par la confusion totale qui régnait autour de la question de la lutte armée.
Mais la jeune génération sort plus sage de ces trente ans passés. Et nous affirmons avec elle que non, nous ne sommes pas nés trop tard, que certes l’Histoire nous précède mais que de grands moments nous attendent aussi, telle une page blanche où nous écrirons le récit poétique d’une belle révolution anarchiste et non violente. Les cyniques diront que nous disions déjà la même chose il y a trente ans … Oui, c’est vrai, nombre de ceux qui étaient à nos côtés à Paris en mai 1968 et chantaient en choeur « ce n’est qu’un début, continuons le combat » avaient bien la ferme intention de continuer, et nous en avons toujours l’intention aujourd’hui. Nous avons toutes les raisons de continuer à espérer, car nous ne sommes pas seuls : toute une génération qui vient juste d’atteindre sa majorité refuse de se laisser décourager par l’Histoire. Il nous faut bien réfléchir, car nous savons ce que nous ne voulons pas beaucoup plus clairement que nous ne savons comment parvenir à nos fins. Nous ne voulons pas de guerres, d’armes, des prisons, de pauvreté, de frontières, d’armées, de travaux forcés, de racisme, de faim, de cruauté, de sexisme, d’autorité ou de punition. Nous voulons une société égalitaire et libre. Nous voulons un monde d’entraide. Nous voulons la libération par l’anarchie dont les voies sont aussi douces que celles de la nature, car elle fait partie de la nature. Et nous voulons également opposer à la cruauté de la nature nos intarissables ressources humanitaires.
La liberté totale ne nous fait pas peur, car notre vulnérabilité est notre meilleur alliée. Nos exigences sont folles car elles sont excessives, mais elles sont armées de la grandeur de l’ingénuité humaine, nous nous dirigerons vers ce que nous voulons vraiment atteindre — l’extase absolue pour tous, pour toujours. » 1
H. R. : Je vais vous lire ce qu’a écrit Julian Beck dans son premier livre LA VIE DU THÉÂTRE sur l’occupation de l’Odéon :
L’occupation de l’Odéon. Partie I.
« Il était important d’occuper l’Odéon simplement parce que c’était le Théâtre de France où le Gouvernement laissait à la compagnie Barrault-Renaud la possibilité de jouer et Beckett et Adamov et Ionesco et Genet. Genet ! Parce que les étudiants et leurs camarades refusaient en Mai 1968 d’accorder au gouvernement le privilège de faire plaisir à la fois à lui-même et au public, en laissant croire que l’état maintient une avant-garde de certaine réputation contre le système. Tout art que l’institution soutient, elle l’exploite, tout art que l’institution soutient est déjà corrompu.Tant sont puissants les germes de la corruption. Nous nous battons contre une peste. L’occupation de l’Odéon représentait la tentative d’occuper un des mécanismes de cooptation.
Il a été important de trouver un moyen éclatant pour montrer que nous savons que tout art fait pour le privilège d’une classe (ceux qui peuvent payer le prix d’entrée) travaille contre l’autre classe. Nous n’abandonnons pas à la bourgeoisie le privilège d’aiguiser son entendement de Genet et de Beckett aux dépens des pauvres qui sont privés de l’alimentation décente qui permettrait la croissance biologique normale du cerveau ainsi que celle des nécessités de base d’ordre social et culturel.
Il était important de dire que les théâtres — même les meilleurs — devaient être au service du peuple là où le peuple pouvait se rassembler, non pour regarder se jouer les vies de leurs supérieurs mythiques, mais pour faire le rituel du drame de la révolution, là où chaque spectateur participe à faire les plans et à créer les changements révolutionnaires qui puissent modifier le cosmos.
Un théâtre pour qui est dans la rue a plus de valeur qu’un théâtre pour recevoir Shakespeare, Claudel, Gide et Genet. Tout le pouvoir au peuple.
Ce qui a eu lieu la nuit du 15 mai 1968, à l’Odéon, a été la plus belle des choses que j’aie jamais vues dans un théâtre.
L’occupation de l’Odéon avait tous les éléments d’un grand théâtre : une somme de personnages fulgurants, de grandes tirades poétiques, de conflits d’idées ; le choc d’idéologies puissantes, une réalité dépassant les inventions des dramaturges, l’émergence du peuple comme héros, et la fin qui est venue un mois plus tard comme une tragédie malencontreuse avec l’invasion de la police, tragique comme toute l’histoire de France en mai, comme l’Espagne, comme Kronstadt, comme tous les grands drames anarchistes.
L’essence de la tragédie : tout juste quand le héros a tout compris, le il et le elle du cela, le dedans et le dehors, la vérité, tout juste quand il est le plus près à vivre, à agir, il meurt, poignardé par la civilisation, victime inutile de notre artificielle destinée.
L’occupation de l’Odéon. Partie II.
« Dans une révolution ratée on prend les folies-bergère et on leur fait jouer Ionesco
dans un coup d’état fasciste la Comédie-Française ne peut jouer ANTIGONE ou LES BACCHANTES !
dans une révolution socialiste en France les recherches de Barrault seraient encouragées parce qu’elles signifieraient prestige clans le pays et à l’étranger
mais une position politique devrait toujours être voilée.
Mais ce qui se passait en France en mai 1968 n’était pas une révolution antistalinienne
c’était une révolution contre le kapital et ses affectations de bienfaisances
La révolte française de 68 a frappé tout le monde parce que l’idole de l’Ouest — la France — l’article d’exposition le plus pur du capitalisme (plus pur qu’aux U.S. parce que plus « cultivé ») était contesté par ses propres citoyens, son propre peuple hurlait et passait à l’action. Ils disaient nous voulons le miracle : paradise now !
et ils rêvaient que cela arriverait
et ils tentaient de faire exister le rêve …
11 000 000 de grévistes dans une pays de 50 000 000 d’habitants — et il était clair que pour chaque personne en grève on pouvait compter 2 — 3 sympathisants en plus — plus de la moitié du pays planait, vraiment planait, à l’idée que le miracle des miracles allait arriver : qu’une fois finie la vie d’injustice et de dégradation, une nouvelle phase du développement de l’humanité commencerait.
Avec un profond chagrin, nous en vînmes à apprendre que nous, le peuple, n’étions pas préparés. Mais tous, y compris la police, et les ministres, ont fait durer le temps autant qu’ils ont pu parce que chaque inconscient humain voulait que le deus ex machina, l’impossible, arrive ; qu’une France non préparée puisse se débarrasser tout d’un coup du capitalisme en évitant les maladies infirmes du Socialisme d’État et devienne une société communautaire productive dans laquelle tous donneraient et recevraient en fonction de leur capacité et de leurs besoins.
Le théâtre de ce printemps en France a été la chose la plus grisante et la plus ascensionnelle que les Français de ce siècle aient expérimentée : ils jouaient, jouaient de grands rôles.
C’était clair à l’Odéon. Le drame se passait dans la salle, pas sur la scène, mais dans le théâtre où les spectateurs étaient devenus les protagonistes et jouaient la Tribune de la Révolution, un grand drame en 30 jours. Tout discours terrible qui durait une demi-heure d’écoute ennuyeuse a été plus important dans l’histoire de nos âmes immortelles et de nos corps mortels que les grandes tirades célèbres de Racine et de Corneille.
Ces drames étaient écrits dans le Livre de Vie. Amen.
Le jeu-du-rôle : chacun était en transe et dans la transe se jouait une pièce divine d’un auteur sacré, vertigineusement impliqué vers sa propre libération. Les éléments théâtraux de la culture proposaient des formes d’action, grande improvisation. La vie devint importante, chaque moment lumineux, planant, pas un drame fatigué ou décadent, mais plus haut, au-delà du rituel de la mort. » 2
J. M. : Dans PARADISE NOW, Julian criait « Le théâtre est dans la rue ». Nous descendons dans la rue, et nous avons commencé il y a beaucoup d’années à jouer dans la rue ; dans les théâtres aussi, mais toujours dans cet espace ouvert de la rue. Et aujourd’hui, depuis six ans, nous faisons un spectacle de protestation contre la peine de mort. Il y a actuellement 13 000 personnes condamnées à mort aux États-Unis, et chaque semaine on en exécute un, deux, ou trois, et nous descendons sur la plus grande place de New York, Time Square, au centre de la ville, et, sans la permission de la police, sans autorisation, nous faisons cet acte artistique contre la peine de mort. Nous parlons et nous le faisons à l’heure de l’exécution, ce qui veut dire que le spectacle commence quand le condamné est encore en vie, nous parlons de sa vie, faisons le documentaire de sa vie : ce qu’il a été, ce qu’il a dit, son avocat, sa mère, le juge, l’accusation, le procès … Au milieu, le condamné est tué et nous faisons une plainte, puis nous essayons de briser le cycle de la vengeance, le cycle de la violence. Et nous le faisons avec les spectateurs dans la rue. C’est un programme qui n’est pas annoncé, et ce sont des personnes qui passent à Time Square qui le voient — ils ont beaucoup de réactions très hostiles envers nous parce qu’à New York on considère que la peine de mort protège les gens de la plus grande violence.
Mais nous approchons ces spectateurs, nous disons « Nous voulons briser ce cycle ». Comment pouvons-nous le faire, quand c’est une chose aussi ancienne, tellement ancienne, tellement profonde, dans toutes les cultures ? Nous parlons de Caïn et Abel, d’une partie de la culture ancienne, nous parlons des Irènes ; c’est très profond ce cycle de la vengeance. Comment pouvons-nous le briser ? Nous commençons avec nous-mêmes, bien sûr, mais nous avons besoin des autres. Et nous approchons une personne qui nous a entendu en passant dans la rue et nous disons : « Maintenant nous voulons briser ce cycle », et je le fais comme ça : je touche cette personne, chaque acteur va vers un spectateur et le touche — c’est déjà tabou dans Time Square de toucher des étrangers, c’est une part de la peur de la ville. Nous les touchons et nous disons : « Je veux briser maintenant le cycle de la vengeance, et je peux jurer que je ne tuerai jamais. C’est possible pour toi comme pour moi de le promettre ». Si la personne dit « Oui », nous déclarons que nous avons fait le premier pas pour briser ce cycle, parce que nous avons montré qu’il est possible pour l’individu de refuser ce cycle, de rompre cette tradition et d’aller vers un nouveau territoire où cette vengeance ne compte plus. Et c’est cela que nous faisons maintenant dans les rues de New York, en Italie, et j’espère que nous n’aurons pas besoin de continuer et que cette barbarie sera un jour finie.
H. R. : Nous travaillons actuellement avec un groupe de participants à la résistance pendant la seconde guerre mondiale. La petite région où nous vivons, en Italie, est une vallée où la résistance était très forte, il y a même eu une République partisane pendant un an, et les vieux habitants ont une mémoire essentielle. Nous cherchons à travailler sur cette mémoire pour en comprendre le contenu — même, vraiment, au niveau spirituel, comme je le disais. Je pense que dans le théâtre on a besoin de nourrir aussi l’esprit et que c’est très difficile.
J. M. : L’enseignement arrive de façon inattendue. Un jour quand j’étais petite, j’avais peut-être dix ans, je jouais dans le parc de Washington Square à New York, un grand camion fermé est arrivé, un camion étranger : c’était un camion du Federal Theatre. Le Federal Theatre était une merveilleuse expérimentation de Franklin Roosevelt, sous la direction d’une grande femme de théâtre, Harry Flanagan. Durant les sept ans de la dépression économique, on a essayé de donner du travail à tous ceux qui étaient au chômage, y compris les artistes, y compris des acteurs. Pour le théâtre, on a créé le Federal Theatre, le Théâtre Fédéral, qui présentait du théâtre sous toutes ses formes, des expériences théâtrales diverses : en plusieurs langues, théâtre pour les personnes handicapées, théâtre de marionnettes, danse … Et l’une des réalisations de ce projet était ce camion qui allait en divers lieux et jouait Shakespeare. On disait aux enfants : « Ce soir, sur l’herbe, regardez cette pièce de Shakespeare ». Je ne me souviens pas de la pièce de Shakespeare, mais je n’en oublierai jamais le prologue, parce que cela m’a beaucoup touchée. En prologue, un acteur avec un chapeau haut-de-forme est allé sur la scène du camion, il a ouvert un rouleau et a parlé d’une voix très comique ; il a dit : « Mesdames, Messieurs, nous sommes le Federal Theatre, et nous demandons : gue veut le public ? »; et derrière nous il y avait un vendeur de bonbons, de chocolats, de glaces, et quand l’acteur a demandé « Que veut le public ? », il a crié : « Ice cream ! ». J’ai pensé que cet acteur et ce vendeur étaient complices, et cela a été le début des recherches que je continue aujourd’hui avec l’aide des leçons de Piscator, de Pirandello et d’autres qui ont cherché à partir de cette question : « Qui sommes-nous ? Qui sont les acteurs ? Quelle est la réalité du théâtre ? ». Cette recherche continue, et j’espère que nous pourrons la continuer jusqu’au point qu’il n’y ait plus de séparation et que les spectateurs aient un rôle créatif comme nous. Et nous cherchons dans tous nos spectacles une forme, pour essayer de briser cette séparation et de comprendre ce qu’est la réalité.
H. R. : Il faut continuer sur cette recherche qui pour nous est fondamentale, la quête de la participation du public. En partant de PARADISE NOW il est difficile de comprendre ce qu’on peut faire d’autre pour donner un rôle maximal au public. Pourtant, pour nous tout est encore à découvrir. Je crois que cette recherche en est, vraiment, seulement à son début. Elle n’a de sens que si on cherche à utiliser cette présence, cette co-présence des deux groupes, spectateurs et comédiens, acteurs et public. S’il n’y a pas d’échange entre ces deux groupes, pour moi il n’y a plus de sens à réaliser un spectacle sur cela. Et donc, avec chaque spectacle que nous créons, nous nous posons toujours la même question : « Et le rôle du public ? Comment peut-il être actif au maximum ? ». Un autre cas de participation toute particulière du public était celle de la police à la fin de PARADISE NOW.
J. M. : À la fin de PARADISE NOW, Julian écrit :
« Le théâtre est dans la rue et nous descendons dans la rue, et dans beaucoup de cas nous gênons la police et parce que nous sommes à demi nus, pas totalement nus, demi-nus, nous sommes fréquemment arrêtés. Et cela mène à la nouvelle fin du spectacle. J’ai dit à l’agent qui m’a arrêté : « C’est ça la dernière scène de notre spectacle, maintenant toi et moi nous sommes les acteurs et je suis le prisonnier, tu es l’agent », et il a dit — c’était difficile pour la police de ressentir cela — « Je ne fais pas partie de votre spectacle » ; et j’ai dit : « Ah, quel grand acteur, vous avez dit cela parfaitement » et c’était pour lui insupportable, une rage de frustration. Pourquoi ? Parce que nous avions changé de rôles. Nous avions pris de lui le pouvoir, et on avait fait une scène dans laquelle il était acteur, et il n’était plus le pouvoir de la police mais dans l’état d’acteur. Et ce moment de changement de rôles nous a donné un grand moment de satisfaction, et à la police, malheureusement, une grande frustration ».
H. R. : Ensuite, nous avons continué à chercher à découvrir un vrai rôle créatif pour le public. Par exemple nous avons créé, il y a vingt ans déjà, un Prométhée. PROMÉTHÉE AU PALAIS D’HIVER, un texte de Julian Beck. Au début du spectacle, le public entre et découvre les quinze acteurs du spectacle enchaînés dans les fauteuils, dans les places réservées du théâtre, alors il doit chercher à comprendre comment faire. Nous ne parlons pas. Il faut qu’ils comprennent que le spectacle n’aura pas lieu s’ils n’interviennent pas pour libérer les acteurs. C’est une leçon très concrète, et on a dû attendre parfois vingt minutes, mais à la fin on a toujours été libéré. Et puis, à la fin de ce spectacle, on invitait le public à venir avec nous à la prison du quartier pour une méditation silencieuse de dix minutes ou une demi-heure — cela dépendait des circonstances — sur la destinée des prisonniers qui sont les Prométhées d’aujourd’hui. Et c’est bien une autre forme de participation.
On a créé un spectacle qui s’appelait ANARCHIE, et à un certain moment, pendant le spectacle, les acteurs lançaient des pierres au public, et autour des pierres il y avait des messages écrits sur du papier. On y découvrait un message personnel d’un personnage du spectacle au spectateur qui le trouvait, un message qui expliquait qu’un peu plus tard dans le spectacle il y aurait un attentat terroriste et que ce personnage-là allait mourir si le spectateur ne montait pas sur la scène pour le sauver. Il précisait le moment où et comment le reconnaître, comment faire, et chaque personne qui trouvait le message faisait son choix ; le spectacle finissait donc différemment chaque soir. Il y en avait parfois qui survivaient à la fin, et parfois ils mourraient tous, c’était vraiment de la responsabilité du public de déterminer la fin du spectacle. Pour nous c’était vraiment le but, parce que le théâtre, après tout, est un modèle de comportement social. C’est un art social et nous pensons que nous pouvons trouver beaucoup de façons d’utiliser ces possibilités.
Nous voudrions conclure avec un texte de Julian Beck, extrait de LA VIE DU THÉÂTRE, et ce sont des questions. Pour nous il est important et nécessaire de conclure avec des questions.
Questions. 1963.
« je termine par des questions parce que je n’ai pas de réponses.
quelle est la différence entre les questions et les réponses les interrogations d’hamlet sont-elles sa gloire Ou sa tragédie
pourquoi vas-tu au théâtre
est-il important d’aller au théâtre
est-il important de lire
les gens qui vont au théâtre sont-ils différents des gens
qui n’y vont pas
que t’arrive-t-il si tu vas au théâtre
quand tu quittes le théâtre as-tu changé bien sûr
que par la marche du temps tu es naturellement différent dans l’espace de trois heures mais je veux dire as-tu changé réellement
veux-tu changer réellement
es-tu satisfait
est-il bon de changer
est-ce que tout va bien sans changement
de quoi suis-je en train de parler
vas-tu au théâtre pour y trouver des réponses
as-tu des questions à poser
combien dure le temps de vivre
est-ce que ce qui se passe est important
est-ce que le temps qu’on a à vivre est important
est-ce que la façon dont on vit a de l’importance
pourquoi est-ce que je pose ces simples questions que chacun doit se poser tout le temps est-ce que c’est parce que je pense
que tu ne te poses pas ces questions
qu’ est-ce qui nom arrive
qu’est-ce qui se passe au théâtre
vas-tu au théâtre pour y découvrir la vie
est-il plus facile d’observer la vie au théâtre ou dans la rue
as-tu rencontré la joie au théâtre
as-tu rencontré la joie dans la rue
qu’ est-ce qui te fait plaisir
as-tu été l’objet de sensations sensuelles au théâtre
vas-tu au théâtre pour te stimuler sexuellement
aimes-tu te frotter à la personne qui est près de toi
vas-tu au théâtre pour te stimuler intellectuellement
vas-tu au théâtre pour déchiffrer le déroulement de l’action
vas-tu au théâtre parce que tu pourrais y trouver la vérité
y a‑t-il quelque chose qui soit la vérité
les journaux disent-ils la vérité
les auteurs disent-ils la vérité plus que les éditeurs
les journaux mentent-ils les auteurs mentent-ils les acteurs mentent-ils
les acteurs ou les éditeurs ou les acteurs mentent-ils délibérément
vas-tu au théâtre pour voir comment un acteur peut entrer
dans la peau de son personnage
penses-tu que les acteurs peuvent atteindre l’état de perfection
qu’est-ce que la perfection
un acteur peut-il te la communiquer
un acteur peut-il te donner l’image de la perfection seulement en jouant faust
qu’ est-ce que la vue intérieure
te sers-tu de ta vue intérieure
est-il facile de poser des questions
qu’est-ce qu’Aristote dit de la catharsis
metis vas-tu au théâtre pour prendre une purge
te souviens-tu avoir jamais pris une purge au théâtre
vas-tu au théâtre dans l’expectative et dans l’espoir
le théâtre est-il un chemin pour apprendre ce que tu ne sais pas
à quoi sert d’apprendre
es-tu sûr de toutes les réponses
est-ce que tout se vaut
est-ce que n’importe quoi à de la valeur
est-ce qu’il est bien de tuer quelquefois
quelle est la différence entre un éléphant et un mouchoir de poche
est-ce que tu tuerais quelqu’un pour défendre ta propriété
mettrais-tu les gens en prison
te moques-tu des homosexuels
penses-tu que les noirs soient des êtres légèrement inférieurs
penses-tu que les blancs soient en décadence physique et mentale
mens-tu
mentir a‑t-il de l’importance
combien de fois mens-tu par jour
penses-tu qu’il faille mentir pour vivre dans ce monde
te plait-il que je repose la question
te completis-tu avec n’importe quoi
es-tu satisfait sexuellement
je veux dire aimes-tu fetire l’ amour
en as-tu assez
est-ce que tu sais aimer
est-ce que tu aimes
est-ce que tu es aimé
est-ce que tu sais haïr
est-ce que tu hais
pourquoi ai-je choisi de faire un théâtre qui dérange plutôt qu’un théâtre agréable alors que j’aime faire plaisir aux gens
qui sommes-nom d’où venons-nous uù allons-nous. gauguin.
qui sont les rois aux yeux de diamant fauchant et grimaçant parmi nos propres ombres. barker.
devons-nous nous aimer les uns les autres ou mourir. auden.
quelle est la question. shakespeare. stein.
sais-tu que je suis descendu dans mes entrailles et que je les ai
éparpillées sur la scène en forme de questions
sais-tu que je ne sais pas quoi faire d’autre
sais-tu que j’eu besoin de toi que je suis en train de mourir
et que je mourrai sans toi
qu’est-ce qui est utile
qu’est-ce qu’une bonne question
comment trouver les réponses
qu’est-ce qui fera tomber les murs des prisons
quel est le chemin
quel est le rapport entre l’acteur et le spectateur
qu’est-ce qu’un discours
qu’est-ce que l’information capitale
Avons-nous le temps de nous poser toutes les questions
lesquelles veux-tu poser
veux-tu les poser maintenant
de quoi avons-nom besoin
comment l’obtenir
comment communiquer
comment faire pour cela
comment faire un théâtre d’amour d’amour maintenant
comment faire un théâtre qui soit à la hauteur de la vie
de ses spectateurs
comment faire un théâtre quand nous ne connaissons aucune réponse quand nous avons seulement quelques vagues idées de comment poser la question
je termine avec des questions, parce que je n’ai pas de réponses
mais ce que je veux ce sont des réponses » 3
Créé par Julian Beck il y a 50 ans, le Living Theatre est codirigé aujourd’hui par Judith Malina et Hanon Reznikov. Tout en maintenant leur activité à New York, ils se sont installés aussi à Rachetta Ligure en Italie.