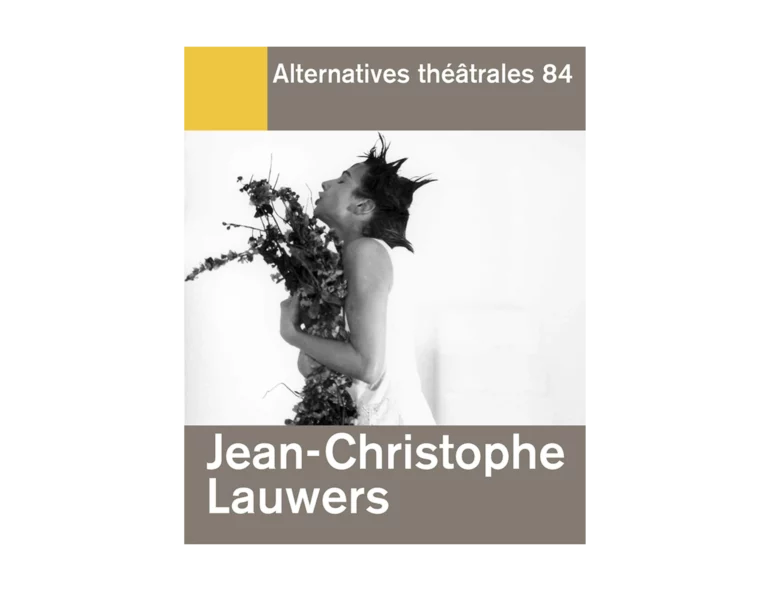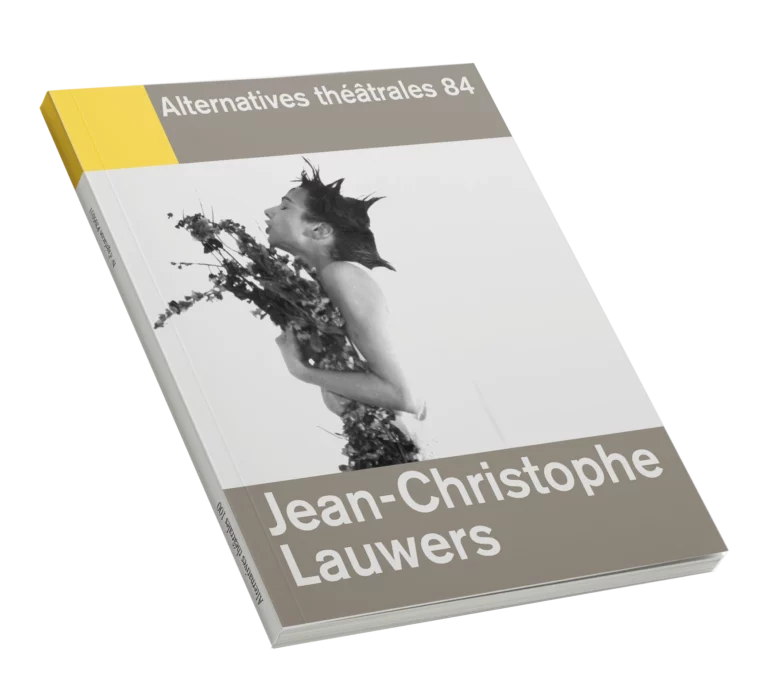ON ME DEMANDE D’ÉCRIRE quelques réflexions sur l’essai, pas sur l’essai comme genre littéraire, mais sur la tentative, l’épreuve, l’expérience.
Ma pratique théâtrale n’est pas encore suffisamment étoffée pour que je puisse, sans spéculer, m’attarder trop longuement sur l’essai et ses scènes. Ce que je sais, c’est que pour moi, le théâtre est l’essai, est la mise à l’épreuve des corps, est l’expérience des langages. Je ne parle pas uniquement de la période des répétitions durant laquelle, par définition, on tente, on essaie, on répète les expériences, on construit pas à pas un spectacle, on teste les idées que l’on a pu avoir, on éprouve les mots dans le corps de l’acteur ; je parle aussi des représentations.
Si chaque soir amène un nouveau public, si chaque soir les acteurs sont différents, traversés par de nouvelles flèches décochées par la vie quotidienne, si chaque soir l’odeur des planches et la chaleur des projecteurs sont transformées ne serait-ce que minimement, il faut bien admettre qu’on re-présente dans de nouvelles conditions, que l’on essaie d’être en symbiose avec les transformations de notre environnement et de notre métabolisme, que l’on invente une nouvelle expérience. Jamais un acteur ne fait la même entrée, jamais un acteur n’a le même ton d’attaque lorsqu’il entame son texte, tout est à refaire, chaque fois tout se modifie.
Faire croire que la représentation puisse être figée, puisse être de la redite, c’est nier les corps, nier le vitalisme de notre art.
J’ai délibérément choisi, dans les quelques notes qui suivent, de ne pas m’attarder exclusivement sur des exemples théâtraux, je ne désire pas me placer dans le camp de ceux qui mettent des clivages entre notre pratique et celle des écrivains ou des peintres. Théâtre, littérature, peinture ou musique, tout est œuvre de fiction, et toute œuvre de fiction passe, quelle que soit la discipline qu’elle engendre, par des étapes identiques : la première, propédeutique, qui correspond à l’apprentissage de l’alphabet des langages, ensuite maïeutique durant laquelle l’artiste s’extirpe son propre alphabet, et de façon concomitante l’étape de la pratique du langage qu’est la poétique. La condition commune à chacune de ces étapes n’est autre que l’essai, la mise à l’épreuve et la remise en question.
C’est sur ces trois étapes que j’aimerais m’arrêter dans un premier temps.
Toutes les avant-gardes, toutes les tentatives d’atteindre le moderne et de le surpasser, toutes les grandes théories artistiques ou poétiques se sont toujours réclamées de l’essai. Du théâtre expérimental aux manuscrits de Marcel Proust criblés de ratures et d’annexes, des études de Van Gogh aux mille et une versions des pièces musicales de Mozart ou Bach, l’art est constellé de bouts de manuscrits oubliés, de spectres de toiles brûlées, de souffles d’acteurs jamais offerts au public. Tous les inventeurs ont tenté, tels des scientifiques, partant du postulat que le réel était multiple, d’inventer le langage qui construirait leur propre réel.
Si l’on parle souvent de droit à l’essai, ils nous ont prouvé que l’essai était un devoir et l’erreur son pendant obligatoire. La réussite donne l’illusion de la perfection là où elle n’est sans doute que la révélatrice du but que l’on s’est fixé. L’erreur bien au contraire oblige à retourner au charbon, reculant les limites de nos possibles.
Mais dans le processus de la création artistique, où intervient la notion d’essai ? Et d’abord qu’est-ce que ce processus ? Qu’est-ce que l’art ?
L’art porte la fiction, et la fiction naît avec le langage. L’art se préoccupe du décalage entre la pensée et l’articulation, la mise en langage de celle-ci. Ce décalage infime, ce trou dans le réel, cette béance est la matière première de l’art. De la phrase catastrophe de Marcel Proust qui se tord et s’échappe et se rattrape, où plus la pensée avance plus la biffure de sa retranscription devient obsession, où plus l’on s’approche de la description des choses plus l’on s’en écarte, où l’on est pris de vertige par l’accélération sans cesse croissante des rencontres avec l’impossible, à l’expression courante « les mots me manquent » ou « c’est indescriptible », tout nous porte à croire que le langage, la fiction donc, modifie le réel.
Nous construisons notre réel, notre perception, notre protocole du monde par le biais d’un alphabet. L’alphabet de la vie quotidienne, celui des conversations courantes, est le français, concessions avec le social oblige (le cas des psychotiques, qui eux ne font plus aucune concession au social, est différent, leur langue nous est étrangère, ils sont « délirants »). En art, par contre, on doit remodeler le réel avec une langue propre et réinventer un nouvel alphabet, c’est ce qui différencie les arts du journalisme.
Rimbaud fut probablement l’un des tout premiers à énoncer explicitement son désir d’inventer un langage. Dans un texte très connu, il invente ses voyelles :
« (…) J’inventai la couleur des voyelles ! – A noir, E blanc, O bleu, U vert. Je réglai la forme et la couleur de chaque consonne, et, avec des rythmes instinctifs, je me flattai d’inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l’autre, à tous les sens — Je réservais la traduction. (…) »
Figure emblématique de la poésie, le parcours même d’Arthur Rimbaud nous contraint à douter de la vision romantique de l’artiste et de l’inspiration. Rimbaud invente parce qu’il travaille de manière acharnée à son encrassement. Le début de son œuvre est composé de quatrains anodins, de poèmes en latin de facture purement classique, d’alexandrins ; la décomposition, la déconstruction, la dislocation des académismes ne viendront qu’après cette période propédeutique.
Seulement après avoir étudié, appris et essayé les langues préexistantes, il couchera, comme il le dit, avec un porc, et enfantera les « illuminations ».
On peut trouver dans d’autres arts des exemples frappants de propédeutique, le premier qui viendra à l’esprit lorsqu’on parle de théâtre est celui de Vsevolod Meyerhold. Disciple de Stanislavski, ami correspondant de Tchékhov, il s’essaya à toutes les formes d’art dramatique existantes à son époque : naturalisme, symbolisme, psychologie, tout y passa jusqu’à ce qu’il invente sa propre pratique de la bio-mécanique des corps.
En peinture, on pense à Kandinsky qui jusqu’à ses quarante ans fut peintre paysagiste et professeur à l’académie des beaux-arts. Entrant un jour dans son atelier, il fut frappé par une toile qui lui semblait étrangère, ses formes éclatées, la circulation déconstruite de ses lumières lui étaient totalement inconnues. Ce n’est qu’après une longue observation qu’il se rendit compte qu’il s’agissait d’un de ses tableaux posé à l’envers. Il tenta alors de reproduire cet « envers du langage » : l’abstraction kandinskienne était née.
Et bien sûr, lorsqu’on parle d’invention, on pense automatiquement à Artaud qui, avec ses glossolalies, tranche sec dans le gras du bide du Beau Français, immole les académies, débite le roastbeef incantatoire d’un langage policé à coup de Valéry, déchire l’éternelle chanson du ringardisme verbal et jette à la face d’Émile Littré des gigots d’Artaud mal ficelés, sanguinolents de rage et affûtés comme des lames effilées. Artaud frappe sec et aigu, toujours précis :
boule zadur
zadir
edela
bula edela
artedra
bula tatra