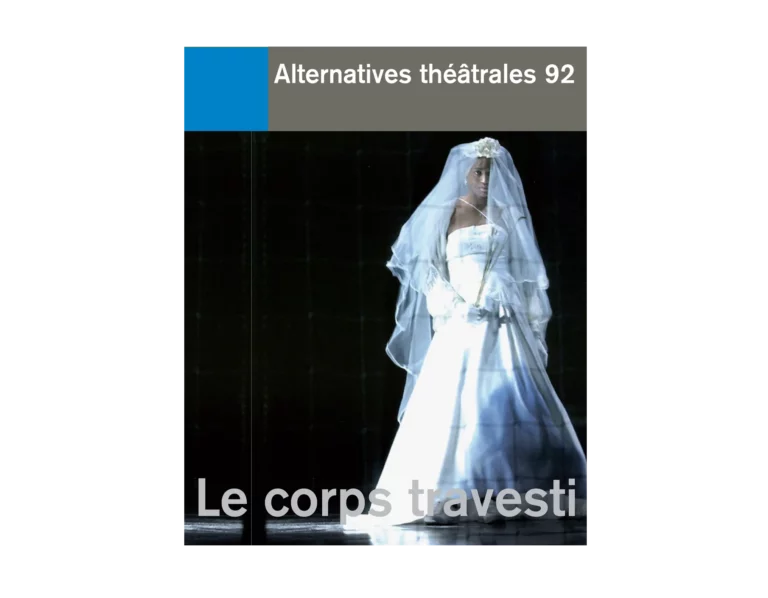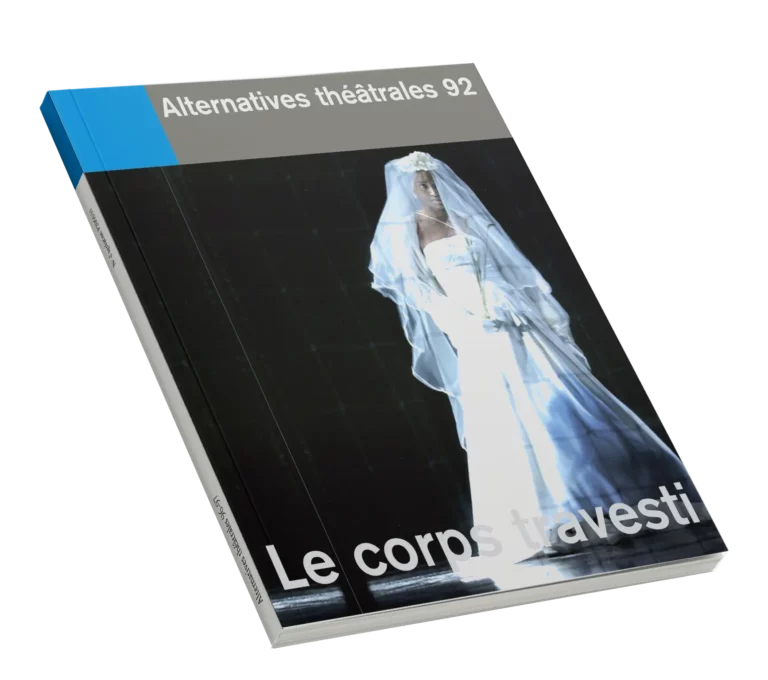LE THÉÂTRE n’a pas de sexe, la langue française n’a pas de genre neutre et l’art de l’acteur est de rendre l’absence présente au réel. C’est dans cette triangulation que se situe la scène du corps travesti. Mais commençons par les commencements. Si le travestissement est l’art de se transformer par le vêtement, corps travesti et théâtre sont une tautologie. Le costume, en effet, autant que le texte, a longtemps suffi à faire l’art théâtral. Ainsi, au XVIIIe siècle, l’expression « établir le costume » signifiait non seulement composer le costume de scène mais définir le rôle, le personnage. Avec les mutations observées sur la scène contemporaine, costumes et personnages méritent probablement une nouvelle définition, mais il reste vrai que le travestissement est « l’art théâtral par excellence », selon l’expression de Georges Banu. Nécessité morale chez Shakespeare puisque les femmes étaient interdites de scène, le travestissement devient chez Marivaux un ressort dramaturgique, à la différence que ce sont les femmes qui se travestissent en hommes. Dans un siècle où le travestissement est puni par la loi, la scène va en jouer vertigineusement, jusqu’à « fabriquer », avec les castrats, des êtres au sexe indéfini. Le travesti au sens moderne du terme devient sujet chez Jean Genet. Les grandes actrices, de Sarah Bernhard à Isabelle Huppert, ajoutent à leur répertoire des rôles masculins. Mais sur scène, comme dans la vie, le corps travesti n’est pas seulement un simple procédé artistique : la loi et les mœurs ne sont jamais bien loin quand on parle du travestissement, et son objet dernier est toujours de subvertir l’ordre établi. Longtemps, le travestissement a concerné les femmes, pour qui l’habit masculin devenait le symbole de l’accès à l’égalité entre les deux sexes. La femme se rêve homme et jamais l’homme ne se rêve femme disait, en substance, Kant. Voilà un postulat faux désormais. Depuis les années 70 est apparu un cas de figure si récurrent qu’il devient un lieu commun : le corps masculin travesti volontairement en femme. La problématique féministe n’est pas pour autant annulée ; elle trouve même une vigueur nouvelle à travers son inversion, l’émergence d’une conscience gay. La figure du travesti sur les scènes est montée en puissance dans le sillon creusé par les révolutions sexuelles, et les combats féministes puis homosexuels jusqu’à leurs manifestations les plus radicales telles qu’elles se développent aux États-Unis. L’apport de la danse, la pulvérisation des codes dramaturgiques et scéniques avec, en particulier, la disparition du personnage en tant qu’entité réaliste et psychologique, la fin du primat du texte, l’avènement du corps comme enjeu social, ont aussi apporté leur contribution.
Loin d’être une notion anecdotique, le corps travesti se situe ainsi au croisement d’une problématique sociale, psychique, artistique, esthétique, politique et linguistique, et elle se résout dans la triangulation qui sert de prémisse à cet essai. Le spectacle FAIRY QUEEN mis enscène par Ludovic Lagarde au Festival d’Avignon 2004, sur un texte d’Olivier Cadiot, est un modèle d’illustration de la problématique. Le témoignage de Gustavo Giacosa, acteur dans la troupe de Pippo Delbono, est également très précieux. FAIRY QUEEN 1 est le troisième opus (le terme musical n’est pas fortuit), après LE COLONEL DES ZOUAVES et RETOUR DURABLE ET DÉFINITIF DE L’ÊTRE AIMÉ, réalisé par le duo Olivier Cadiot et Ludovic Lagarde. Dans FAIRY QUEEN en particulier, il y a comme un effet de dédoublement du personnage sans que les frontières soient bien signifiées entre les différentes voix « parlantes ». Brièvement et par conséquent approximativement– l’objectif n’étant pas ici d’analyser en profondeur la poétique d’Olivier Cadiot –, on peut qualifier son écriture de moderne ou de post-dramatique ; on peut même supposer qu’au temps de Gertrude Stein, figure centrale de FAIRY QUEEN, Olivier Cadiot aurait fait partie de l’avant-garde. Tous deux ont en commun d’être des chercheurs de la plasticité de la langue. FAIRY QUEEN raconte l’histoire d’une fée contemporaine qui remonte le temps pour répondre à une invitation à déjeuner de la célèbre américaine. Après une longue errance en apesanteur, elle atterrit dans le salon du 27 rue Fleurus où elle est reçue par Alice Toklas, autre personnage historique qui fut la secrétaire, gouvernante et compagne de Gertrude Stein. Il convient, pour la clarté du propos, de rappeler quelques éléments succincts de la biographie de Gertrude Stein. Née en Pennsylvanie en 1874, émigrée à Paris en 1906 où elle mourut en 1943, écrivain et amateur d’art moderne, elle fit de son salon le lieu de rencontre de tous les peintres et écrivains de l’époque, de Picasso à Hemingway. Elle a laissé une œuvre littéraire qualifiée de « cubiste » où elle expérimente une « répétitivité » qui n’est pas sans évoquer la musique composée sur le même procédé. Ses dîners festifs et artistiques, où chaque invité se voyait attribuer un rôle à travers le nom d’un homme illustre, étaient très prisés. Gertrude Stein vivait une relation homosexuelle avec Alice Toklas. Dans la mise en scène de Ludovic Lagarde, la fée, personnage de pure fiction, est interprétée par Valérie Dashwood, et les deux personnages historiques, Getrude Stein et Alice Toklas, respectivement par Philippe Duquesne et Laurent Poitrenaux. Parmi les combinaisons possibles dans le jeu masculin/féminin, personnage de pure fantaisie — modèle réel, pourquoi ce choix-là ? Ludovic Lagarde avoue n’avoir été guidé par aucune intention particulière et explique : « Le texte FAIRY QUEEN m’a été livré par Olivier Cadiot pendant que l’on jouait RETOUR DURABLE ET DEFINITIF DE L’ETRE AIME. D’emblée s’est imposée l’idée qu’il était destiné au trio de comédiens qui était alors sur scène. De plus, RETOUR DURABLE ET DÉFINITIF DE L’ÊTRE AIMÉ se termine par un solo vocal féminin ; la parole de la fée est comme le prolongement de ce solo. Valérie Dashwood devenait de fait la fée et, par conséquent, les deux autres rôles revenaient à Laurent Poitrenaux et à Philippe Duquesne. »
Pour les deux comédiens, il y eut la même évidence d’ordre purement conjoncturel, confortée par des similitudes morphologiques entre les acteurs et les modèles photographiques. Enfin, dit Laurent Poitrenaux, le travestissement était d’autant plus justifié que « nous savions que le rapport au réalisme, la crédibilité ne seraient pas un vecteur de travail. » Dans un contexte de coïncidences si frappantes, ce dernier argument, faisant du travestissement un levier pour subvertir le réalisme, voire la réalité, me semble plus significatif que le pur caprice du hasard. Aux parallélismes et/ou inversions déjà cités relatifs aux caractères des « personnages » et à leur distribution, s’ajoute la référence shakespearienne. Car si dans la lecture on convoque ALICE AU PAYS DES MERVEILLES, dès le titre s’impose LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE. Dans la féerie shakespearienne, le travestissement permet à l’inconscient d’avancer démasqué ; les sexes s’entremêlent, l’érotisme triomphe à travers les fantasmes les plus inavouables, l’ordre sexuel, social et moral est bousculé. À quels jeux s’adonnait Gertrude Stein dans son salon, lorsqu’elle organisait ses soirées mondaines où chaque invité était distribué dans le rôle d’un homme illustre ? Sans doute étaient-ils plus innocents, mais il y a quelque similitude dans cette façon de jeter le trouble dans les identités. Ajoutons à cet état de confusion et de références qui circulent entre la réalité et la littérature, entre la fiction et l’histoire, que le texte d’Olivier Cadiot se présente comme un long monologue, écrit à la première personne, qui épingle avec humour et ironie l’art moderne. Ne faut-il pas voir dans ce « je » qui s’avance masqué en fée l’auteur lui-même ? Citons enfin un dernier détail : le corps est probablement le terme qui a la plus grande occurrence dans FAIRY QUEEN, l’action principale de la fée étant de réaliser des performances « avec des chorégraphies de corps ». En résumé, la proposition théâtrale dans son intégralité affiche une redondance, une saturation de signes ou, au contraire, cachés, placés sous le signe de l’excès. Excès, saturation, redondance, qui sont les caractères de l’esthétique baroque et de l’hystérie. Le corps travesti et son rapport avec l’inconscient deviennent pour ainsi dire le sujet même de FAIRY QUEEN.
Je ne suis pas là où je pense, je suis là où je parle
Jacques Lacan
Une fois l’enjeu accepté, comment s’y prend-on lorsqu’on est un homme pour interpréter un personnage féminin, même si on n’adopte pas un code théâtral réaliste ? À travers cette question se pose la problématique inépuisable de l’art de l’acteur. Au théâtre, disait Jean Vilar, « l’habit fait le moine ». Pour autant, l’habit fait-il le sexe ? Pour Philippe Duquesne, la réponse est un oui franc. Pour lui, c’est le gilet bustier très ajusté qui l’a corseté dans le personnage « masculin » de Getrude Stein. Elle était grande, carrée et un peu « homme ». Philippe Duquesne avoue avoir eu beaucoup de plaisir à se glisser dans une enveloppe de femme dont la prestance physique respirait l’autorité, la virilité. C’est bien l’image d’une maîtresse femme qu’il nous donne à voir : longue robe sobre, chaussures à gros talons, pas de perruque, silhouette haute et carrée, torse virilement bombé, coudes soudés au corps, mains très expressives, voix grave et ton affecté évoquant plus la caricature de l’esthète fat et mondain que le féminin. Pour Laurent Poitrenaux, ce sont les chaussures qui lui ont permis d’entrer dans la peau d’une femme : silhouette élancée, longue robe sombre, souliers à talons, perruque noire coupée au carré, voix naturelle, démarche souple, légèrement nonchalante, le contraire de ce que l’on pourrait appeler une allure virile. Dans les deux cas, l’illusion est parfaite, de prime abord, pour celui qui n’aurait pas lu le programme ; sur scène, il y a deux morphologies « féminines » fort probables bien que différentes. Pour Gustavo Giacosa, « se travestir fait partie du processus de transformation de l’acteur sur scène» ; l’acteur de Pippo Delbono, à travers ses images de femmes fatales longilignes, avec perruques et boas, juchées sur des talons aiguilles, moulées dans de longues robes de soirée ou dans des tailleurs stricts, excelle dans l’art du faux semblant. Le costume transforme de fait. Pour la suite du travail, l’imaginaire s’est nourri en « imitant » la réalité : les photographies des deux personnages historiques pour les comédiens de FAIRY QUEEN, le jeu de mains d’une grand-mère pour Laurent Poitrenaux, l’observation de travestis dans un cabaret argentin pour Gustavo Giacosa. Mais le costume, la voix, la démarche, l’allure, les pauses ne sont que l’enveloppe extérieure du corps. Après avoir épuisé la réserve des signes extérieurs, les acteurs sont allés chercher dans leurs propres corps. Corps entraînés par diverses disciplines : la danse avec Odile Duboc pour Laurent Poitrenaux, le travail corporel plutôt burlesque fait en compagnie de Jérôme Deschamps pour Philippe Duquesne, le training oriental appris chez Eugenio Barba pour Gustavo Giacosa. La parole devient plus opaque lorsqu’il s’agit de décrire les mécanismes à l’œuvre. « La robe ou le costume dessinent les contours d’un territoire que le terme personnage ne suffit pas à décrire dans sa vastitude », dit Gustavo Giacosa, et il ajoute : « Jusque-là, le jeu partait de l’extérieur (les costumes); à partir de cette rencontre (celle de l’équipe de Pippo Delbono), j’ai expérimenté un travail qui part de l’intérieur (un travail du corps) et, selon des logiques totalement différentes (les logiques du corps justement), s’en va rejoindre l’extérieur et par conséquent le costume. »
Les formulations mystérieuses de Gustavo Giacosa trouvent une concrétisation dans le jeu de Laurent Poitrenaux dont le corps fournit les signes d’un dysfonctionnement permanent : la voix reste grave, les coudes sont collés au buste, les avant-bras sont flexibles comme prêts à se déployer, la rigidité de la posture générale du corps est d’autant plus fragile qu’elle contraste avec la volubilité des poignets et des mains ou les acrobaties vocales. Et de temps en temps, la construction de ce schéma corporel semble sur le point de s’écrouler sous les coups de boutoir de cette « poussée du dedans vers le dehors » : un éclat de rire ou de colère, le buste qui s’ébranle, la voix qui se met à jouer de toute l’amplitude entre les graves et les aigus sèment le doute dans les sens du spectateur. Devant nous, il y a un corps perturbé et perturbant, à la fois familier et étrange ; telle l’Olympia du conte d’Hoffmann que l’on voit vivante quand on la croit morte et morte quand on la croit vivante, ici, le corps de l’acteur joue de la confusion entre l’homme et la femme. Nous voilà plongés dans le domaine du simulacre ! Un corps perd le contrôle de lui-même et laisse apparaître un autre corps. Je est un autre ou, pour le dire à la manière de Freud, à l’intérieur de mon corps il y a un autre corps qui parle. Une fois les chaussures de femme enfilées, Laurent Poitrenaux cherche « comment ça parle et non comment ça marche ». Quel est ce territoire, comment le définir autrement que par défaut, par ce qu’il n’est pas, par l’impossibilité à le nommer ? Que va-t-on y chercher ou plutôt de quoi est fait ce ça qui parle lorsqu’il n’est plus intéressant de marcher ?