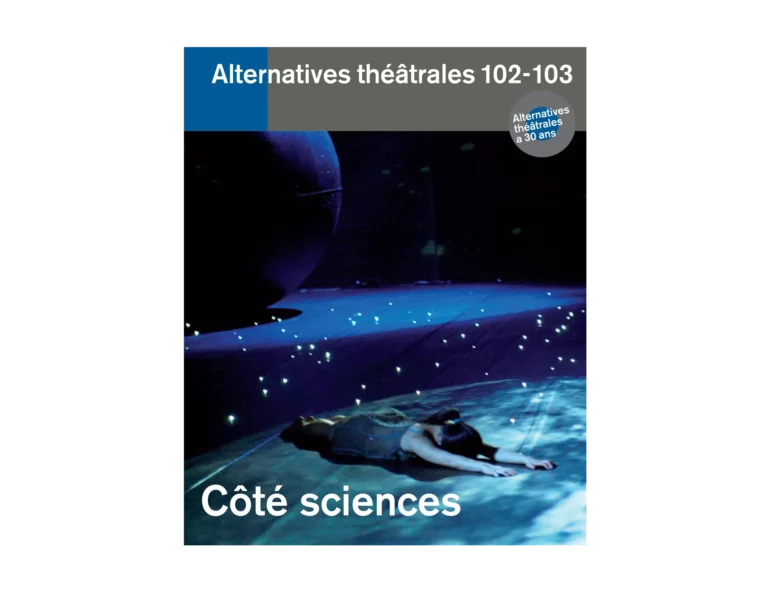« ET QUI VERRAIT la nature telle qu’elle est ne verrait que le derrière du théâtre…»
Fontenelle
C’était dans la salle de répétition du TNS à Strasbourg. J’avais été appelée « en consultation » pour expliquer le passage du SIDEREUS NUNCIUS (Le Messager des Étoiles) où Galilée raconte comment il a observé, grâce à sa lunette, quatre astres que personne n’avait vus jusqu’alors, entourant Jupiter ; et comment de ce que la disposition de ces astres par rapport à Jupiter variait d’un jour (ou plutôt d’une nuit) à l’autre, il avait conclu que ces astres n’étaient pas des étoiles situées dans la ligne de mire à l’arrière plan de Jupiter mais bien des satellites tournant autour de Jupiter, comme la lune autour de la terre. Preuve selon lui que tout ne tournait pas autour de la terre, comme le prétendaient les tenants du système géocentrique. Jeanne, ma fille, m’avait enjoint de faire en sorte qu’elle-même et les autres comédiens et danseuses sortent de là avec une idée précise (et non pas « poétique ») du phénomène. Jean-François Peyret, sur un ton moins impérieux, m’avait à peu près tenu le même langage. Bref, je devais forcer les comédiens à se soumettre à la rigueur que l’on suppose (pas entièrement à tort) à la connaissance scientifique ; libre à eux d’en faire, ensuite, sur la scène, ce que bon leur semblerait dans leur interprétation des indications scéniques.
Je fis de mon mieux – que pouvais-je faire d’autre ? Mais je n’en menais pas large. Je sais trop bien que comprendre est une longue illusion qui vous file entre les doigts, un tissu qu’il faut sans cesse raccommoder ; sur le coup, on croit avoir compris, mais si on y revient un peu plus tard, on s’aperçoit qu’on a perdu le fil du raisonnement, que tout (ou presque) est à reprendre.
Je n’avais pas réfléchi que cette fois-ci je m’adressais non pas à des étudiants mais à des gens de théâtre, en train de monter un spectacle… dont l’objectif n’était pas de construire un savoir « solide » à force d’être remaillé, mais bien plutôt de saisir l’éclair de la première compréhension, sans intention d’y revenir, pour la transformer, dans l’instant et dans l’urgence du travail théâtral, en autre chose : un élément de spectacle.
C’est ce que je compris (j’aurais dû y réfléchir plus tôt) lorsque, une fois mon explication du texte de Galilée terminée, je vis Olivier Perrier, jusque là attentif, concentré et silencieux, bondir comme un diable hors de sa boîte, se diriger vers les fond du plateau et s’emparer d’une espèce de buffet, ou d’armoire, dont on aurait ôté les portes, qui traînait là (résidu d’un spectacle précédent?). Revenant sur le devant de la scène, il nous présenta, à Jean-François, aux comédiens étonnés et à moi-même médusée, son idée de mise en scène : il serait Galilée racontant sa découverte ; chacune des nuits d’observation décrite dans le texte serait figurée par un aller et retour d’un bord à l’autre du plateau, du buffet poussé par lui ; Frédéric Kunze (figurant Jupiter) et les quatre comédiennes (les satellites) seraient cachés dans le buffet dont on ne verrait que le dos depuis la salle ; à chaque passage, chaque nuit, Frédéric sauterait du buffet comme on sautait autrefois des autobus ouverts à l’arrière, entouré de ses « satellites », apparaissant ainsi au public selon la disposition, variable d’une nuit à l’autre, que décrit Galilée dans le SIDEREUS NUNCIUS.
J’étais sidérée, si je peux me permettre ce jeu de mots, par la pertinence de la transposition scénique du texte de Galilée que venait d’inventer Olivier Perrier. Car il s’agissait bien d’une transposition et nullement d’une illustration. Ce qui était présenté ainsi aux spectateurs, ce n’était pas ce qu’avait vu Galilée : ce dernier s’était d’ailleurs lui-même chargé d’en donner une illustration, en intercalant dans le cours du texte du SIDEREUS NUNCIUS, des lignes figurant les dispositions relatives de Jupiter (schématisé par une petite boule) et de ses quatre satellites (désignés par des astérisques, comme l’étaient conventionnellement ce qu’on appelait encore les « étoiles », sans distinguer les étoiles des planètes). Olivier Perrier, lui, venait de traduire au moyen de corps bien réels (ceux des acteurs) non seulement les diverses distributions relatives de Jupiter et ses lunes observées par Galilée, mais également l’excitation mentale de Galilée cherchant à voir ces corps (tout aussi réels, mais célestes) qui se dérobent à sa vue durant le jour et qui, la nuit, ne sont jamais là où il les attend, toujours disposés autrement – au point même qu’un soir l’un des satellites n’est pas au rendez-vous et manque à l’appel. Olivier Perrier avait compris (senti, perçu?) que ce qui s’était passé durant ces nuits mémorables de 1609 était un véritable corps-à-corps engageant Galilée, corps doué de vision, de raison et de langage, et les corps célestes inanimés mus par des forces dont on n’avait pas encore d’interprétation.
Pour dire les choses autrement, Olivier Perrier avait transformé un texte (celui de Galilée) en une partie de cache-cache. Partie de cache-cache historique d’où est sortie la science moderne – peut-on dire, avec un peu de grandiloquence et donc cum grano salis. Il s’était emparé, pour en faire un ballet, de l’idée qui est au centre du récit de Galilée, l’idée que « quelque chose » est caché qu’il faut trouver, ou retrouver parce qu’il est nécessairement là, quelque part. Fort, da… Ce « quelque chose », c’est bien sûr le satellite mystérieusement absent lors d’une certaine nuit d’observation, mais c’est aussi, et en même temps, l’explication de cette disparition. Certes, Olivier Perrier, lorsqu’il remplace Jupiter et ses satellites par les corps des comédiens alternativement cachés et visibles, « traduit » en ballet la partie de cache-cache dans laquelle il est engagé. Mais ce n’est pas tout, car, dans le même temps, il donne à Galilée le rôle principal – c’est lui qui parle, c’est lui qui observe, c’est lui qui pousse l’armoire alourdie du poids des comédiens et l’effort qu’il produit est visible –, il met en scène, à côté du ballet des astres, l’excitation, pénible voire même douloureuse, qui précède l’invention de l’explication.