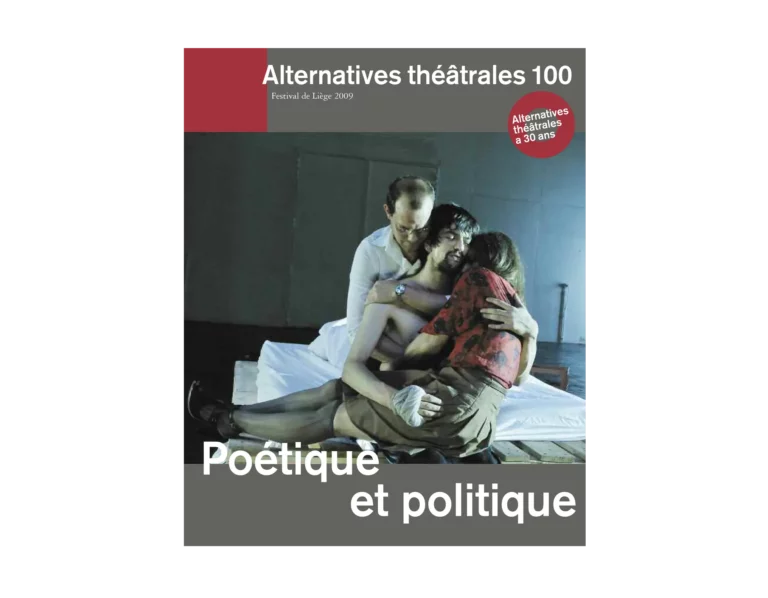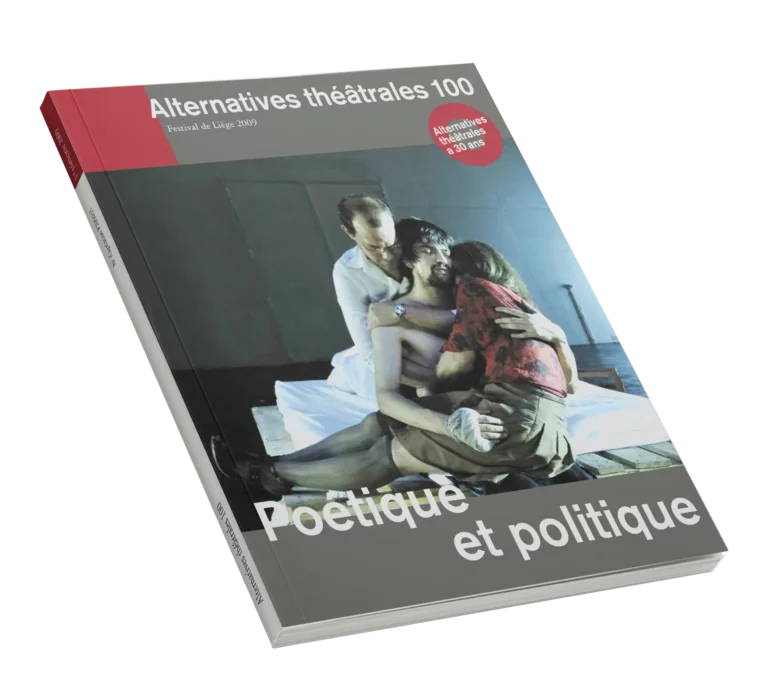NANCY DELHALLE : À travers les projets auxquels vous avez participé comme acteur, vous vous situez dans une certaine lignée de théâtre, un théâtre qui inscrit au cœur de la pratique un rapport engagé au monde. Pour le Festival de Liège, vous préparez LE CHAGRIN DES OGRES pour lequel vous élaborez un texte et assumerez la mise en scène. Quelle est la genèse de ce projet ?
Fabrice Murgia : Les projets auxquels j’ai collaboré successivement depuis ma sortie de l’école en 2006, présentent en effet une préoccupation sociale liée au théâtre. La genèse du CHAGRIN DES OGRES remonte à l’édition 2007 du Festival de Liège, lors d’un travail avec Jan-Christoph Göckel. Dans le cadre d’une master class coordonnée par Théâtre & Publics, Thomas Ostermeier était venu chapeauter un travail avec quatre étudiants en mise en scène de la Ernst-Busch sur des textes de Martin Crimp. Je travaillais la pièce FACE AU MUR et je me suis lié d’amitié avec Jan-Christoph, un des quatre étudiants berlinois, aujourd’hui metteur en scène associé à la Schaubühne. Pour ce travail, Jan m’a demandé de travailler à partir du blog de Bastian Bosse qui, en novembre 2006, avait commis une fusillade dans son école. Nous étions en février 2007, c’était donc récent. Ensemble, nous avons traduit ce blog. La semaine suivante, j’ai vu le spectacle de Lars Norén, LE 20 NOVEMBRE, où Anne Tismer jouait le blog de Bastian. La matière m’intéressait et j’ai voulu m’y confronter, donner ma vision de cela. J’ai ensuite réuni trois comédiens, un vidéaste, un musicien et je leur ai demandé d’amener leur carnet de jeunesse. Il y avait beaucoup de liens avec ce blog de Bastian, et la question de savoir pourquoi, chez lui, cela a dévié m’a intéressé. La matière est donc assez générationnelle.
N. D. : Cette prise en compte de la dimension générationnelle revient à plusieurs reprises dans vos propos. Pouvez-vous expliciter ce qu’elle recouvre ?
F. M. : Il s’agit de parler d’un passage, l’adolescence. Mais aujourd’hui, on « devient » adolescent de plus en plus tôt, à dix ou onze ans, et paradoxalement, à trente ans, on peut toujours habiter chez ses parents. C’est sans doute un aspect du passage à l’âge adulte qui sépare ma génération de celle de mes parents, immigrés italo- espagnols, dont le rapport au travail était plus direct. Pour eux, il y a un monde de différence entre ce que montre le théâtre et leur vision du monde liée au travail. J’avais envie de traiter de ce passage à l’âge adulte. J’ai parlé de cet aspect du projet à Jean-Louis Colinet. Je lui ai dit que je ne voulais pas poser de thèse de manière frontale, mais exprimer un état d’esprit. Resti- tuer une œuvre sensorielle autour des témoignages d’un jeune homme et d’une jeune femme, arrivant à un cap de leur vie, dans une certaine époque qui est la nôtre. C’est difficile à expliquer avec les mots : ce sont des sons, des images de notre enfance. Je ne livre pas de noms, pas de dénonciation. Ou alors, les références sont brouillées par ces espaces générationnels. Par exemple, un personnage de la pièce, Lætitia, est influencée par John Lennon car son père lui a fait écouter John Lennon… et il ne s’agit pas de parler de John Lennon, mais du rapport que Lætitia entretient aujourd’hui avec la figure John Lennon. C’est ente les lignes que ça se joue, dans le background de Lætitia. Le travail avec les comédiens est ainsi très spécifique, très détaillé.
N. D. : Il semble que le travail des formes soit aussi très générationnel. Il passe par ce dont vous nourrissez le spectacle, les sons, les images. Vous parlez aussi de choralité, de « scénario choral»…
F. M. : Matthieu Reynaerts, qui est scénariste pour le cinéma, nous aide à construire un « scénario choral ». Les scènes ne sont pas forcément dans l’ordre et les situations ne sont pas forcément liées mais se répondent. Au final, tout semble logique, pour exprimer un malaise global lié à l’adolescence… Dans la manière de modifier les rythmes et désordonner les temps, je me sens influencé par le travail de Joël Pommerat au théâtre, ou d’Alejandro Gonzales Inarritu au cinéma, par exemple.
N. D. : Mais qu’en est-il de l’objet, du sujet, dont vous vous saisissez ? En somme, pourquoi, comment « faire théâtre de ça » ?
F. M. : Je crois que c’est dans la nature de l’artiste de trouver injuste la réalité dans laquelle il évolue. Je ne peux donc pas retranscrire la réalité sans que cette injustice, ou plutôt ce malaise social en découle. Je ne trouve pas que mon spectacle soit politique. En fin de compte, il l’est, mais ma démarche pour le faire n’est pas du tout politique.