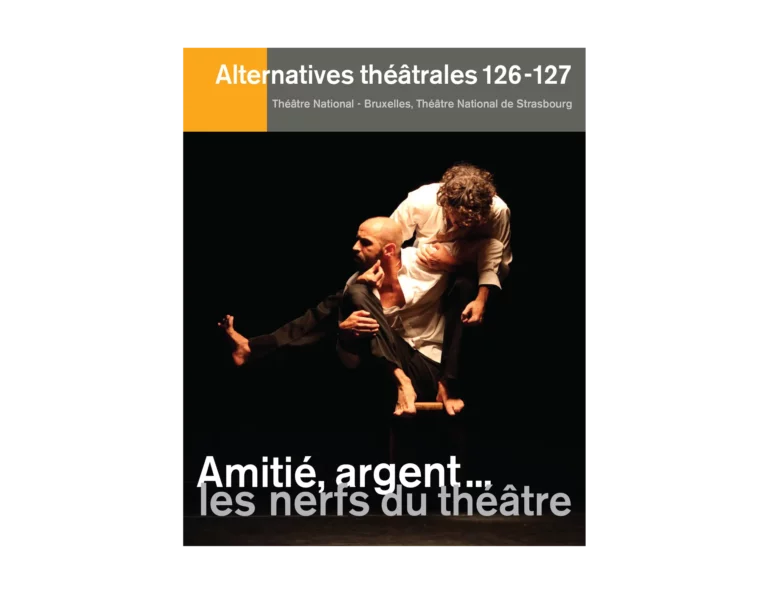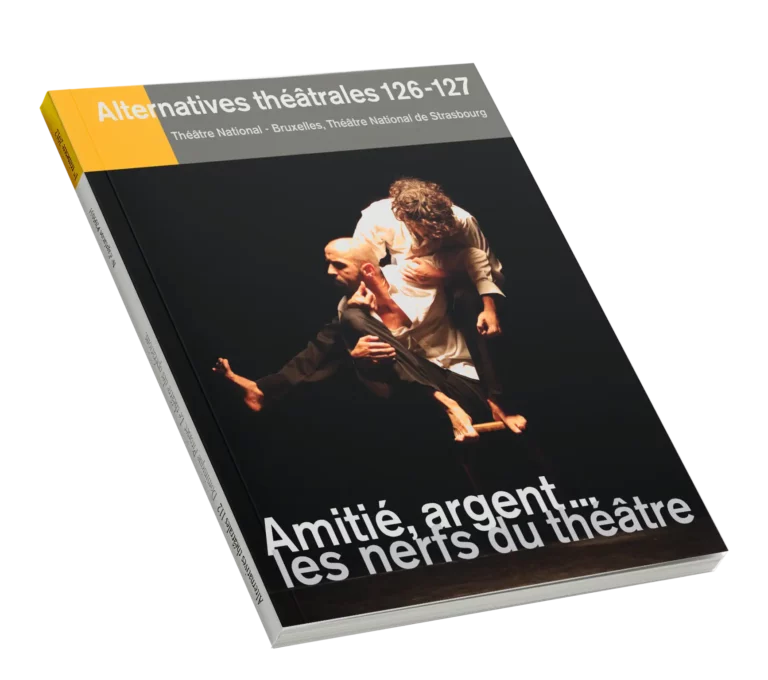QUELS ZOZOS que ces deux là. Entre eux, ils se surnomment Didi et Gogo. Au milieu de nulle part, ils attendent un certain Godot. Ils se chamaillent, s’exaspèrent, s’étreignent en se donnant des grandes bourrades dans le dos, essayent de se quitter, n’y arrivent pas, se détestent, tombent dans les bras l’un de l’autre, boudent, s’entrai- dent, se balancent des vacheries, s’appellent par leurs petits noms. Et ils se re-chamaillent, se font la tête, se lancent des piques… et se font une scène à l’idée que l’un a cessé de penser à l’autre, même un court instant. « ça fait combien de temps que nous sommes tout le temps ensemble ? », demande Estragon. « Je ne sais pas. Cinquante ans peut-être », lui répond Vladimir.
Godot ne viendra pas. À la place, Gogo et Didi auront la visite de Pozzo et Lucky. Le maître et l’esclave. Ces deux-là ne se chamaillent pas. Pour se chamailler, il faut reconnaître l’autre comme un égal. Ils ne s’appellent pas par de petits noms. Pozzo appelle Lucky « porc », et Lucky n’appelle pas Pozzo, ce ne serait même pas envisageable.
Voilà comme on les redécouvre, les deux increvables clodos de Samuel Beckett, tels que Jean-Pierre Vincent les met en scène, dans cet EN ATTENDANT GODOT qu’il a créé à Marseille, au Théâtre du Gymnase, le 14 avril 2015, et qui depuis tourne – et va continuer à tourner – un peu partout en France. Car c’est bien une totale redécouverte que le metteur en scène offre de la pièce, avec ses formidables acteurs : Charlie Nelson (Vladimir), Abbes zahmani (Estragon), Alain Rimoux (Pozzo), Frédéric Leidgens (Lucky) et Gaël Kamilindi (le garçon).
Le « théâtre de l’absurde » dans lequel a longtemps été catalogué Samuel Beckett en prend un sacré coup, au point même que l’on se demande comment on a pu enfermer le texte de Beckett dans un tel concept, où d’ailleurs l’écrivain ne s’est jamais reconnu. Mais c’était une autre époque, et GoDoT a été un tel tremblement de terre, une telle rupture avec le théâtre d’avant-guerre, qu’il fallait bien de grandes idées générales pour l’apprivoiser.
Il n’y a pas d’absurdité dans le GoDoT de Jean-Pierre Vincent – si ce n’est celle, foncière, de la condition humaine, qui est au cœur de la pièce. Il y a au contraire beaucoup de sens dans ce que Beckett écrit, tel qu’on l’entend de manière neuve ici. Même si c’est un sens qui ne veut pas dire son nom, dont Beckett se méfie, avec lequel il joue et qu’il déjoue autant qu’il le peut, car il écrit après la guerre, après l’extermination, après cet événement qui a fait perdre son sens à l’expérience humaine.