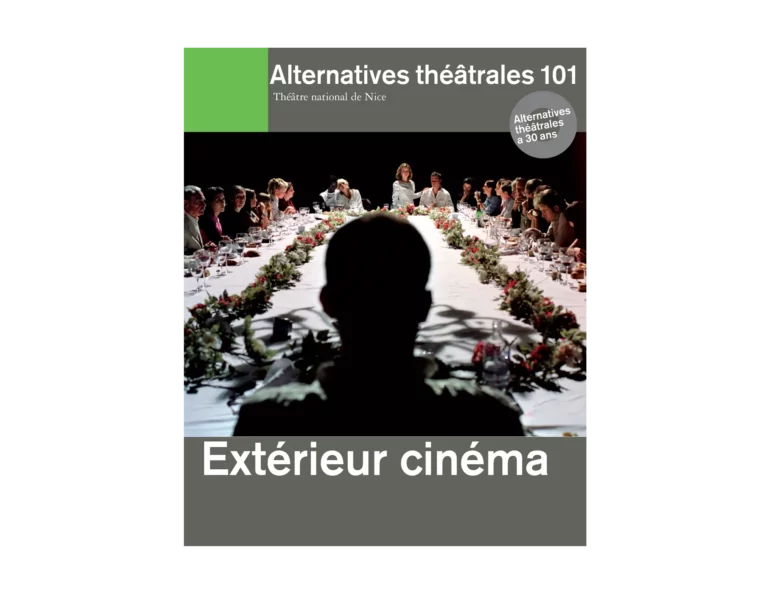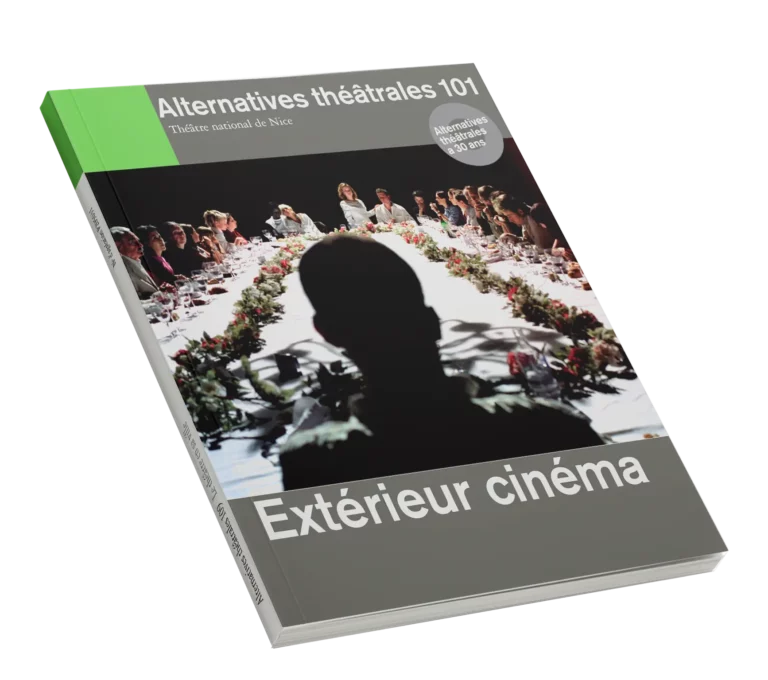Institut Grotowski, Wroclaw 12 – 16 janvier 2009 — (notes d’un journal polonais)
Après ces journées passées là-bas où son théâtre s’est accompli j’ai l’idée de réunir les phrases de Grotowski comme des aphorismes d’un maître zen qui concentre une pensée et invite à l’interprétation. Flaszen reconnaît l’autre sens de ces confidences : « Par nos confidences, nous prolongeons notre vie ».
Un exemple cité par lui-même :
- Il faut que les coulisses soient propres.
- Mais personne ne voit ce qu’il ya derrière, lui répond quelqu’un.
- Dieu voit , répondit-il en souriant.
Un autre. A Irvine, pour la présentation des exercices de ses élèves il n’avait invité que quatre personnes dont Jan Kott qui me raconte : « A un moment donné un cheval blanc est apparu. Grotowski réplique : « c’est quand même Dieu le plus grand metteur en scène ». C’est ainsi qu’il nommait le « grand hasard »
Grotowski a développé une éthique de la dévotion.
L’émotion de la rencontre avec la fille de Ryszard Cieslak, l’icône du Théâtre laboratoire . Ouverte, lumineuse, tout le contraire des images ultimes du père. Je me présente . « Je sais qui vous êtes, vous avez fait tellement pour mon père ». Cette révélation, entendue le soir d’avant le départ, me bouleverse : mes mots et mes textes sur lui étaient arrivés jusque chez eux. Le plus beau cadeau de ce séjour .
Promenade dans l’île, à côté de l’hôtel Tumski, promenade régulière, plaisir de la répétition et de tout ce qu’elle permet pour se replier sur soi, se retrouver. Je comprends Kant et Ibsen dont les pas étaient mesurés et les minutes chronométrés : contrairement aux grands « voyageurs » qui traversent le monde, eux, pensent le monde à partir d’un point précis. Comme Julien Gracq, Beckett ou Cioran. Bref, lors d’une de ces promenades sous la neige, à côté de la cathédrale, dans le creux d’un mur, protégé par un grillage, je m’arrête devant la sculpture en pierre, brute et forte, d’un Christ fatigué, Christ qui repose sa tête sur la paume de sa main, Christ qui est l’emblème de la Pologne, Christ que le Prince constant avait rendu célèbre, Christ dont Ryszard avait tellement intégré la posture qu’un soir, lorsque je le quittais, en me retournant, je l’ai vu, un peu saoul, se reposer pareil au Christ que j’avais sous mes yeux dans la nuit de Wroclaw .
« Si le comédien n’est pas capable de surmonter sa peur, de faire un saut de tigre, alors il n’est pas comédien » disait Grotowski en réclamant à tout un chacun de son groupe de « dépasser ses limites ». Et personne n’égala Ryszard.
Je demande à Peter Brook : « Tu aimes l’improvisation, lui pas. » « Grâce à l’improvisation je cherche à aller avec les comédiens aussi loin que le public peut nous suivre. Lui, il voulait aller encore plus loin. ». Brook formule la raison pour laquelle j’ai tant aimé son théâtre à lui pensé par rapport à nous et à …nos limites.
Grotowski travaillait la nuit, me dit amusé Mario Biaggini, « parce que le ministre de la culture dort », mais surtout pour aller le plus loin possible comme le raconte Marc Fumaroli : c’est au bout de la nuit qu’un jeune élève suédois descendit au cœur de soi-même d’où surgirent des chants qu’il ignorait et qui l’ont surpris, d’abord lui-même. La nuit, repli sur soi…l’obscurité, depuis longtemps, fut considérée comme étant le milieu le plus propice à la mémoire ! Norme de conduite dans les couvents et les lieux de méditation.
Grotowski tirait les rideaux pour « faire la nuit en plein jour ». Je me reconnais dans ce besoin de repli, dans ce besoin de fuir la lumière. Il y a longtemps, mon père entra dans mon bureau plongé dans le noir où seule une lampe éclairait la page : « La lumière doit être dans la tête, non pas sur la table », me dit-il ironiquement . Il ne savait pas que je répondais ainsi à un besoin interne et de concentration sur le travail et que, comme Grotowski, que je ne connaissais pas alors, je me réclamais d’El Greco qui, à midi, calfeutrait les fenêtres et allumaient les bougies. Sa tension dirigée vers la lumière mystique se nourrissait des pouvoirs de « la nuit en plein jour ». Grotowski s’apparente à ces « mystiques » ayant Saint Jean de la Croix comme chef de file pour qui l’esprit est le fils de la nuit. Mais on peut dire aussi qu’il a fait de la nuit son jour comme Staline ou les fêtards….qu’est-ce qui les relie ?
N’oublions pas les fêtes de fin de semaine à Wroclaw où les ermites du Théâtre laboratoire se livraient à de véritables bacchanales nocturnes. « Nous savions ce que c’est la fête » me disait Grotowski en surprenant le naïf que j’étais et qui entretenait l’illusion de l’austérité absolue de son équipe.
« Il voulait faire la nuit même en plein jour. » se souvient Ludwik Flaszen en me rappelant une de ses phrases : « chacun doit trouver sa part d’ombre »
« Nous appelons nuit la privation du goût dans toutes les choses » St.Jean de la Croix
Après une nuit dans un village polonais, à Grzegozevice, Grotowski nous invite à s’adresser à lui, si on le souhaite, individuellement. Sous l’emprise de l’expérience vécue je m’approche et je lui murmure : « Comment en parler ? ». Ma question, je l’ai appris de années plus tard, l’avait touché. Et , après avoir été un des rares invités à Pontedera aux premières présentations d’Action, je me vis confier la mission d’en témoigner publiquement au théâtre des Bouffes du Nord : « Parle, m’a‑t-il dit la veille de la rencontre, mais n’oublie pas que c’est important pour moi ! ». Jamais indication reçue ne fut plus laconique et efficace. Je devais « trouver les mots ».
On évoque ici les sorties nocturnes lors des activités parathéâtrales, dans des forêts surtout. D’autres l’ont imité et chaque fois cela m’a révolté : « je veux aller dans la forêt, mais uniquement en sa présence. Parce qu’il a abandonné le théâtre et se trouve là, dans cette nuit, à côté de moi que l’expérience me touche, sinon je préfère être plutôt seul qu’en compagnie des leaders étrangers qui s’arrogent des pouvoirs usurpés, dépourvus d’impact. Sans lui, pas d’expédition ! »