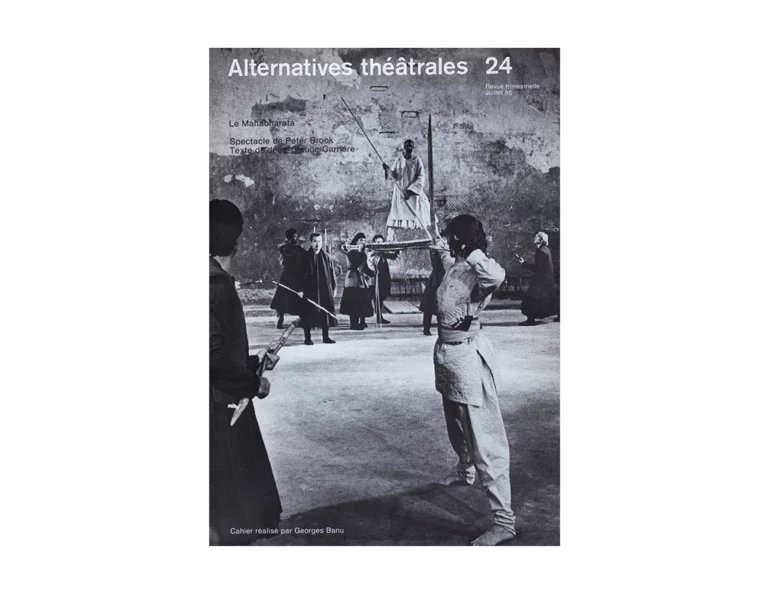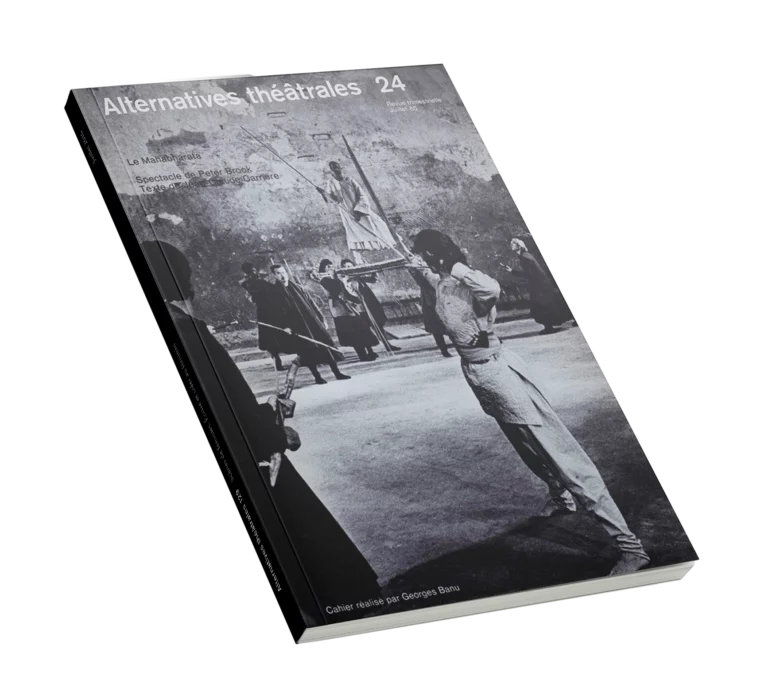“··· donner une importance essentielle à la stricte logique et placer la rectitude morale au-dessus de tout est une cause fréquente d’errements Il existe une voie plus élevée que celle de la rectitude morale mais la découvrir est difficile et exige la plus haute sagesse. Au regard de cette Voie, les principes logiques sont véritablement dépourvus de signification. On ne saurait connaître ce dont on n’a pas une expérience immédiate. Pourtant, il est un moyen de s’instruire de la vérité alors même qu’on n’a pas été capable de la discerner par soi-même. C’est de s’entretenir avec d’autres personnes. Il est fréquent que l’on puisse donner des conseils sans pour autant avoir atteint soi-même la perfection. Il s’agit du principe connu des joueur de go sous la formule : « l’avantage est au spectateur ».
Hagakuré, Livre I in : Mishima, Le Japon moderne et l’éthique samouraï collection Arcades, Gallimard, Paris 1985, p.55
Georges Banu : Quelle relation existe-t-il entre musique et action dramatique dans Le Mahabharata ?
Toshi Tsuchitori : C’est une relation basée sur la sensibilité. Il y a une différence fondamentale entre le fait d’utiliser une musique pré-enregistrée et le fait de faire appel à des musiciens. La relation n’est plus entre l’humain et le matériel mais entre l’humain et l’humain. Cette relation de personne à personne est, pour nous, très importante.
G. B. : La musique du Mahabharata est une sorte de musique orientale, mais, il ne s’agit ni de musique japonaise ni réellement de musique indienne, etc. Pouvez-vous préciser de quel genre de musique il s’agit ?
T. T. : Pour le Mahabharata, la référence musicale est l’Inde, bien évidemment, mais j’ai cherché également dans d’autres musiques et notamment dans celles que j’ai moi-même étudiées dans les différents pays que j’ai visités. C’est ainsi que nous utilisons des matériaux et des instruments de musique venus d’endroits très différents : des instruments africains, japonais, iraniens, australiens, etc. Mais, dans leur application, ces « outils » perdent leurs connotations culturelles. C’est ainsi que le spectateur ne sentira jamais les données originelles des moyens mis en œuvre.
Vincent Dehoux : Dans un ordre d’idées tout à fait différent, j’aimerais demander à Toshi de quelle façon il a agi avec les autres musiciens dans la mesure où ces derniers — contrairement à lui — n’avaient aucune expérience d’un travail théâtral.
T. T. : En effet, les musiciens qui m’entourent sont des musiciens purement classiques, des musiciens de musique pure. Il fallait donc leur faire entrevoir l’importance de la relation dont je parlais plus haut, afin qu’ils accomplissent, à leur tour, cette démarche visant une relation sensible entre les acteurs et eux-mêmes. Au début, ils ne faisaient que jouer de la musique et encore de la musique … Maintenant, c’est tout différent : ils jouent véritablement et avec les acteurs, et avec l’action. Ils sentent de plus en plus la relation qui doit exister entre musique et action. De sorte que les changements ne sont pas seulement, à l’heure actuelle, de nature purement musicale, mais prennent en compte l’action dramatique.
Peter Brook : Pour comprendre la musique de théâtre, il faut savoir ce qui la différencie de la musique non théâtrale. Dans la musique de théâtre, la relation s’établit entre le son et le silence, la vibration du son en relation avec le silence.
Le mouvement est, d’ailleurs, toujours en relation avec autre chose. Dans le théâtre, il ne faut pas voir le jeu des acteurs ou l’action dramatique, ou la musique : le jeu est une énergie se déplaçant non seulement à travers le silence mais aussi à travers l’espace. Le mouvement dans l’espace est à son tour affecté par de nombreux éléments (histoire, situation, intention, sentiment, etc.) qui créent différentes sortes de déplacements. La musique est une partie de ces mouvements. Le seul musicien que je connaisse qui ait compris profondément ceci, c’est justement Toshi : il possède ce«beat » fondamental.
Le travail musical commence par une écoute de la nature du mouvement accompli. La relation est constante et, non seulement avec l’histoire. Ainsi, quand les acteurs font preuve d’une énergie trop faible, la musique ne peut participer de façon efficace, et ce, quelle que soit la structure de l’action. En relation avec une énergie, une certaine musique devient toujours possible. Pour la découvrir, l’écoute des musiciens doit, à tout prix, être développée : non seulement être attentif au silence, mais porter également son attention à l’espace.
T. T. : Ecouter signifie également demeurer vigilant à n’importe lequel des événements musicaux.
P. B. : Vous écoutez le silence mais vous devez regarder aussi bien l’espace.
G. B. : Habituellement, Peter Brook et ses acteurs laissent une grande part à l’improvisation. Qu’en est-il de la musique ?
T. T. : Il est toujours très difficile d’aborder ce sujet. Il y autant de manières d’envisager l’improvisation que de musiques. Par exemple, quand je joue ma musique, j’applique la façon qui m’est propre d’improviser. Mais quand je joue avec, par exemple, des musiciens de jazz, mes propres critères ne sont plus valables. De même, quand je joue avec des musiciens indiens, il m’est nécessaire de m’adapter aux lois de l’improvisation qui sont les leurs.
G. B. : Est-ce que vous participez au Mahabharata aussi comme acteur et non seulement comme musicien ?
T. T. : Je ne sépare jamais l’acteur du musicien. Pour moi, quand le jeu de l’acteur est bon, cela produit une bonne musique et alors je peux me joindre à lui.
P. B. : Dans notre travail, si l’exécution n’est pas bonne (ce qui peut toujours arriver), il se produit une perte réelle au niveau du rythme : tout arrive au mauvais moment … On ne peut pas définir le rythme, ce que l’on peut dire, en revanche, c’est que lors d’une bonne représentation, le rythme est toujours là.
Propos recueillis par Vincent Dehoux