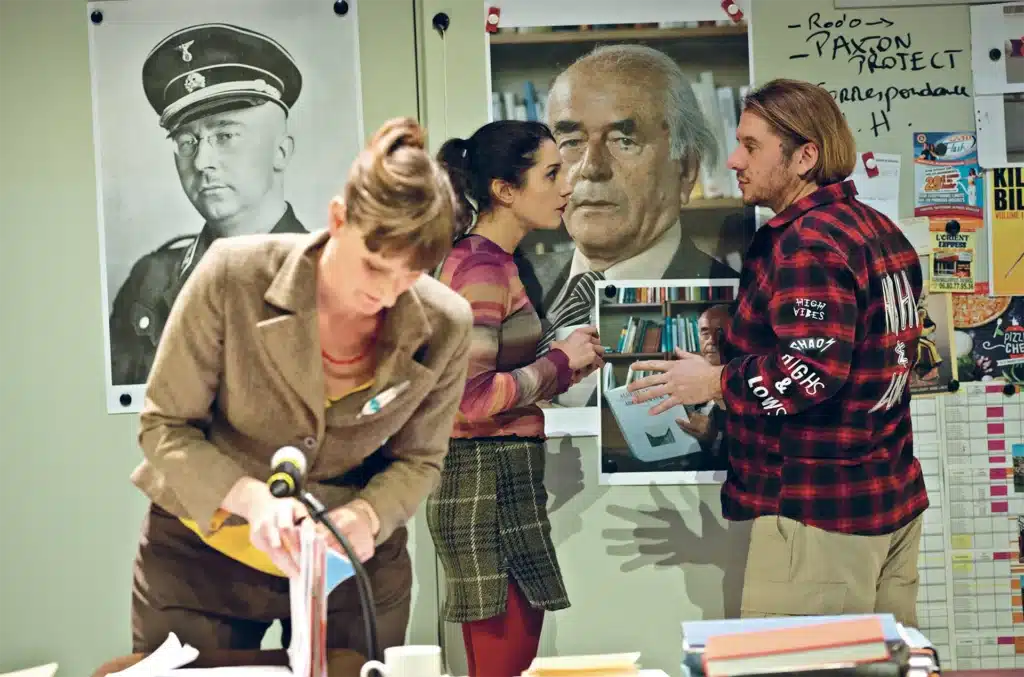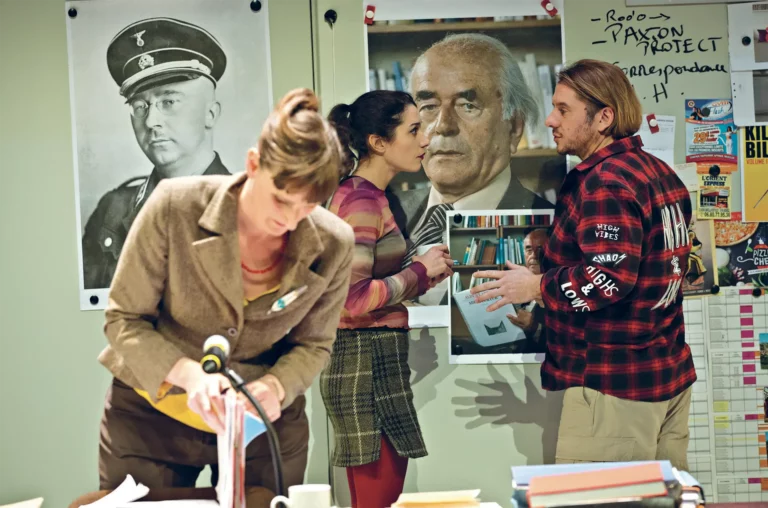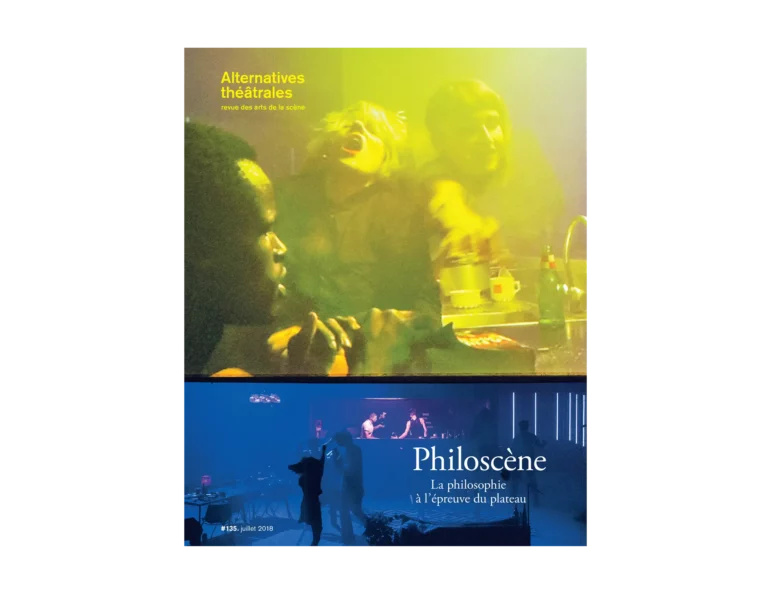MB
L’écriture de vos spectacles est insufflée par la volonté deleuzienne de fabriquer de la pensée en mouvement. Comment produire de la pensée au théâtre ?
BJ L’expérience est particulière à chaque fois, mais je pars du principe que les grands philosophes créent des mondes. Ce qui m’intéresse particulièrement au théâtre, ce sont les mondes. J’attends la même chose du théâtre que j’essaie de faire. La philosophie est un monde associé spontanément à une activité plutôt mentale, j’essaie de lever ce malentendu. La philosophie est très sensible, très liée aux questions de perception, d’adresse et de dialogue qui sont des problématiques théâtrales. J’ai travaillé à partir de Deleuze, Platon et Arendt, ces trois philosophes posent la question du dialogue. La philosophie vient de la place publique et doit y retourner. La pensée nécessite un dialogue. On retrouve chez Deleuze l’idée de faire de la philosophie avec des problèmes du réel. Penser en mouvement cela veut dire continuer de penser. Il y a ce qui est formulé sur le plateau et toute la traduction théâtrale qui découle de séquences de présence physique.
MB
Y‑a-t-il des limites à cette expérience et des publics plus réceptifs que d’autres ?
BJ Prenons trois expériences proches, mais différentes. En 2016, j’ai créé Afrika Democratik Room, aux Récréâtrales de Ouagadougou, avec des comédiens de différents pays d’Afrique de l’Ouest. On a joué pendant une semaine. Les habitants du quartier répétaient avec nous. Ils ne connaissaient pas Platon et avaient peu l’idée de ce qu’est un philosophe. Ils s’emparaient immédiatement de la situation et commentaient ce qui se disait, cela rebondissait facilement. C’est l’expérience du réel qui fait que cela advient. Le public des enfants du PetitZ, quant à lui, n’est que dans la curiosité : les enfants ne s’intéressent qu’au jeu et à la pensée. Passer une heure à manier des concepts leur convient très bien si c’est ludique. Enfin, Melancholia Europea a trouvé son propre public, par le bouche à oreille. Il y a obligatoirement de la pédagogie au sens deleuzien dans ma démarche. Je pars du principe simple que si ça me plait d’apprendre, il y a beaucoup de gens que cela peut réjouir aussi. Le théâtre sert à faire découvrir. Une limite serait de faire découvrir des choses dogmatiques, il est important de jouer et de faire vaciller les certitudes, sans être dogmatique. L’autre limite serait celle du spectateur qui se mettrait dans une posture de sachant et redouterait d’apprendre. Les spectateurs les moins munis culturellement sont les plus avides de ces propositions.