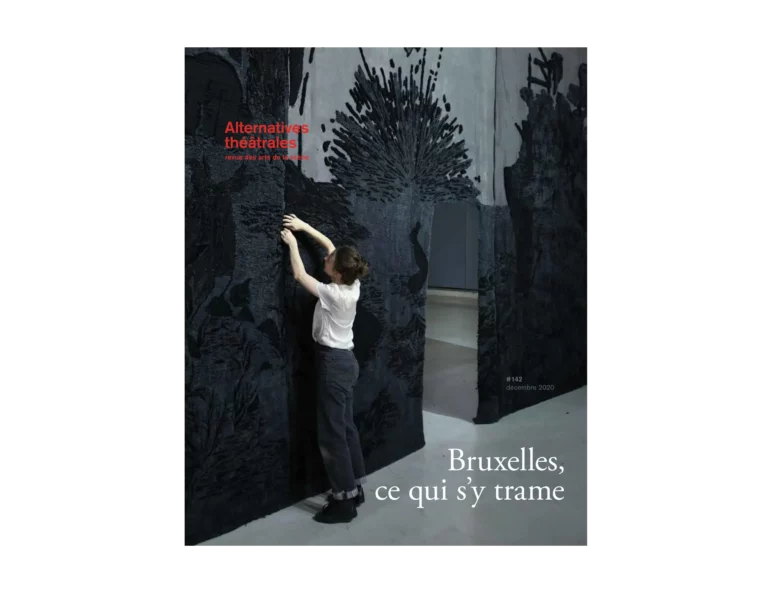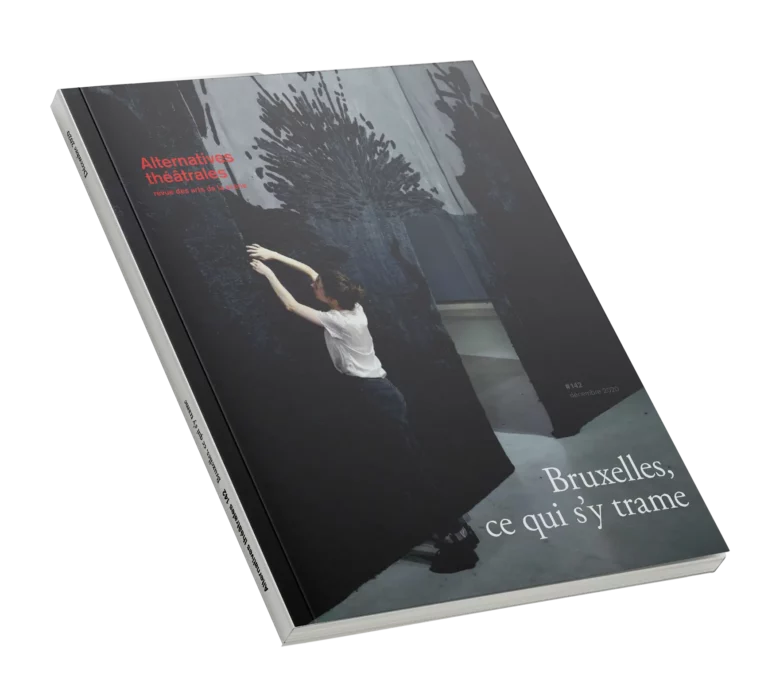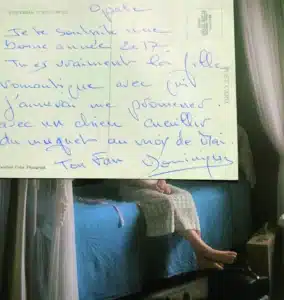On pourrait commencer par reposer avec Louise Vanneste cette question en apparence toute simple, presque enfantine dans son intention : pourquoi mettre la danse sur la scène ? Pourquoi a‑t-on voulu placer le corps dansant, cette fête du mouvement que tous les enfants s’approprient, sur l’espace réservé et séparé d’un plateau de théâtre, d’où il n’est plus adressé qu’aux regards ? Ou, pour le dire autrement : que devient un corps dansant une fois qu’il se présente non plus uniquement à d’autres corps avec qui il peut danser, mais aux regards multiples d’une assistance immobile et silencieuse ? En un mot : que fait la scène à la danse ?
Louise Vanneste a fait de ces interrogations certains des motifs inauguraux de son travail chorégraphique. La réponse qu’elle y apporte est sans doute celle-ci : la scène éloigne la danse du théâtre. Si le théâtre est tissu de paroles ou d’actions, la danse sera un enchaînement d’états. Si le théâtre se choisit des lieux et des personnages, la danse tentera de faire exister de l’espace autour des corps. Plutôt que d’exprimer par des gestes, elle donnera aux corps un milieu avec lequel se recomposer, une visibilité nouvelle à acquérir, une organicité à inventer.
Louise Vanneste a toujours résolument affirmé vouloir faire plutôt que dire, laisser voir ou sentir plutôt que montrer ou raconter. Home (2010), sa première création, se présentait déjà comme un solo radicalement détaché de toute intention thématique, narrative ou psychologique, une reprise en charge de la question du corps non pas comme support d’expression ou d’identification, mais comme interface matérielle et sensible, aux prises avec des forces cosmiques. Évoluant dans une scénographie à la fois minimale et omniprésente, le corps entrait alors en dialogue avec un mince fragment d’espace : un rectangle noir diffusant un mince halo de lumière blanche, comme une éclipse orthogonale suspendue à environ un mètre du sol et immergée dans une obscurité sans contours. Toujours à la lisière de la visibilité, éclairé de derrière par une lumière elle-même indirecte, le corps de la chorégraphe cessait d’être le véhicule de motifs identifiables pour devenir la part mouvante de cette configuration spatiale : un météore.
Lorsqu’on interroge la chorégraphe sur cette distance revendiquée avec la dimension narrative (chose somme toute assez courante s’agissant de la danse contemporaine), ce qu’elle exprime ne renvoie pas tant au récit qu’à la question de son format imposé (l’inévitable structure début-milieu-fin), à l’exigence de lisibilité que cette forme prescrit implicitement, à celle presque aussi impérieuse de traiter d’une thématique, d’avoir un « sujet », d’être à propos de quelque chose ou d’exhiber une « logique ». En somme, à la demande faite à la danse de se comporter comme un langage : d’avoir sa grammaire et ses énoncés, ou, à tout le moins, de s’interroger sur les conditions auxquelles elle peut, comme danse, produire son propre discours.