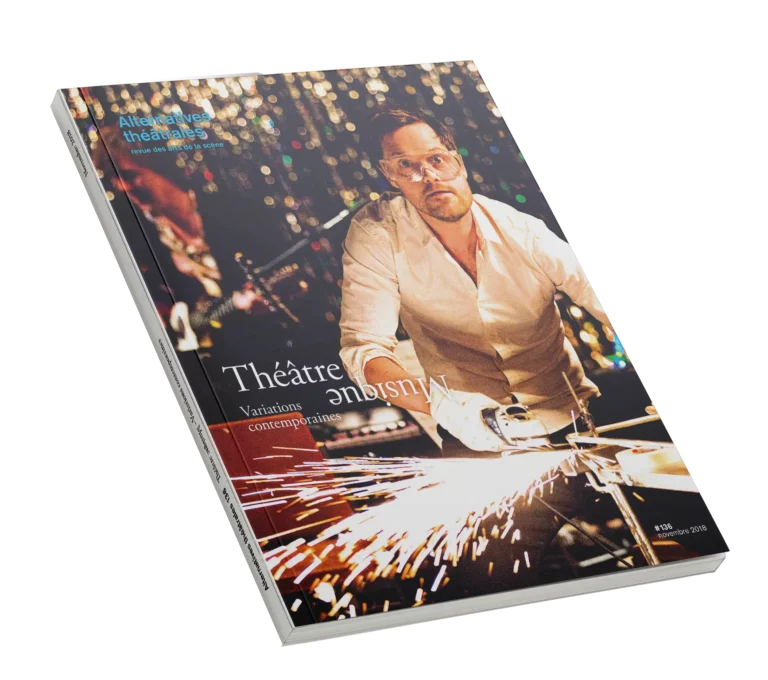Pendant la dernière année de ses études en psychologie sociale, Inne Goris a cherché une place de stage. Sur les conseils de son père (« Ce n’est pas si compliqué : tu aimes le théâtre et tu aimes travailler avec les enfants. »), elle s’est retrouvée au Bronks, théâtre pour jeune public à Bruxelles.
L’envie de monter elle-même des spectacles ne lui est venue que lorsqu’elle a commencé une formation à l’Académie de théâtre de Maastricht. Dans son travail, Inne Goris est à la recherche des vestiges d’un vaste ensemble et rend visible ce qui était caché. Le résultat est une oeuvre étrange qui transgresse les limites de l’art plastique et du théâtre. Bien que très variés, ses spectacles ont comme point commun de ne pas éviter les thèmes sombres. Et de toujours prendre le public – enfants comme adultes – au sérieux.
Qu’est-ce qui fait des enfants un groupe-cible si particulier ? Et lorsque que tu prépares un spectacle pour enfants, est-ce que tu t’y prends autrement que pour un public adulte ?
C’est un débat qui fait rage depuis des années dans le secteur. J’ai toujours plaidé pour l’abolition des frontières entre le théâtre pour la jeunesse et le théâtre pour adultes. Moi-même, je lis aussi des livres jeunesse et je vais voir des spectacles pour les jeunes. Je ne me demande pas si c’est pour les jeunes ou pour les adultes. Mes spectacles sont toujours pour « tout le monde à partir de X ans. » L’important, c’est de trouver des références communes avec le public. Si je prends Huis (Maison) comme exemple : tout le monde ne grandit pas avec un parent dépressif mais tout le monde a eu un jour affaire à un adulte qui, pour une raison ou une autre, n’était pas disponible. Tout le monde (re)connaît cela.
Je pense que, pour moi, tout dépend du sujet choisi ; je ne me dis jamais « maintenant je vais faire quelque chose pour les petits. » Droesem a vu le jour parce que certains contes de fée me travaillaient à un moment de ma vie où je voyais souvent un gamin de quatre ans jouer. La fantaisie dont il faisait preuve me fascinait. Un dinosaure apparaissait soudain dans la forêt du petit chaperon rouge, un bloc de bois se transformait en auto, puis en tour, puis en des dizaines d’autres choses encore. Pour quelqu’un qui voit cela de l’extérieur, c’est un enchaînement qui peut paraître illogique, mais pour un petit enfant, cela va de soi.
Tu as l’air d’attendre un même degré de fantaisie de ton public. Tu lui donnes toute liberté d’interprétation, à lui d’imaginer, de se poser des questions…
De nombreux adultes osent poser des questions dont ils connaissent déjà les réponses, comme s’ils avaient besoin de se conforter dans leurs opinions. Alors que la force de l’art, c’est justement de poser des questions auxquelles on peut apporter diverses réponses. Moi-même, je n’ai souvent pas les réponses aux questions que soulèvent mes propres spectacles. Il arrive que des enfants sortent d’une représentation et disent qu’ils n’ont pas compris. Si on leur renvoie la balle et qu’on leur demande ce qu’ils ont vu, ils vous racontent exactement l’histoire qu’ils ont vue sur scène. Quelque part en chemin, nous perdons notre fantaisie. Dans Droesem, on voit une boîte en carton rectangulaire se hisser lentement puis s’allumer dans les hauteurs. De nombreux enfants crient alors : « Le soleil ! La lune ! » Alors que les adultes se demandent : « Qu’est-ce que ce truc faisait là-haut ? » C’est comme si notre fantaisie se muselait quand nous grandissons. Ce n’est pas encore le cas chez les petits. C’est ce qui est beau chez eux : ils sont encore dans le magique. Et c’est cette fantaisie-là que je veux stimuler.