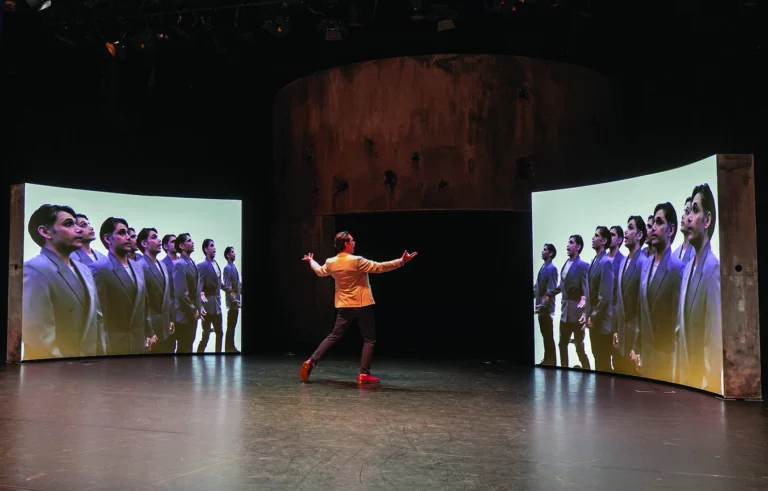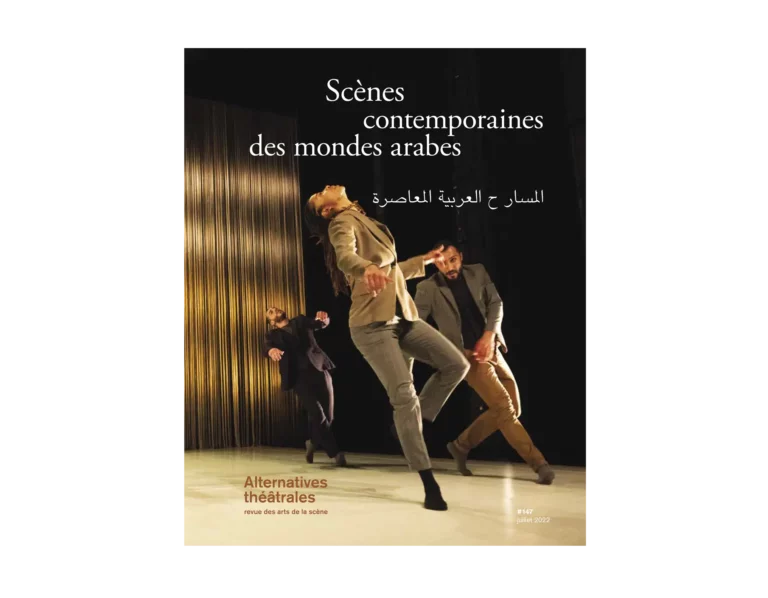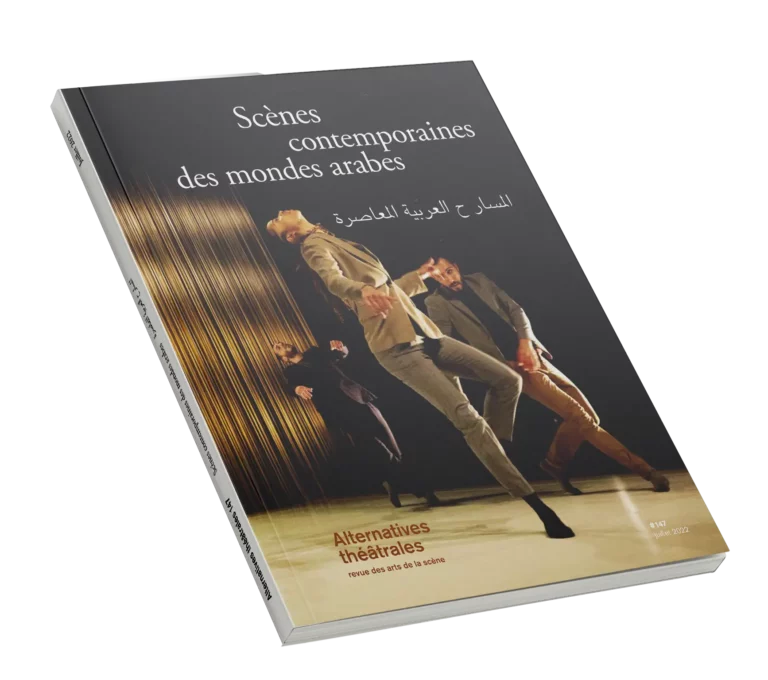La main de fer exercée par le gouvernement, le dogmatisme politique imposé par le parti unique et la censure qui empêche toute liberté d’expression… Ce sont les éléments typiques des régimes totalitaires, et ils régissaient la vie en Syrie depuis la prise de pouvoir de Hafez Al Assad en 1970, puis de son fils Bachar Al Assad en 2000. Pourtant, au sein de ce paysage sombre, l’Institut Supérieur des Arts Dramatiques de Damas (ISAD) faisait exception ! Dans le bâtiment qui abrite les départements jeu, études théâtrales, danse, techniques du spectacle et scénographie, les étudiants sélectionnés par un concours d’entrée très strict se sentaient libres, épanouis, et différents de leurs homologues à l’Université de Damas. En effet, contrairement à ce qui était adopté dans les amphithéâtres universitaires, le système d’enseignement à l’ISAD était propre à encourager la libre-pensée et le jugement critique. Le résultat est clair : depuis la création de l’ISAD en 1977, presque tous ses diplômés ont occupé avec succès des postes clés, non seulement dans les métiers du spectacle, mais aussi dans le paysage artistique et culturel de toute la région.
Les raisons de ce succès : un enseignement de qualité basé sur les meilleurs préceptes de la formation de l’acteur et de la dramaturgie ; une ouverture sur les expériences novatrices du théâtre international et sur les méthodes d’analyse fournies par les sciences humaines. De même, chaque année, un groupe d’étudiants était envoyé à Avignon afin d’assister au Festival, et les meilleurs de leur promotion étaient récompensés par une participation à des ateliers et à des résidences à l’étranger, parmi lesquels l’atelier jeu du Théâtre du Soleil à Paris, l’atelier éclairage et son à l’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avignon (ISTS) ou encore l’Atelier d’écriture au Royal Court Theatre à Londres, qui a contribué à la formation d’excellents écrivains pour le théâtre.
Les centres culturels français, allemand, et espagnol soutenaient l’Institut Supérieur des Arts Dramatiques de Damas, qu’ils jugeaient unique en son genre en Syrie. C’était aussi l’époque des projets de coopération euro-méditerranéenne qui permirent la constitution d’un réseau de collaboration et d’amitié entre les artistes des deux rives. L’échange se faisait dans les deux sens. Beaucoup d’artistes européens vinrent travailler à Damas, parmi lesquels Jacques Lassalle, Alain Knapp, Jean-Christophe Saïs, Pascal Rambert, Catherine Marnas, André Serre, Catherine Boscovic, Jean-Christophe Lanquetin, pour ne citer que les Français. Les spectacles de Peter Brook, Maguy Marin, Philippe Genty, Árpád Schilling enchantaient le public et ouvraient de nouvelles perspectives devant les artistes syriens. Quant aux artistes invités, ils admiraient le dynamisme exceptionnel de l’ISAD, devenu célèbre pour son bon fonctionnement.
Mais ce phénomène n’était pas né du vide. Le théâtre en Syrie date de la fin du xixe siècle, et les compagnies de théâtre, assez nombreuses à l’aube du xxe siècle, faisaient des tournées entre la Syrie, le Liban, l’Égypte et l’Afrique du Nord. Des acteurs et des actrices pleins de détermination parvenaient, contre vents et marées, à ancrer le spectacle dans les loisirs du pays.
Au début des années soixante, la création du ministère de la Culture et le lancement du Théâtre National donnèrent un élan nouveau. Le soutien de l’État permettait aux artistes de se consacrer au travail théâtral, et la création d’un syndicat contribua à la protection de leurs droits et à leur assurer une retraite décente.
Le modèle socialiste de la gratuité de la culture était adopté, et les accords culturels signés avec les pays de l’Est permettaient à beaucoup de jeunes d’obtenir des bourses de formation à l’étranger. À l’intérieur du pays, les experts russes, bulgares, yougoslaves et tchèques formaient les équipes de travail dont le théâtre pour enfants, le théâtre de marionnettes, et le théâtre ambulant qui se déplaçait de village en village.
Le Festival de théâtre de Damas, lancé en 1969, était devenu le lieu de rencontre des plus grands artistes (hommes et femmes) du monde arabe. Les discussions lors des tables rondes ou autour d’un verre étaient l’occasion de réfléchir à des notions nouvelles, et d’entamer des projets dans une dynamique qui touchait tous les pays arabes. MAIS, l’État qui protège et soutient se donne aussi le droit d’intervenir dans tous les détails de la production, de contrôler et d’interdire. À partir des années 1970, le climat politique se durcit de plus en plus ; la censure devient stricte et nuisible. Les intellectuels considérés comme les pionniers du changement sont dérangés et souvent détenus pour leurs opinions. Le climat de liberté est gâché, et le régime devient de plus en plus rigide et totalitaire. La bureau-cratie ne tarde pas à s’installer dans le ministère, et se met à entraver le dynamisme du passé.