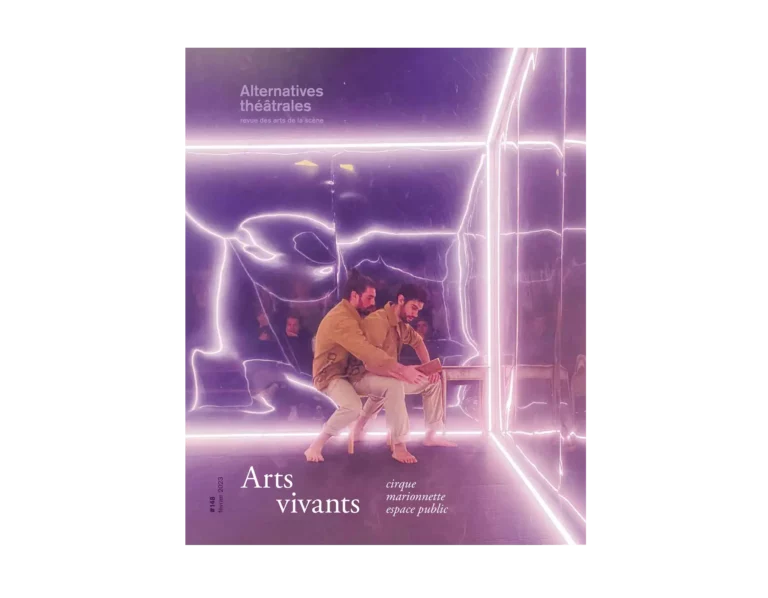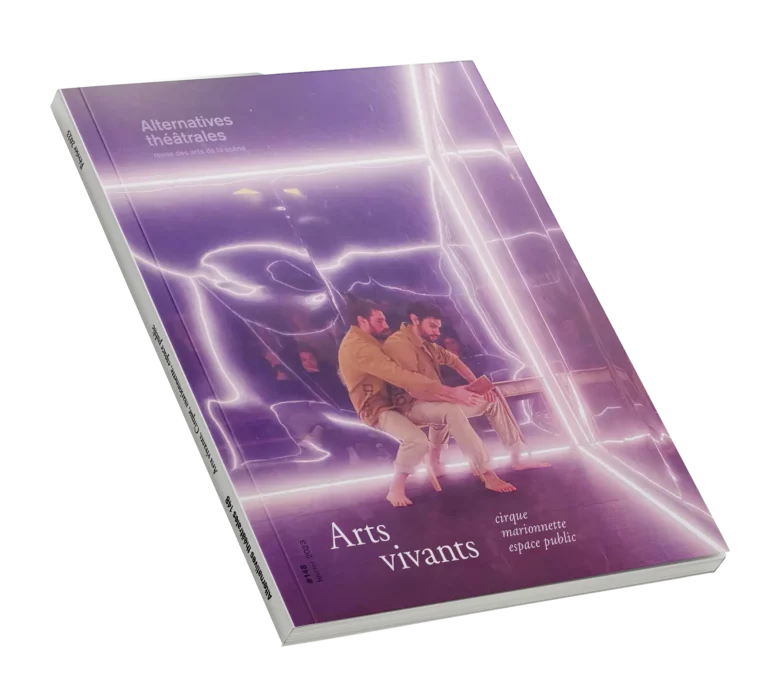Nous avons voulu publier ce numéro en guise de manifeste pour des formes d’art dites mineures, évidemment majeures selon nous. Sur le plan historique, à quand remonte ce clivage entre des formes d’art dévalorisées et d’autres qui seraient privilégiées, cette dichotomie entre des formes jugées seulement plaisantes et divertissantes, face à d’autres qui seraient importantes et essentielles ?

La dichotomie entre des formes dites mineures et d’autres qualifiées de majeures suggère d’abord à l’oreille une hiérarchie entre les classes d’âge des destinataires, les enfants étant infériorisés par rapport aux adultes. Mais c’est surtout le clivage entre l’élite et le peuple qui lui sert de matrice.
Au cours de l’Histoire, cette opposition évolue en fonction de la structuration sociale, selon qu’elle sépare une rare aristocratie d’une vaste paysannerie, qu’elle distingue une classe bourgeoise plus nombreuse, communiquant à travers toutes sortes de couches intermédiaires jusqu’aux strates les plus humbles de la population, ou qu’elle se caractérise comme de nos jours par la domination numérique – sinon politique et idéologique – des couches moyennes. Tandis que la société change de physionomie, passant d’un aspect pyramidal à un aspect ovoïde, les noms employés depuis ses sommets pour en désigner la base se modifient, tout en conservant une connotation condescendante, suivant que l’on évoque la plèbe, le vulgaire ou la populace… Le vocabulaire et les perceptions se transforment cependant à la fin du xixe siècle, sous l’effet de l’industrialisation et de l’urbanisation, dès lors qu’une partie des élites instruites craint d’être submergée par la masse, parce que les techniques de reproduction permettent de diffuser dans l’ensemble de la population des informations et des mélodies, des images et des messages jusque-là réservés à une infime minorité. La poussée de la multitude et l’assaut du multiple bousculent les critères de classement des œuvres et des genres.
Il ne faut toutefois pas confondre ceux-ci avec celles-là. L’exercice de la distinction, qui est à la source même du jugement esthétique, continuera toujours de s’effectuer dans un genre minoré aussi bien qu’au sein d’un genre majoré, parce que les deux sont visités par des amateurices plus ou moins éclairé·e·s, libres d’élire les objets qui leur semblent les plus subtils, les plus raffinés, désirables ou émouvants dans leur art de prédilection. Les mouvements internes aux catégories chamboulent leurs propres contours et finissent par affecter leur classement. Par exemple, le succès critique de certains romans policiers, qui leur confère le statut d’œuvres majeures à l’aube du genre, à la fin du xixe siècle et dans la première moitié du xxe, contribue à faire grimper celui-ci dans la hiérarchie littéraire, au point qu’un jour la « Série noire » de Gallimard (lancée en 1948) se hisse à la hauteur de la NRF (Nouvelle Revue française, dont les éditions démarrent en 1911). Dans Les Règles de l’art, Pierre Bourdieu1 montre à partir du cas de Gustave Flaubert que ces reconfigurations résultent surtout des stratégies des agents à l’intérieur d’un champ ou d’un sous-champ – en l’occurrence celui du roman – traversé par des logiques de domination. Mais dans un pays comme la France, l’État joue un rôle essentiel dans ces progressions et glissements sur l’échelle des valeurs, car il dispose d’académies ou d’instances spécialisées dans les opérations de classement, de promotion et d’exclusion. En a longtemps témoigné le face-à-face entre les théâtres que l’on disait « privilégiés », au sens strict car dotés de prérogatives et de subventions, et les théâtres de la Foire sur lesquels les artistes inventèrent néanmoins des formes singulières (pantomimes avec ou sans pancartes, jeu sur échasses, parodies et toutes sortes d’artifices) pour contourner les interdits de la Comédie-Française ou de l’Opéra. À l’époque contemporaine, l’ébranlement des catégories ne procède pas seulement des mutations du pouvoir qui adoucit la censure, assouplit ses lois et élargit l’éventail de ses critères de choix, il découle aussi de l’affirmation de nouveaux clivages : d’abord entre l’artisanat et l’art – une antinomie qui n’a cessé de se renforcer depuis la Renaissance –, ensuite entre une culture de masse jugée aliénante et une culture savante qui se voudrait émancipatrice, laquelle se voit parfois appeler « haute culture », voire – curieux pléonasme – « culture cultivée ». Cette conception binaire n’émane pas tant des organes politiques, même s’ils concourent à la fixer, que d’une partie des intellectuels qui s’alarment des empiètements des industries de programme dans les domaines du savoir et de l’imaginaire.
L’imprimerie, avec ses rotatives capables de cracher à la chaîne des magazines et des livres de poche, la photographie, la radio, le cinéma et la télévision… Bien avant le règne d’Internet, dès les années 1920 et 1930, des philosophes, des écrivains et des artistes soupçonnaient les moyens de (re)production de masse d’affadir ou d’abâtardir la culture éthérée, d’une part, et d’encourager des formes qui flattent directement les affects de la foule, d’autre part, au risque d’échauffer ses passions – y compris au profit de régimes autoritaires.
La situation est plus confuse de nos jours, car la détermination des hiérarchies de valeurs s’effectue sous les feux croisés de trois puissances.
Des autorités nationales et territoriales, professant un éclectisme de bon aloi dans l’espoir de concilier des demandes sociales concurrentes, se montrent plus accueillantes à des modes d’expression jusqu’alors marginalisés, de même qu’à de nouvelles formes encore balbutiantes.
Des académies vieillissantes, visibles ou « invisibles », pour reprendre une expression de Philippe Urfalino2, voient décliner les moyens de prescription dont elles disposaient autrefois, tout en gardant une position prépondérante dans la course aux ressources publiques. Enfin, les majors des réseaux numériques, plates-formes d’agrégation de contenus aux algorithmes souverains, ne sélectionnent pas les œuvres en fonction de leur degré de dignité supposé, mais tout bonnement au regard de l’intérêt que telle ou telle famille d’internautes manifeste à leur endroit. Leur influence l’emporte sur les autres. La révolution numérique bouleverse l’indexation des valeurs, la taxinomie des genres et la classification des œuvres.
En France, on peut considérer que Jack Lang (avec le concours de Robert Abirached à la Direction du théâtre et des spectacles) a démodé ce clivage ancestral, dans les années 1980, en intronisant plusieurs formes d’art populaire qui connaissaient un renouveau. En termes de politique culturelle, peux-tu nous parler de ce moment de bascule qui fait suite à Mai 68 ?