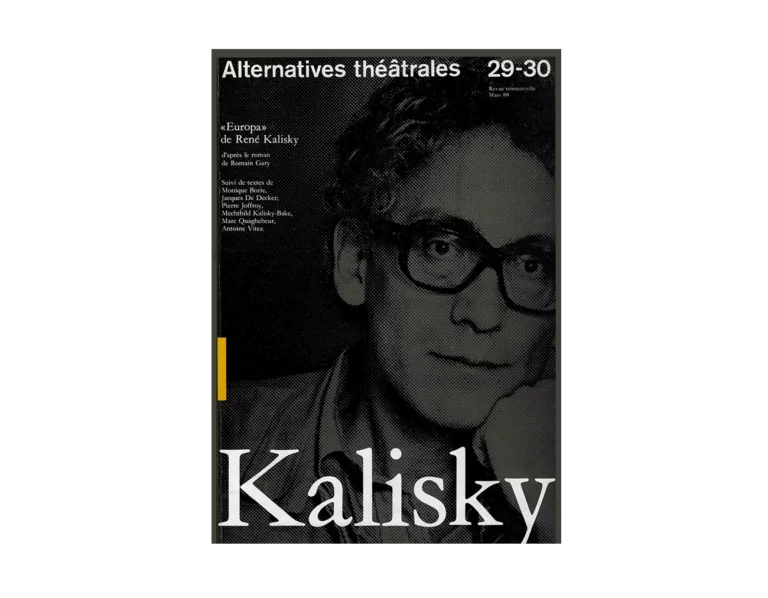Le 7 et le 8 juin 1974, nous étions Mechthild et moi, à Bruxelles, pour rencontrer les acteurs qui joueraient LE PIQUE-NIQUE DE CLARETTA. L’audition avait lieu au Théâtre de Poche, à l’orée du Bois de la Cambre. Il pleuvait.
Ce fut très important, la pluie, ce jour-là.

J’essayais — littéralement — le texte de Kalisky avec des acteurs qui ne connaissaient naturellement rien de la pièce, de l’auteur, du sujet.
Ainsi je pratiquais, de façon tout à fait consciente et volontaire, la politique de la page blanche que demande Stanislavski pour la méthode des actions physiques simples : c’est l’acte lui0même et la chaîne des actes qui informent l’acteur sur l’ceuvre et le propos de l’ceuvre qu’il doit jouer.
Mais ainsi je me laissais envahir moi-même par les conditions hasardeuses où je me _trouvais : cette journée-là, précisément, et la pluie. Soudain la pièce de Kalisky apparaissait comme une représentation physique de la fin du monde : le Déluge ou l’Apocalypse. Ce qu’elle est en effet, mais j’en trouvais, à portée de main l’illustration dans les éléments autour de moi, l’inconfort, l’angoisse des acteurs qui ne pourraient tous être engagés, la mienne, la nôtre, le mauvais temps, le bruit de l’eau sur le toit, le Bois de la Cambre sombre, vestige d’un grand bois profond, obscur, dans un temps ancien de la Belgique.
Il suffisait alors de faire exécuter aux acteurs, fugitivement, et même mal, ou imparfaitement, les rêves surgis de cette rencontre entre le texte et la vie ( toujours Goethe : Dichtung und Wahrheit ! ), pour que le fond même de la pensée de Kalisky apparût. En tous cas je croyais qu’il apparaissait ainsi, il me semblait, oui, que je pénétrais à l’intérieur de sa tête. Et ce jour-là, sans qu’il fût présent, je l’ai connu. Mechthild a noté les exercices que nous avons faits, puis nous sommes rentrés ensemble, comme en possession d’un secret sur l’ami.
De ces notes, que je relis, nous pourrions sans doute faire ceuvre : reprendre ainsi CLARETTA, comme un conte fantastique. J’imagine la mousse envahissant peu à peu le salon, les touffes d’herbes entre les tapis, la pluie tombant du plafond, cependant que la cérémonie expiatoire du Piazzale Loreto se déroule. Au bout de la vie, à peine en deçà de la mort, les jeunes femmes transformées en vieillardes décrépites poursuivent leurs jeux amoureux, leurs manigances, et leurs hommes désormais impotents, eux aussi, les attirent dans leurs bras.
Scène I
Texte dit comme prologue, poème (citation), pendant lequel Antonella mène Massari et Claretta à l’endroit qu’elle aura choisi comme gibet (table, divan, etc.), les y installe, les couche, les pend, les déshabille en parlant avec lenteur (fait un tas avec les vêtements). Massari et Claretta s’asseyent, se recouchent, s’étirent, bougent, puis ne bougeront plus, feront les morts …
Ou bien Claretta se penche sur Massari, le regarde attentivement, le caresse, se recouche, Antonella dit certaines phrases à l’oreille de Claretta, chuchote. Ou bien répétition de la citation, Massari quitte son gibet, quitte la scène, Claretta se lève, s’accroupit par terre face au public, concentrée, mais rit au moment de dire « que César n’avait rien perdu de sa puissance virile ».
Scène III
Fausta, Multedo (Ciano).
Ciano assis, face au public, impassible, les yeux fixes, décrivant son état ( n’incarnant pas la souffrance) physique. Fausta, comme une ogresse ou une tigresse, tourne autour de lui. Ou bien Fausta, en négligé somptueux, fume-cigarette à la main, évolue autour de Ciano, le brûle enfin longuement avec la cigarette, et Ciano ne réagit pas, mais se retourne subitement avec la chaise (dos au public). Fausta s’assied sur ses genoux ( sa maîtresse), l’enlace, et dit « moitié nègre moitié arabe », sur quoi Ciano la gifle, elle tombe par terre, se relève, crie : « Avoue Ciano… », etc.
Scène IV
Fri-Fri et Antonella assises l’une loin de l’autre, parlant avec lenteur extrême — fatigue, lassitude. Pour la dernière phrase, Fausta (gui se tenait entre elles) prend une attitude « publique », pose, chante quelques notes d’une marche militaire, fait le salut fasciste et hurle « Voué au Duce ce corps …»
Scène VII
Massari, vieillard impotent, essaye de se soulever d’un fauteuil aux premiers mots de la vieille Fausta « Tu sais ce que disait le général Cadorna à Caporetto… lion … mouton », etc. Fausta vient à l’aide du vieillard qui essaye désespérément d’avancer, titube ensuite, paralytique, dans les bras de la vieille, pour faire le « pas de l’oie », lève le bras raide, pantalon ouvert, salut fasciste, répète « mouton … lion », tombe, sénile, pisse, salue assis par terre baignant dans l’urine. Ou bien Massari, d’abord jeune, fait des mouvements d’assouplissement microscopiques avec ses doigts et ses orteils, répétant : « Il vaut mieux vivre un jour comme un lion », etc. Se transforme en vieillard, et Fausta l’aidant à marcher, chuchote à son oreille : « L’Europe doit aujourd’hui choisir … ». Massari répète.
Scène VIII
Massari, Ciano, Fausta.
Le début joué dans le style boulevard le plus outrancier. « Salut, Ciano ! Debout mon gendre ! ». Fausta, les observant de loin, rit aux éclats. Tout à coup Ciano s’assied, ne joue plus le jeu, retourne même sa chaise. Massari : « Elle, une putain ! Mais c’est un ange ! ». Ciano monte sur la chaise, leur parle de haut.
Scène IX
Fri-Fri et Antonella assises (vieillardes); deux vieilles amies (elles tricotent) qui causent calmement ; une ou deux autres centenaires traversent l’espace à pas minuscules et incertains pour faire une petite chose absurde, n’importe quoi, pendant que le dialogue se poursuit. Antonella dit : « Mon Dieu, mais tu es si belle ». Les deux autres s’immobilisent, regardent Claretta, s’approchent, et pendant que Claretta parle de sa fausse-couche, les trois femmes la déshabillent, l’installent comme ( une morte) une impotente, lui épongeant le front, etc. Tout à coup Claretta se dégage, souple et jeune, se couche par terre à son aise en disant : « Masse-moi la nuque ». Puis Antonella et Claretta s’amusent, se parlent tendrement, très rapprochées, et Claretta montre à Antonella comment la masser.
Scène XI
Massari, assis de profil à table, profondément plongé dans ses papiers, ne lève pas les yeux lorsque Spogler entre en claquant les talons et fait le salut fasciste.
Pendant une dizaine de répliques Massari parle sans jamais lever les yeux, Spogler tout à coup en a assez, s’assied nonchalamment sur une chaise, répond ainsi à Massari qui commence à arpenter l’espace à grands pas violents. Fausta-démiurge (ou Claretta-idole féminine) souriante au milieu de. la scène. Massari et Stephen tournent autour d’elle comme deux chiens. Elle les tient à distance avec les bras écartés, ils courent hurlant, diamétralement opposés, changeant aussi le sens de leur course, elle veille à maintenir leur écart constant, jusqu’à ce que Stephen la pousse violemment sur le côté pour affronter Massari de tout près. Elle les observe alors de loin, se moquant, et puis brise subitement leur jeu en tirant avec un pistolet à eau.