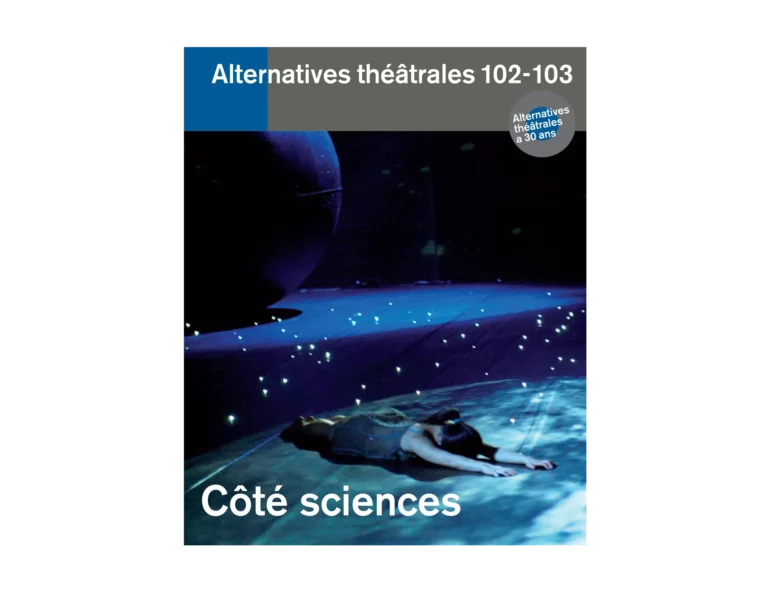IL EST RARE qu’une pièce connue parle d’un scientifique célèbre. LA VIE DE GALILÉE, écrite par Bertolt Brecht en 1949, fait partie de ces raretés. À cette occasion, j’eus la chance de pouvoir interroger Galilée qui venait juste d’assister à une représentation. Je commençai par lui demander s’il avait aimé la pièce.
Ce n’est pas vraiment la bonne question à poser. Comme vous pouvez vous en douter, je ne l’ai pas appréciée. J’étais plutôt flatté que quelqu’un écrive une pièce à mon sujet et curieux de voir comment j’y étais représenté. Est-ce que j’ai vraiment d’aussi mauvaises manières à table ? Non la vraie question à poser est de savoir si la pièce est un reflet exact des événements, ou si l’auteur s’est contenté d’utiliser ma vie pour faire valoir ses propres idées. Lorsque dans une pièce, on utilise des personnages ayant existé, on doit avoir l’obligation, me semble-t-il, de les dépeindre le plus exactement possible. Je trouve le titre, LA VIE DE GALILÉE particulièrement gênant. Quelle simplification ! Quelle distorsion ! Comme si ma vie toute entière n’était rien d’autre qu’un combat contre l’Église, et…
« Nous reviendrons sur ce point plus tard. Pour le moment, pouvez-vous nous dire comment vous avez commencé à vous intéresser à la science ? »
Mon père voulait que j’étudie la médecine et je suis entré à l’Université de Pise. Mais alors que j’assistais à des cours sur la géométrie euclidienne, je me suis pris de passion pour les mathématiques. Or mon père insistait pour que je termine mes études de médecine même si mon intérêt était ailleurs. Au final, j’ai abandonné la médecine et j’ai quitté l’université sans diplôme.
« Mais pour quelles raisons vouliez-vous utiliser les mathématiques pour résoudre des problèmes de physique ? »
Il est toujours difficile de refaire le chemin suivi par l’esprit humain. J’étais sans aucun doute influencé par mon père, musicien, qui avait un penchant pour les mathématiques. Il avait étudié les longueurs et les tensions des séquences musicales et découvert une loi mathématique. J’étais également très influencé parla lecture d’Archimède et plus particulièrement par ses travaux sur les corps flottants et les leviers qui avaient été largement négligés. Je m’intéressais de plus en plus à la science.
Mais revenons à la pièce. Brecht semble ne rien entendre à la science. Dans la première scène, il me montre parlant d’un âge nouveau dans lequel tout le monde remettrait en cause les certitudes anciennes. Quelle absurdité ! Puis, il y a cette réplique où quelqu’un dit « nous n’aurions pas dû essayer ce qui est dans les livres, mais plutôt chercher par nous-même ». Là encore, quelle absurdité ! Une simple observation ne servira qu’à nous convaincre que la terre est immobile et que chaque jour le soleil tourne autour d’elle. Non, la science a besoin avant tout de bonnes connaissances mathématiques et d’un mode de pensée particulier. Pour aborder un problème scientifiquement, il faut faire abstraction des concepts de poids et de vitesse, qui sont infiniment variables. Jamais je n’aurais prophétisé — comme il me l’a fait dire — que l’astronomie, une science mathématique, serait un jour débattue sur la place publique. Tout ce que Brecht voulait, c’était voir notre science nouvelle renverser l’ordre politique établi. L’homme du commun ne contribuera jamais à la science. Car celle-ci va malheureusement à l’encontre du sens commun. Même Aristote l’avais compris, lorsqu’il disait que la compréhension des choses bouleverse complètement notre mode de pensée initial.
« Est-ce que l’Église a protesté contre votre théorie du mouvement ou d’autres aspects de votre science ? »
Non. À cette époque, mes vrais ennemis étaient les philosophes — ce n’est pourtant jamais mentionné dans la pièce. S’il pouvait voir ce que les philosophes ont fait de sa pensée, le grand Aristote serait furieux. L’avez-vous déjà interrogé ? J’aimerais bien savoir ce qu’il en pense. Je ne crois pas qu’il ait jamais souhaité que ses idées soient ainsi transformées en un dogme irrationnel et irréfutable.
« Pourquoi les philosophes étaient-ils vos ennemis ? »
Mon travail sapait les fondements même de leurs principes. Si j’avais raison — et c’était le cas — alors il deviendrait évident que leurs idées n’étaient qu’un dogme creux et vide. Cela les aurait exposés au mépris et à la dérision de tous. Leur but n’était pas d’améliorer la compréhension du monde, mais de préserver intact le dogme aristotélicien. Ils ne s’intéressaient pas aux mécanismes mais aux causes, qui pour eux correspondaient au but ultime derrière chaque phénomène naturel. Reprenant la pensée d’Aristote, ils pensaient que chaque objet avait une place naturelle, ce qui expliquait par exemple pourquoi les pierres tombent alors que la fumée s’élève. Ils ne s’intéressaient pas aux mesures, ni à ce que j’appelle des lois, qui permettent de décrire le mouvement des objets de façon quantitative. Ils avaient également une théorie difficilement acceptable selon laquelle le ciel serait différent de la terre et les corps célestes seraient parfaitement ronds et se déplaceraient en des cercles absolus. Savoir si cela était vrai ou pas ne semblait pas les intéresser le moins du monde. Pas plus qu’ils ne se souciaient de vérifier les théories qu’ils enseignaient, par exemple cette hypothèse selon laquelle les corps lourds tomberaient plus vite que les corps légers.
« Avez-vous réellement fait tomber des poids depuis le haut de la Tour de Pise ? »
Oui. Mais je connaissais déjà le résultat. On a la preuve qu’au VIe siècle, Jean Philopon avait déjà fait cette expérience avec des poids, et démontré qu’Aristote avait tort. Mais même sans en faire l’expérience, on peut prouver à l’aide d’une démonstration courte et probante qu’un corps plus lourd ne tombe pas plus rapidement qu’un corps plus léger à condition que les deux soient composés du même matériau et respectent les prérequis fixés par Aristote. Admettez-vous que chaque corps en train de tomber acquiert une vitesse définie, stable par nature et qui ne peut ni augmenter ni diminuer sauf s’il subit une force ou une résistance ?
« Oui, cela me semble raisonnable. »
Donc, si on prend deux corps dont les vitesses naturelles sont différentes et si on les réunit, le plus rapide sera partiellement retardé par le plus lent et le plus lent sera légèrement accéléré par le plus rapide. Cela vous semble-t-il correct ? Bien, si ceci est le temps, et si une grosse pierre se déplace à une vitesse de, disons huit, alors que la petite se déplace à une vitesse de quatre, l’ensemble doit se déplacer à une vitesse inférieure à huit. Or les deux pierres réunies forment une pierre plus grosse que celle qui, seule, se déplaçait à une vitesse de huit. On peut donc en conclure que le corps plus lourd se déplace plus lentement que le corps plus léger, ce qui est contraire à l’hypothèse d’Aristote. Aristote s’était trompé.
« Voilà une belle démonstration. D’après vous, pourquoi a‑t-il fallu si longtemps pour reconnaître que la théorie d’Aristote était fausse ? »
Les philosophes. C’est la faute des philosophes. Ils n’avaient que faire d’essayer de décrire la nature, ou plus exactement, de découvrir les lois du mouvement. Comme je l’ai déjà dit, ils ne s’intéressaient qu’au maintien de leur propre autorité. Mais ce n’est pas tout. Si vous faites l’expérience avec une balle de cent livres et une autre d’une livre, vous constaterez que si on les lance d’une certaine hauteur, la plus lourde arrivera de deux doigts plus tôt que la plus légère. D’après Aristote, l’écart entre le temps d’arrivée des deux balles aurait dû être beaucoup plus grand. Certes, me direz-vous, la différence de deux doigts, bien qu’infime, mérite quand même une explication, que je n’ai pas encore donnée. Mais cela n’est pas suffisant pour sauver Aristote. Nous vivons tous dans l’incertitude. Vous vous souvenez certainement que Copernic peinait à expliquer les différentes phases de Vénus, pourtant il n’a jamais abandonné. Avec la raison pour guide, il a continué à affirmer résolument un principe que l’expérience semblait contredire, et je l’admire beaucoup pour cela.
« Vous avez dit, je cite “Il n’existe pas un seul phénomène naturel, si infime soit-il, que les théoriciens les plus ingénieux puissent comprendre dans sa totalité.”»
C’est exact et il m’est très facile de défendre ce point de vue. Vous aurez beau réduire l’explication d’un phénomène à ses principes de base, il restera toujours un résidu inexpliqué et certainement inexplicable. Admettons par exemple que vous connaissiez les lois du mouvement. C’est possible après tout, nous avons fait de grands progrès même si de nombreux problèmes persistent. À l’issue de vos travaux, vous avez une formule mathématique. Or, comment expliquez-vous ou comprenez-vous cette formule ou la loi sur laquelle elle est basée ? Sa compréhension totale est impossible, car même si vous comprenez cette nouvelle formule, comment comprenez-vous cette nouvelle compréhension ? Totale, juste, vraie, la compréhension est réservée à l’intelligence divine. On aura beau s’en approcher, jamais on ne l’atteindra. Les mathématiques permettront juste de la côtoyer au plus près, peut-être de l’effleurer.