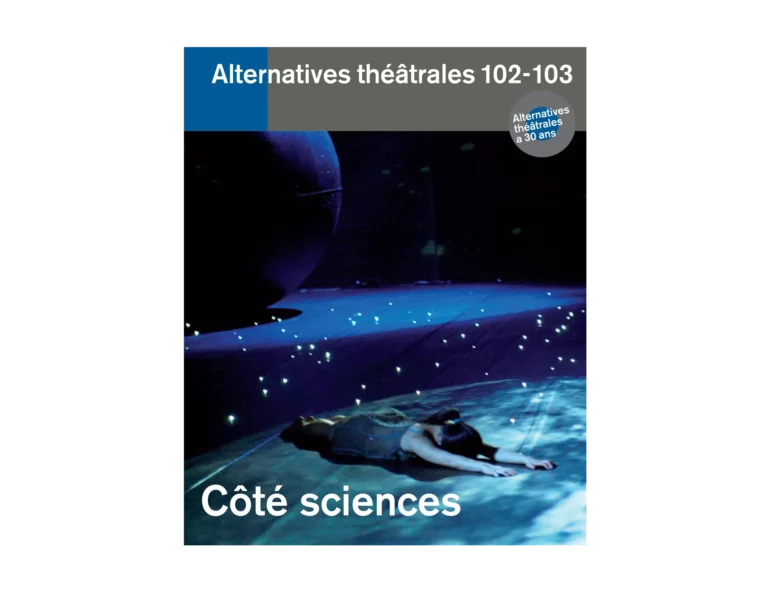Nous proposons ici quelques pistes qui permettront au lecteur de découvrir d’autres réflexions sur l’interaction du théâtre et des sciences, et de remonter plus loin dans le temps. Ce cheminement bibliographique pourrait commencer par les écrits de dramaturges et de metteurs en scène qui ont réfléchi à la question, et tout d’abord la collection d’articles publiées sous le titre LE NATURALISME AU THÉÂTRE, dans laquelle Émile Zola annonce que « l’esprit scientifique du siècle, la méthode analytique, l’observation exacte des faits, le retour à la nature par l’étude expérimentale, vont bientôt balayer toutes nos conventions dramatiques et mettre la vie sur les planches » (Paris : Charpentier, 1881, 283). Le désir d’une approche analytique est aussi ce qui amènera Bertolt Brecht à proposer dans L’ACHAT DU CUIVRE (éd. J.-M. Valentin, trad. M. Cadot et al, Paris : L’Arche, 1999) l’idée d’un théâtre « planétarium », et à faire de Galilée son modèle dans le PETIT ORGANON POUR LE THÉÂTRE Dénonçant l’échec du « prétendu » naturalisme, Brecht réclame alors à grands cris « la belle logique de la table de multiplication » (PETIT ORGANON POUR LE THÉÂTRE, trad. Jean Tailleur, Paris : L’Arche, 1978, 8). Sur un tout autre mode, plus proche de la rêverie que de la démonstration, Jean-François Peyret répond à ces propositions dans les dialogues publiés dans FAUST : UNE HISTOIRE NATURELLE (J.-F. Peyret et J.-D. Vincent, Paris : Odile Jacob, 2000) et LES VARIATIONS DARWIN (J.-F. Peyret et A. Prochiantz, Paris : Odile Jacob, 2005).
La figure du scientifique a fait l’objet de plusieurs études transversales récentes. Roslynn D. Haynes navigue entre la littérature, le théâtre et le cinéma pour saisir ses différentes facettes dans FROM FAUST TO STRANGELOVE : REPRESENTATIONS OF THE SCIENTISTIN WESTERN LITTERATURE (Baltimore : John Hopkins UP, 1994). Allen E. Hye s’intéresse au motif du dilemme éthique du chercheur dans le théâtre occidental dans THE MORAL DILEMMA OF THE SCIENTIST IN MODERN DRAMA (New York : The Edwin Mellen Press, 1996), ouvrage qu’on s’amusera de mettre en regard avec celui de Christopher Frayling sur la représentation des scientifiques au cinéma, MAD, BAD AND DANGEROUS ? THE SCIENTIST AND THE CINEMA (Londres : Reaction, 2005).
Une approche générique de la présence des sciences au théâtre a été proposée par Kirsten Shepherd-Barr, qui analyse l’évolution de la « science play », ou pièce au contenu scientifique, au cours des quatre derniers siècles du théâtre occidental dans Science on stage : FROM DOCTOR FAUSTUS TO COPENHAGEN (Princeton UP, 2006). L’angle générique est également choisi par Michel Valmer, qui explore les caractéristiques de ce qu’il nomme le « théâtre de sciences » à partir d’exemples européens, et notamment français, dans LE THÉÂTRE DES SCIENCES (Paris : CNRS éditions, 2005). Si ces deux ouvrages tentent de saisir un phénomène de façon diachronique, on trouve une périodisation plus précise dans une série d’études publiées au cours des vingt dernières années. Les transferts entre la science et le théâtre au XIXe siècle ont été présentés par Daniel Raichvarg (SCIENCE ET SPECTACLE, fiGURES D’UNE RENCONTRE, Nice : Z’éditions, 1993), ainsi que par Jane Goodall, qui s’intéresse aux répercussions de la théorie de l’évolution sur les planches du théâtre populaire (PERFORMANCE AND EVOLUTION IN THE AGE OF DARWIN : OUT OF THE NATURAL ORDER, Londres : Routledge, 2002). Ce type d’approche thématique, qui choisit de se concentrer sur l’influence d’une discipline ou d’une théorie spécifique, caractérise aussi les travaux de Nathalie Crohn Schmitt sur les effets de résonance entre le théâtre et la physique du XXe siècle dans ACTORS AND ONLOOKERS : THEATER AND TWENTHIETH CENTURY SCIENTIfiCS VIEWS OF NATURE (Evanston : Northwestern UP, 1990), ou bien ceux de William Demastes sur les parallèles entre le théâtre post-absurdiste et la théorie du chaos (THEATER OF CHAOS : BEYOND ABSURDISM INTO ORDERLY DISCORDER, Cambridge UP, 1998). À la frontière entre science et technologie, c’est aussi l’angle choisi par Charles A. Carpenter, qui retrace les effets de la menace nucléaire sur le théâtre américain et britannique de l’après-guerre (DRAMATISTS ANDTHE BOMB : AMERICAN AND BRITSH PLAYWRIGHTS CONFRONT THE NUCLEAR AGE, 1945 – 1964, Londres : Greenwood, 1999).
On trouvera également des approches variées du couple « théâtre et sciences » dans l’ouvrage de Jacques Baillon, THÉÂTRE ET SCIENCES, LE DOUBLE FONDATEUR (Paris : L’Harmattan, 2000) et dans plusieurs collections d’articles consacrés à la question : un numéro spécial de la revue Interdisciplinary science reviews (« Science and Theatre », éd. Howard Cattermole, ISR 27.3, septembre 2002), ainsi qu’une série d’actes de colloque de l’université de Besançon, intitulés QUEL RÉPERTOIRE THÉÂTRAL TRAITANT DE LA SCIENCE ? (éd. Lucile Garbagnati, Paris : L’Harmattan, 2000), TEMPS SCIENTIfiQUE, TEMPS THÉÂTRAL (éd. Lucile Garbagnati, Besançon : Centre régional de documentation pédagogique de Franche-Comté, 2001), et THÉÂTRE ET SCIENCES (éd. Lucile Garbagnati, Florent Montaclair et Dany Vingler, Besançon : Unesco, 1998). Enfin, le lecteur pourra se référer à deux bibliographies de pièces de théâtre traitant de sujets scientifiques : celle de Christelle Jobez (« Bibliographie “Théâtre et Sciences”», in Lucile Garbagnati, éd., QUEL REPERTOIRE THÉÂTRAL TRAITANT DE LA SCIENCE?, 243 – 268), et celle de Kirsten Shepherd-Barr et Harry Lustig (« Four Centuries of Science Plays : An Annotated List » in Kirsten Shepherd-Barr, SCIENCE ON STAGE, 219 – 230).