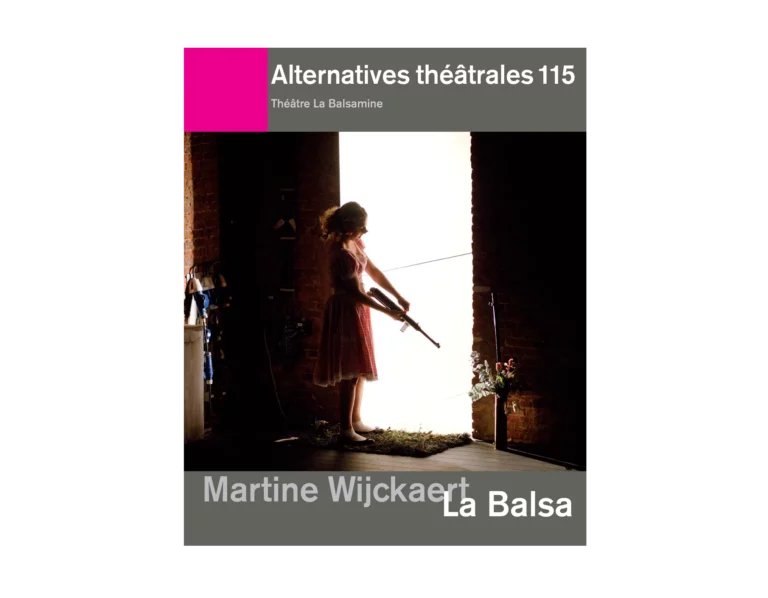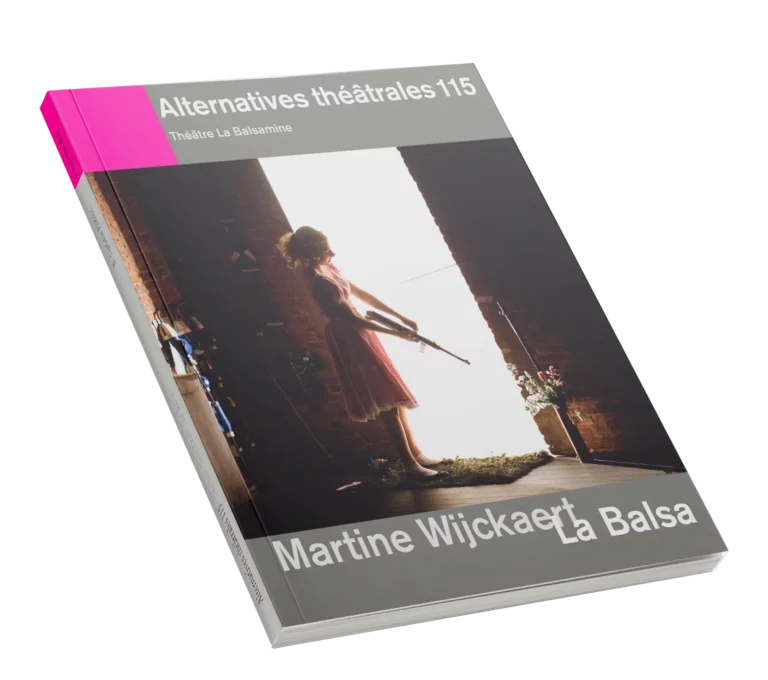À TRAVERS plusieurs questions croisées, ces comédiens qui ont marqué d’autant de balises le parcours de metteure en scène de Martine Wijckaert nous livrent leur regard sur sa personnalité, ses méthodes de travail ou encore la nature même de son théâtre. Avec respect, tendresse, et humour.
Benoit Hennaut : Quelle est la place, ou plutôt l’impact, le cratère, que la météorite Wijckaert a pu laisser dans votre parcours de comédien ? Quels sont les éléments toujours importants aujourd’hui dans votre travail d’acteur qui sont dus au fait d’avoir été à ses côtés, d’avoir travaillé à son contact ?
Alexandre von Sivers : C’est qu’on peut créer quelque chose à partir de rien, d’une pure volonté de faire, sans avoir de subsides, sans être issu d’une famille théâtrale ni en avoir les moyens ou le soutien. On a envie d’exprimer quelque chose et on se donne les moyens de l’exprimer. Alors qu’elle avait déjà monté FASTES D’ENFER de Ghelderode à la Chapelle de Neder-Over-Heembeek, YANULKA dans le parking du métro Rogier, HOP SIGNOR ! aussi de Ghelderode dans un ancien studio de cinéma désaffecté, LÉOPOLD II dans l’ancienne caserne Albert à la rue des Petits Carmes, ou bien sûr LA PILULE VERTE dans un bâtiment désaffecté de la caserne Dailly, tout à coup le directeur du Théâtre National, Jacques Huisman, la convoque en lui disant : « Martine, je vous donne mon théâtre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ! Mais je comprends que vous ne voulez pas jouer dans des lieux conventionnels, donc je vous offre mon atelier de menuiserie ». Martine n’a évidemment pas accepté et a continué son bonhomme de chemin…
Jean-Jacques Moreau : Ce qu’elle m’a surtout apporté, c’est cette folie qu’elle ne contrôle pas, et qu’elle diffuse au petit bonheur, avec des mots qui étaient pour moi d’une belgitude que j’ai immédiatement aimée. Cela dégénérait dans un sens complètement fou, avec des mots qui la dépassaient, comme par exemple : « j’ai les ovaires dans le chignon ». Il faut quand même oser ! Et puis de s’intéresser à une petite chose qui n’existe pas. D’un seul coup, il y a une petite chose qui l’attire alors que ça fait quatre ou cinq heures qu’on répète et qu’on est passé par mille détails. Pour elle, à un moment précis, c’est le petit clou sur un petit feu. Elle s’exclame : « Ah, ce petit clou qui est là ! », et on se demande ce qui se passe. Mais finalement, ça reste dans le crâne et ça nous oblige à jouer autrement, ça nous oblige à être un peu fou. Il y a des petits moments comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Elle vous donne une impulsion de vie autre que le théâtre.
Yvettte Poirier : C’est assez difficile à exprimer puisqu’on est quelque part dans l’irrationnel avec Martine Wijckaert. Il y a quelque chose de l’ordre de l’indicible, qui m’a ouvert les portes de l’imaginaire. Une impression que tout est possible, que l’on peut tout faire, tant dans des choses très réelles, très concrètes, que dans l’onirisme et l’irrationnel. Je pense aussi que cela m’a permis d’être engagée avant tout par le corps dans le travail. Même quand il y a un texte. Je l’ai appris avec Martine dans EST-CE QUE TU DORS?, ou LA THÉORIE DU MOUCHOIR, dans lesquels il y avait peu ou quasi pas de texte. L’apprentissage du plateau s’effectue par le corps, le corps est extrêmement engagé et produit du sens avant même que le texte intervienne. C’est quelque chose qui me définit encore maintenant.
Dominique Grosjean : Martine a un œil magnifique qui lui permet d’aller véritablement chercher des intentions chez l’acteur. On faisait une italienne de MADEMOISELLE JULIE avec Estelle Marion et Marc Schreiber ; une italienne un peu interprétée, où on était dans des sensations. Dans ces moments-là, Martine nous disait : « voilà, là tu es juste ! ». C’était magnifique, car après, on allait sur le plateau pour retravailler et on possédait quelque chose de très précieux au niveau des intentions qui s’était précisément déclenché à cet endroit-là.
Olindo Bolzan : Ce qui m’a frappé, c’est surtout le temps qu’elle prenait avec moi. Dans NATURE MORTE, j’étais tout seul, et le spectacle était entièrement muet, comme une longue didascalie. À un moment donné, mon personnage fumait une cigarette. C’est peut-être banal pour d’autres, mais moi j’étais devant quelqu’un qui accepte que je fume une cigarette du début à la fin. C’est long ! Neuf metteurs en scène sur dix s’ennuient après que tu as tiré un premier coup. Ce rapport d’attention et de bienveillance m’a fait beaucoup de bien à l’époque. C’est comme se dire : « tiens, je peux exister juste en étant là ». Toutes ces actions ont été recomprimées dans le temps théâtral de la représentation évidemment. Mais dans le temps de la répétition, tout était permis. Pour moi, c’était assez nouveau ce rapport au silence et au temps. Simplement être là et respirer. Même de dos.
Véronique Dumont : Quand on s’est rencontrées, mon plus grand souvenir est d’être dans son bureau, de découvrir le texte qu’elle avait écrit, et de n’y comprendre absolument rien ! Elle me dit : « qu’est-ce que tu en penses ? », et je réponds : « c’est comme si tu demandais à un aveugle qui ne peut même pas employer ses mains à quoi ressemble la pièce dans laquelle il est ! ». Elle est dans un univers tellement fou, tellement baroque, qu’il y a des recoins en tous sens, les phrases n’en finissent pas et on ne sait pas de quoi elle parle exactement. Mais elle me fait confiance dès le départ, me donne ce texte et me dit : « prends-le ». Chaque fois qu’on a travaillé, j’ai fini par comprendre la chose et par devenir, comme elle m’appelait, son ambassadeur. C’est un sacré personnage, et c’est important de rencontrer de sacrés personnages !
Héloïse Jadoul : C’est assez étrange pour moi, car cela a été très fortement lié à mon évolution, et à mon adolescence. Je n’ai pas du tout perçu la portée de certaines choses au départ. Je me rappelle qu’elle adorait mon arrogance, parce que je lui avais demandé de garder ma peluche pendant le spectacle CE QUI EST EN TRAIN DE SE DIRE, alors que j’avais dix ans. Quand je suis allée voir la deuxième pièce de la trilogie, le seul en scène de Véronique [Dumont], j’étais complètement emballée et je suis allée la voir en lui disant : « la prochaine, je suis dedans ! ». Ce qui me marque maintenant dans le travail, c’est l’exigence, et ce qu’elle appelle la virtuosité. C’est un point d’honneur que je me suis donné de toujours aller chercher tous les mots, de voir ce qu’ils peuvent amener dans leur musique. Il y a dans ses phrases une grande musicalité. Même si on s’est heurtés à « fondamentalement, talement, talement, talement » et à mille adverbes qu’on n’arrivait pas à dire !
B. H.: Si Martine est une personne fulgurante, comment peut-on définir sa personnalité de metteure en scène ? Quelle est la patte Wijckaert en matière de direction d’acteur ?
Yv. P.: Je me souviens de ses séances de notes le lendemain des représentations où les remarques étaient d’une grande précision, très à l’écoute du jeu et de ce qui s’était passé en représentation. En même temps, elle nous embarque dans un univers irrationnel qui est le sien et auquel l’acteur doit adhérer. C’est une bascule incessante entre des choses très concrètes, très réelles, et des choses plus impalpables. Je pense qu’elle est extrêmement exigeante, parce que son théâtre est à la fois très personnel et possède en même temps une dimension universelle à travers la métaphore ou l’ordre symbolique.
D. Gr.: Martine t’inscrit dans un univers plastique. Dans LA GUENON CAPTIVE, je jouais sur un plateau qui était rempli de verres à travers lesquels il fallait slalomer. Une petite plante était là aussi ; Martine y tenait absolument car elle apportait une touche de vert et de vie dans ce décor qui était déjà une sorte de nature morte de verres. Je les remplissais tous les soirs avec une seringue à chevaux, et je mettais un petit peu de vin pour que ça sente la vinasse dès que le public entrait dans le théâtre. Ces détails-là, ils sont très porteurs pour l’acteur. À certains moments, elle t’interpelle dans ce contexte et souligne avec précision un de tes gestes « là ! ce que tu viens de faire là, comment tu t’es accroupie dans ces verres, toi tu ne l’as peut-être pas vu mais…» Martine a un œil de l’ensemble, ses spectacles sont toujours comme une déclinaison d’images.
Al. v. S.: Martine utilise la concrétude des choses. Ce n’est pas du réalisme, parce que le réalisme au théâtre, c’est de l’illusionnisme. Il n’y a pas de trompe‑l’œil chez Martine, il n’y a pas de faux-semblant, il n’y a pas de décor en perspective, il y a l’utilisation immédiate des éléments qui sont là. Le foyer, l’énorme feu ouvert dans LA PILULE VERTE, nous l’alimentions tous les soirs avec des lattes que nous retirions du parquet. Cela dit, il y avait quand même un élément d’illusion parce qu’on regarnissait ces lattes de jour en jour. Mais le public avait vraiment l’impression qu’on retirait ces lattes du sol.

D. Gr.: Il y aussi le concret du temps, comme dans MADEMOISELLE JULIE, où mon personnage, Christine, pétrissait le pain au moment où les gens entraient dans la salle. Elle avait fait abattre une porte pour que j’aie une petite cuisine où le public me voyait pétrir par un de ces miroirs panoramiques qu’on met dans les parkings. C’était aussi une allusion à la peinture, à Vermeer, à l’image qui vient se rétrécir. Le pain levait pendant le spectacle et était cuit en temps réel à la fin de celui-ci. Cette superbe odeur envahissait le théâtre et puis nous mangions le pain à la fin. Je trouve magnifique que le temps s’écoule sur scène et qu’il soit fait d’odeurs, de moments. À travers ce temps, et ce qu’elle y met, Martine expose une relation organique à la matière.