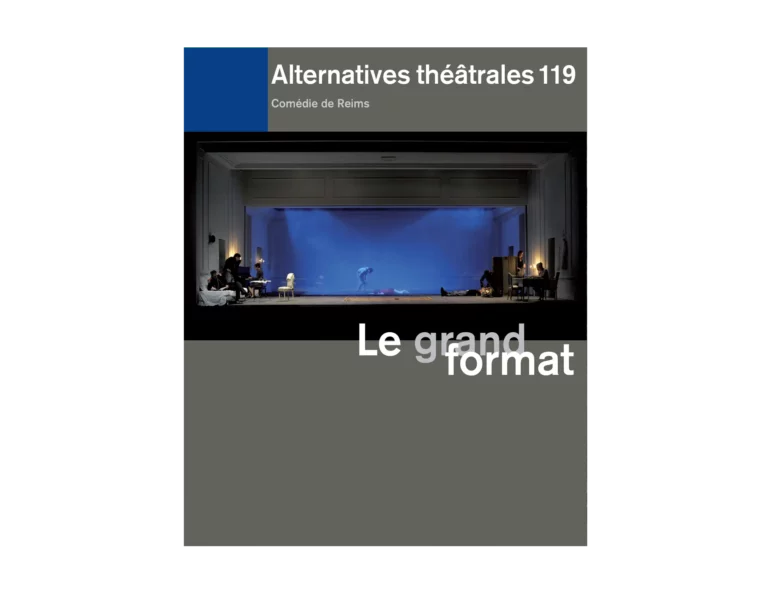BÉRÉNICE HAMIDI-KIM : À l’origine (en 2009), le manifeste du théâtre permanent d’Aubervilliers impliquait de jouer du mardi au samedi, avec chaque jour un programme énorme pour une si petite troupe : ateliers de transmission le matin, répétitions l’après-midi, représentations le soir. Sans compter la création d’une nouvelle pièce tous les deux mois, le « porte-à-porte » dans le quartier… Était-ce le cœur du projet : faire du théâtre un exploit physique, héroïque, au risque de l’épuisement ?
Gwenaël Morin : Il y avait une dimension physique, c’est certain, mais ce n’était pas l’Everest non plus ! Le projet était de faire du théâtre une expérience et une pratique qui fassent partie de notre rythme de vie quotidien… Je crois à l’idée que l’art transforme la vie ; eh bien ! qu’il transforme d’abord ma propre vie avant que je ne prétende influer sur la production de sens pour autrui. J’avais aussi souffert de travailler au coup par coup, par intermittence. Il me semblait qu’il y avait là une perte d’énergie considérable. Le théâtre permanent était la forme simple, élémentaire, pour affirmer cette volonté d’un théâtre au jour le jour tout en dessinant une perspective sur le long terme. Nous voulions aussi faire la tentative d’une certaine forme de rituel. En tant qu’artiste de théâtre, je considère que mon travail consiste à donner au temps une forme spécifique, qui passe par les corps. L’enjeu était aussi d’affirmer un principe de répétition inexorable, tous les jours – je pense que c’est la vocation même du travail de recherche théâtrale. La répétition est un processus d’épuisement, il s’agit de répéter pour s’améliorer, certes. Mais ça, c’est la dimension technique. La dimension expérimentale consiste, par une insistance dans la répétition, à épuiser un certain nombre de possibilités pour faire l’expérience de l’inimaginable. C’est une recherche dans la répétition du même, pour un « trouvage » permanent, jusqu’à ce que quelque chose advienne… ou pas. Recommencer, refaire, répéter. C’est un engagement de l’ordre de la course de fond, au lieu du sprint que produit l’intermittence du travail artistique.
B. H.-K.: En quelle mesure, ou plutôt dé-mesure, s’agit-il aussi d’un geste politique pour vous ? Est-ce une façon de lutter contre un certain devenir routinier des missions du « théâtre public » au sein des institutions censées l’incarner, de leur rendre leur grandeur ?
G. M.: Ce n’est pas de la démesure en soi, cela paraît démesuré parce que nous sommes peu nombreux à le faire, alors même que toute l’histoire du théâtre est traversée par ce mythe de la troupe, depuis Shakespeare jusqu’à Mnouchkine en passant par Vitez ou Kantor. J’ai voulu moi aussi faire l’expérience d’un engagement total dans cette activité : faire du théâtre – ce qui ne signifie pas seulement faire des spectacles. C’est exceptionnel, mais c’est pourtant un idéal commun et je n’ai pas l’impression d’inventer quelque chose de singulier. Par ailleurs, cela n’est possible que grâce à la beauté de l’engagement de mes acteurs et collaborateurs. C’est en ce sens là que le projet est exceptionnel : c’est une expérience que n’importe qui devrait pouvoir faire, mais que l’on ne peut pas faire avec n’importe qui. Je n’aurais jamais pu faire cela seul. Je peux simplement contribuer à insuffler une sorte d’enthousiasme – d’aveuglement peut-être. D’ailleurs, qui veut faire du théâtre avoue son incapacité à être seul. Nous, les artistes, sommes des faibles de la solitude. Si je regrette parfois le fonctionnement des CDN et Scènes Nationales, c’est qu’il pousse les artistes à produire des biens culturels, et que ces théâtres deviennent des magasins où consommer. On quitte ce qui est selon moi la vocation du théâtre public : l’affirmation publique de la parole comme espace de construction de la relation à l’autre et de construction de la société. Ce n’est pas le seul endroit, mais au théâtre il s’agit d’une parole utopique, poétique. Un théâtre est le lieu où doit se réaffirmer, au jour le jour, cette parole dans la Cité, avant d’être un lieu où diffuser des produits culturels. Ça n’a rien à voir avec la nostalgie d’un âge d’or du théâtre. Pour moi le théâtre est quelque chose de toujours illégitime, précaire, mais il doit le rester, être sur le point de vaciller et ne pas s’en plaindre car c’est sa fonction même. Il y a souvent un discours terrible sur le fait qu’il faut protéger les artistes, parce qu’ils seraient fragiles et parce que sans confort ils ne pourraient pas produire de chefs‑d’œuvre. Mais les artistes n’ont pas besoin d’être protégés, et ils n’ont pas forcément à produire des objets irréprochables, parfaits. Je ne suis pas dans la quête de l’excellence et j’essaie de sortir de ce rapport avec le public comme avec les acteurs. J’essaie qu’ils acceptent non pas l’approximation, mais que la transformation du travail au jour le jour participe aussi du plaisir du spectateur. « Art vivant », dit-on : ce qui est vivant, c’est l’œuvre. Que les gens voient le spectacle vivre !