SANS REVENIR aux origines du genre, aux fastes et délicatesses de l’opéra florentin, aux défis techniques des machines baroques, aux inventions sonores de l’opéra romantique, aux longueurs réelles ou prétendues de quelques Wagner (ou Verdi), aux complexités formelles des œuvres lyriques du XXe siècle, aux ouvertures spatiales des opéras en plein air et/ou sonorisés, il est clair que l’opéra n’a jamais craint le « grand », pour ne pas dire l’excès, l’extrême, et qu’il a souvent aimé l’immense. Pendant quelques siècles, l’opéra fut, pour le théâtre, le petit frère devenu grand – un peu trop grand diront certains, en tout cas dépassant son aîné de quelques tailles et pointures. Ambitieux et embarrassant. Grandes voix, grand orchestre, grands chœurs (doubles et triples), grandes salles, grands spectacles, et même parfois – plaisir extrême – grands scandales. Mais tout aussi bien, et l’amateur réel le sait, opéras de chambre, opéras de poche, opéras-bouffes, opérettes, voix blanches, et une musique qui, pour paraphraser Debussy, paraît sortir de l’ombre et y rentrer parfois.
Dans ces énumérations contradictoires, que l’on pourrait poursuivre, transparaît une vérité : s’il n’est pas voué à la démesure, l’opéra est condamné à l’exigence, à une exigence particulièrement aiguë. La formule n’est pas un simple effet de langage, car l’opéra est l’art du risque par excellence. Que la voix casse, et le crapaud s’échappe. Que le metteur en scène brise trop de barrières, et le public hurle. Ce fut le cas à Bayreuth cet été, pour LE RING du bicentenaire de Richard Wagner, monté par Frank Castorf, et qui s’acheva par dix minutes de huées au moment des saluts – dix minutes de violence maintenue à vif par le metteur en scène, bravant ironiquement la salle, les bras croisés. Une telle démesure nous servira de point de départ, car elle est symptomatique de l’opéra. Jamais rien de tel au théâtre. Jamais tant de brutalité. Ni d’ardeur. Ou si rarement. Seule la musique, par tout ce qu’elle charrie d’informulé, d’intime, d’inconscient en chacun des spectateurs, est en mesure de ramener sur la terre ferme du théâtre de telles vagues d’émotion et d’imprévisibilité.
C’est toujours avec vigueur que les eaux du désir s’y mêlent au sable du réel. Quelques jours avant la première, le metteur en scène et la direction du théâtre se sont égratignés par voie de presse : des répétitions ridiculement réduites (neuf jours pour monter L’OR DU RHIN), une ponctualité, une présence aux répétitions comme ceci et comme cela, de tel ou tel. Rien que d’insignifiant. En réalité, l’opéra est presque toujours chauffé à blanc par un planning intenable. L’énergie qu’il dégage résulte de ces conditions extrêmes, qui supposent en amont une organisation, une préparation et une maîtrise remarquables, mais qui en fin de course lancent le spectacle à toute volée vers la Première. Chanter et courir en même temps ? Cela ne se peut pas – mais on essaiera. Essaie. Oui, c’est cela. Joue.
L’opéra fait jaillir l’étincelle sur cette zone minuscule et mobile où tout peut basculer dans le néant. C’est pourquoi, bien plus encore qu’un art du risque, de l’excès, de la démesure, l’opéra m’apparaît comme un art du possible. Là est sa grandeur exacte, qui n’est pas mesurable. Cela n’est pas possible ? Alors que l’imagination passe outre1.
Le Ring : un cycle pour notre temps
Parmi les folies de l’art, de celles qui ont entraîné les hommes au-delà de leurs limites, dans tous les sens du terme, il y a l’œuvre de Wagner, et en particulier cette Tétralogie qui se préoccupe de la fin des choses et de leur principe – pour reprendre un vocabulaire pascalien. Œuvre d’une vie, symbole par excellence du « grand » à la mode opératique – par le format (trois journées et un prologue, soit plus de seize heures d’opéra), le personnel dramatique (dieux, hommes, demi-dieux, figures de la nature), les voix (puissance et vaillance requises), les enjeux esthétiques (refonder l’opéra par un langage neuf, synthétique et sacré), les sources épiques (l’ancienne saga scandinave lui confère la force structurante du mythe), le propos politique (montrer les mécanismes de la conquête de l’or, épine dorsale de la vie sociale), la portée morale et psychique (tous les sentiments y apparaissent à nu), l’ambition philosophique (prédire la fin des dieux et le retour au silence des origines), etc., ce cycle d’une richesse et d’une densité sans pareilles a été largement représenté ces dernières années, sans que la perspective du bicentenaire « Wagner » puisse apparaître comme la seule responsable de cette floraison inattendue. En pleine période de crise économique, de renouvellement techno- logique et de reconfiguration planétaire, LE RING permet de jouer grand et d’interroger le monde sur de multiples fronts. Pouvoir explorer l’origine et la chute d’une civilisation, tenter de la mettre (ou non) en relation avec notre temps, prendre tous ces risques entre le néant et l’infini du possible opératique, quoi de plus excitant pour un théâtre et un metteur en scène ?
C’est peu dire que LE RING « du bicentenaire Wagner », monté à Bayreuth en juillet-août 2013 était attendu.


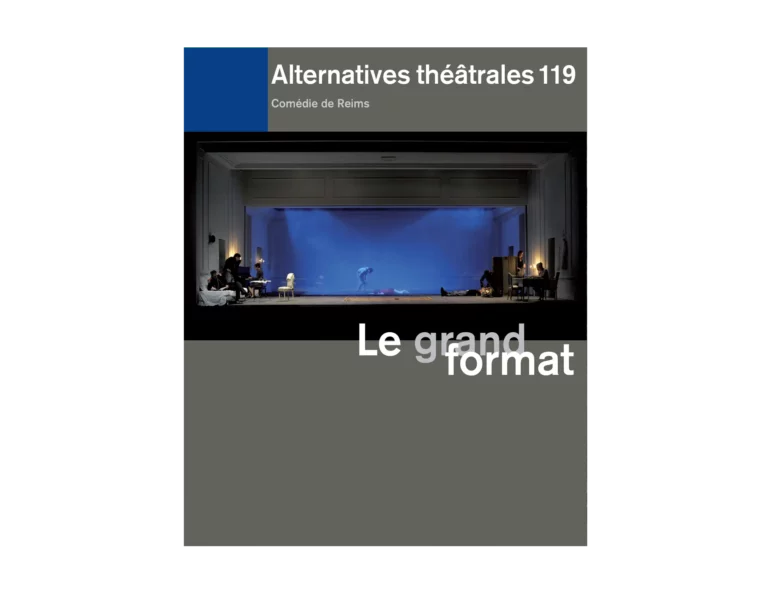



![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)
