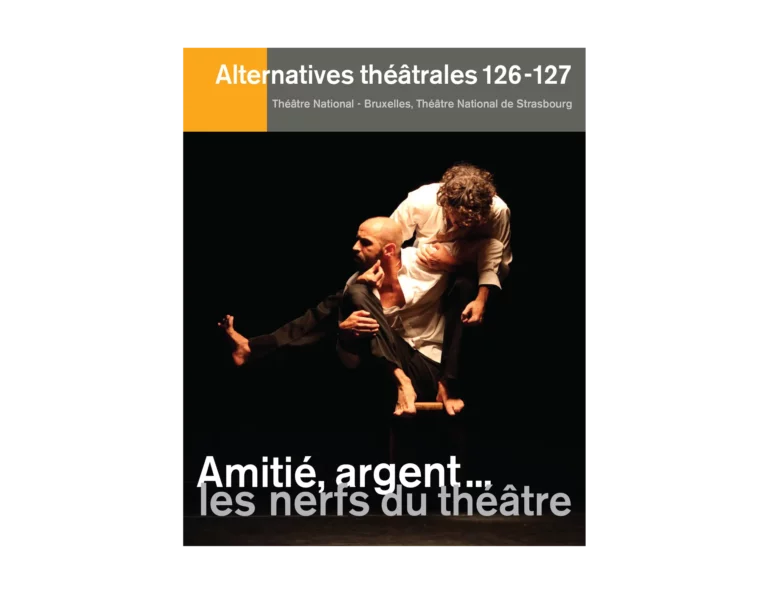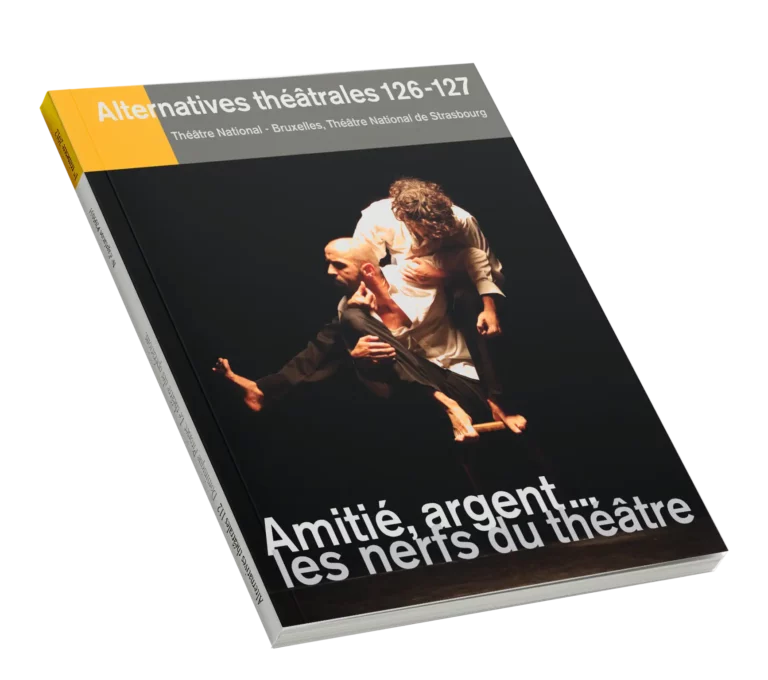GEORGES BANU : Le moment inaugural, le hasard d’une rencontre anonyme convertie ensuite en empreinte mnémonique : la chaleur avignonnaise, les platanes et le rassemblement de bouquinistes au début de l’avenue de la République. Je m’arrête devant une petite table sur laquelle m’attire la couverture d’une nouvelle revue, placée d’emblée sous le signe qui deviendra ensuite emblématique de la modernité : une « servante » ! Cette « servante », alors, était la « signature » de Robert Wilson… cette lampe, cette figure de la solitude pudiquement désignée sur une scène. Je me suis arrêté et, sans hésiter, j’ai acheté le premier numéro d’Alternatives théâtrales qui marquera plus d’un quart de siècle de ma vie. Je n’ai pas raté la première rencontre qui, confirmée, a assuré, ensuite, la longévité de cette confiance initiale.
Bernard Debroux : C’était le premier numéro ! Nous pratiquions la vente militante, dans la rue ! La revue était mince… 44 pages en format A4. C’est toi qui as amené beaucoup plus tard (en 1996), l’idée du numéro triple : 256 pages ! Le numéro sans doute le plus important de notre histoire : Les Répétitions.
G. B.: Depuis Proust, nous le savons, la mémoire reste indissociable des lieux qui fixent les souvenirs et leur préservent une aura intouchable. La revue découverte à Avignon, d’emblée, je l’avais aimée, je m’y suis retrouvé : son esprit était le mien, désormais orphelin de Travail théâtral, la revue mythique à laquelle Bernard Dort m’avait convié en tant que membre du comité de rédaction. Arrivé de Bucarest, impliqué là-bas dans les destins de la plus importante revue culturelle, le XXe siècle, j’ai trouvé un premier lieu d’accueil. Mais Travail théâtral venait de succomber sous la pression des tiraillements idéologiques et des aléas rédactionnels. Suite à la découverte avignonnaise d’Alternatives théâtrales, un été, chez une amie aujourd’hui disparue, à Saucet les Pins, j’ai rédigé un essai sur l’artiste unique, vieux maître du butô, Kazuo Ohno, dont j’avais éprouvé l’éblouissement plusieurs semaines auparavant. Ce fut un aveu, un aveu qui se rattachait à cette définition de Valéry dans laquelle je me reconnais : « le critique, un expert en objets aimés ». Non il ne s’agissait pas du théâtre japonais dans sa version archéologique, canonique, mais d’un artiste japonais confronté à une rencontre décisive avec une danseuse occidentale, espagnole, Argentina, c’est ce souvenir mythique qu’Ohno ressuscitait avec génie. À Saucet, j’ai trouvé un téléphone public – à un angle de rues que j’ai encore sous mes yeux – d’où je t’ai appelé et je t’ai proposé mon essai. Il allait paraître peu de temps après… et ainsi, sur fond d’affinité aurorale, s’engagea notre aventure éditoriale. Elle resta tout ce temps sous le signe d’une entente affranchie de tout effort de conviction, une même sensibilité nous reliait. Affectivement investi dans mes propositions pour la revue – textes, thématiques –, je dois avouer ma satisfaction pour le fait qu’elles ont connu auprès de toi un écho immédiat, sensible, dépourvu de la prose du labeur « dramaturgique ». Ainsi se décida la mise en place de bon nombre de numéros spéciaux : Scénographie-images et lieux, Le théâtre de la nature, Le théâtre testamentaire, Les liaisons singulières, et tant d’autres. Ce dont je me souviens c’est chaque fois l’intimité des lieux où la décision commune fut prise : un restaurant de caractère ou un café d’hôtel près de la gare Bruxelles-Midi ! Peu importe, nous partagions les mêmes vœux. Et cela se trouve à l’origine du lien poétique qui s’est noué entre nous dès le début et qui, au fur et à mesure, s’est érigé en base naturelle, organique, de notre collaboration.
B. D.: Travail théâtral, dont la démarche éditoriale nous a sans doute inspirés, a été fondé par Bernard Dort en 1971, et son dernier numéro paraît en 1979, année de naissance d’Alternatives théâtrales…
Alternatives théâtrales est fabriquée et pensée au départ en Belgique et toi, à Paris, au cœur de l’activité théâtrale, tu viens d’ailleurs et peux porter un regard décalé.
L’année de la création de la revue a lieu le premier festival international de théâtre à Bruxelles où on retrouve l’avant-garde américaine (Les Mabou mines, Lucinda Childs, le Squat theatre…) mais aussi l’Odin teatret d’Eugenio Barba !
Tes premiers textes dans la revue sont pour Kazuo ohno et Grotowski. Ce que nous partageons d’emblée pour la vie de la revue, et ce qui en fera une de ses caractéristiques majeures, c’est l’ouverture et le regard sur le monde.
G. B.: Grâce à cette liberté qui n’avait rien d’une désinvolture nous avons pu toucher des sujets jamais traités ailleurs et aborder des paysages théâtraux qui ne s’inscrivaient pas sur la carte répertoriée des territoires de choix : la Pologne, le Chili, la Roumanie. Par ailleurs, grâce à notre « lien poétique », nous avons retenu, avant qu’ils deviennent « glorieux », des spectacles emblématiques devenus mythiques : le MAhABhARATA ou RWANDA 94, choix jamais regrettés. Certains protagonistes de la scène moderne ont trouvé dans la revue l’accueil qui confortait leur avènement fulgurant, Warlikowski en particulier. L’amitié se trouve à l’origine de ces « affinités électives ».
B. D.: Ta participation à ce qui progressivement est devenu l’identité de la revue est sans doute liée à cette démarche. Les spectacles, les artistes, les aventures que l’on a voulu défendre, ont été choisis d’abord par goût, par sensibilité partagée, avant le déterminant politique ou dramaturgique.
Oui, ce qui fonde notre relation, c’est une idée poétique de l’édition et du théâtre…
Nous avons pu aussi partager à certains moments une certaine dose de folie. Pour le numéro des Répétitions, tu as eu cette intuition que le moment était venu (alors que le XXe siècle s’achevait, qui avait vu s’accomplir l’art de la mise en scène dans le théâtre occidental, et par là consacré le phénomène des répétitions), de réaliser ce qu’on peut appeler sans fausse modestie une « somme » sur la question.
Tu m’avais écrit à ce moment que pour traiter pareil sujet, on ne pouvait se limiter à six articles et trois entretiens et qu’il fallait tenter d’aborder le phénomène dans toute son amplitude, dans ses dimensions historiques autant que contemporaines et pratiques.
Ce numéro emblématique, plusieurs fois réédité et finalement épuisé, a influencé beaucoup de praticiens du théâtre par la suite…
Ce que nous avions en commun dans l’invention des numéros et leur diffusion, c’était de tenter de lier pensée critique, parfois théorique, avec une approche pratique et concrète de l’art.
Comme aussi le souci constant de donner la parole aux artistes…
G. B.: Oui, faire parler et entendre des artistes, cette envie d’expression orale, propre au théâtre, nous ne l’avons jamais sacrifiée ni trahie.
Par ailleurs, on peut dire que l’on a bénéficié aussi de la confiance réciproque. Tu as fait des numéros que tu as décidés et que tu as réalisés seul et dans lequel je ne me suis pas impliqué – pas parce que j’étais contre, mais parce que ce n’était pas mon domaine…
B. D.: …et en même temps tu les défendais…
G. B.: Peut-être que notre amitié a survécu sans encombre parce qu’elle est une amitié qui s’est exercée à « mi-distance », entre Paris et Bruxelles. Trop de rapprochement au quotidien engendre parfois des frictions et conduit à une « satiété » dangereuse : le prouvent même les amitiés mythiques de Stanislavski et Dantchenko, de Strehler et Grassi. Parce que proches et éloignés, nous sommes restés à l’abri des conflits. La mi-distance a été propice à notre « lien poétique » fondé sur une confiance partagée et une ouverture bien tempérée. La vie nous a aidés. Je dois l’avouer, l’amitié se gagne aussi grâce à des gestes risqués, à des décisions sans garantie économique.
B. D.: Comme tu l’écris dans ton texte introductif, les amitiés où il n’y a pas de compétition sont plus durables. Nous n’avons jamais eu de querelle d’égo. Il y a aussi la part d’admiration qui est propice à l’amitié. Quand tu proposais des thèmes de numéros ou des articles, j’avais sans doute confiance, mais il y avait aussi une reconnaissance de la pertinence de ta pensée critique et de tes qualités d’écriture.
Je sentais que ton engagement à Alternatives théâtrales était un choix, un désir, et le goût de partager avec moi une aventure éditoriale en collaboration avec Patrice, dont nous apprécions tous deux le talent et le travail graphiques.
G. B.: Le mot désir est très juste. oui, il n’y a jamais eu de désir contrarié tout au long de notre collaboration.