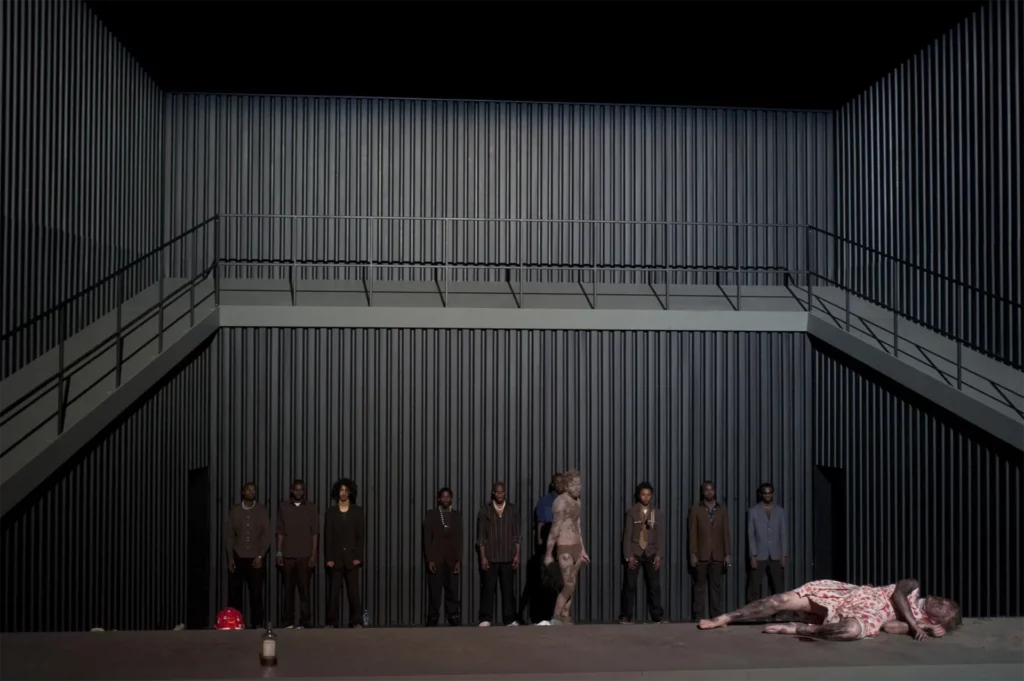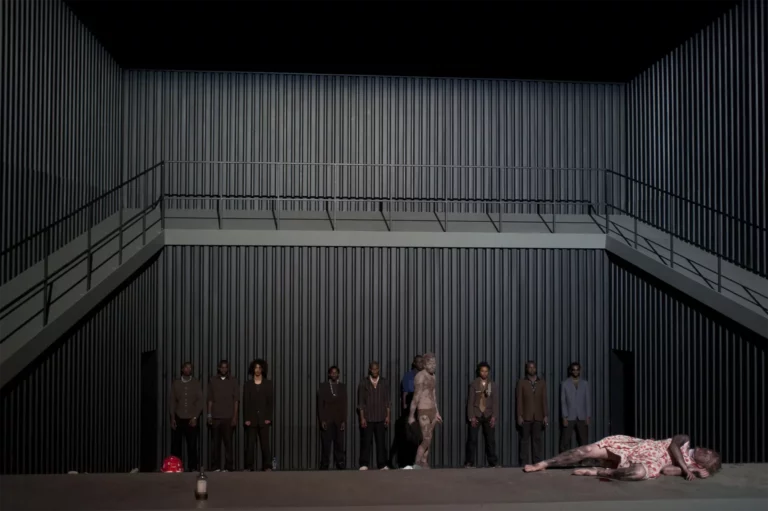Les plateaux des scènes contemporaines restent étrangement monochromes et ne reflètent pas la pluralité des corps et des voix qui constitue aujourd’hui la nation française. Le monde du spectacle ne manque pourtant pas d’acteurs issus des diversités, mais si on les retrouve au cinéma ou à la télévision, dans le spectacle vivant, ce sont, ces dernières années, les plateaux des shows humoristiques et des comédies musicales telles Les trois Mousquetaires1 qui font une place à ces artistes. Les scènes contemporaines des théâtres nationaux accueillent des Afro-descendants quand il est question de faire un focus Afrique, comme l’a très bien montré cette édition 2017 du Festival d’Avignon. Autrement dit, il faut un éclairage qui fasse actualité, qu’il s’agisse de traiter de l’esclavage, de la colonisation ou de s’intéresser aux migrations, aux génocides, et aux guerres du Continent noir.
Les acteurs ethnicisés par un taux de mélanine remarquable ne sont pas envisagés comme acteurs nationaux, comme acteurs français, mais comme des acteurs à qui on demande de convoquer un ailleurs, l’Afrique ou les îles, voire la banlieue. Par la force des choses, ils se retrouvent enfermés dans un enclos néocolonial, à la marge de la société qui est la leur, la société française où ils ont grandi, où ils se sont formés comme acteurs. Ils se retrouvent étrangers de l’intérieur, assignés à jouer l’Autre, celui qui n’est pas d’ici, et on leur demande même de prendre l’accent de cet autre fantasmé.
« Pourquoi hommes et femmes noirs restent-ils enfermés dans leur apparence épithéliale au regard de créateurs, metteurs en scène et directeurs de théâtre qui ne voient pas au-delà de la peau ? »
On les enferme dans un territoire fantasmatique associé à la couleur de leur épiderme. Pourtant le corps de l’acteur n’est pas le corps du personnage. Un personnage dramatique a‑t-il a priori une peau2, une texture de cheveu, un accent, des yeux bridés, un nez épaté ? Ethniciser l’acteur dont la mélanine et les caractéristiques capillaires se remarquent témoigne d’un impensé des scènes contemporaines ou plutôt d’une difficulté à penser une question politique, cette diversité constitutive de la société française. Et il n’est pas là question de diversité culturelle ou religieuse, mais bien d’une diversité organique de la nation.
Altérité et ethnicisation
La France n’en est pas à un paradoxe près. Au sortir de la colonisation, les artistes africains, antillais ou asiatiques de la scène française ne sont pas perçus comme étrangers. Jean Vilar engage dans sa troupe dès 1952 Daniel Sorano qui sera un des piliers du Théâtre national Populaire. L’acteur franco-sénégalais aura un succès considérable avec Cyrano de Bergerac. À la même époque, Jean-Marie Serreau ouvre le théâtre de Babylone en distribuant Douta Seck, un jeune Sénégalais dans le Spartacus de Max Adelbert et, dans ses premières mises en scène de Brecht, on retrouve des acteurs de toutes origines. Serreau défend alors une vision du théâtre qui relève d’une utopie babelienne et revendique le brassage des corps et des voix de toutes couleurs. En 1959, il accueille au théâtre de Lutèce la compagnie des Griots avec la création des Nègres dans la mise en scène de Roger Blin. Il s’engage dans un théâtre de la décolonisation et monte Kateb Yacine, Aimé Césaire, Bernard Dadié, Adrienne Kennedy. Jusqu’à sa mort prématurée en 1972, Serreau s’entoure d’acteurs africains et caribéens3 aux accents variés qu’il distribue dans les pièces du répertoire contemporain, de Brecht à Genet, de Claudel à Ionesco, en passant par Beckett, Max Frisch, Vinaver… et bien sûr Césaire dont il crée La Tragédie du Roi Christophe en 19644. Quand il monte pour le Festival d’Avignon Béatrice du Congo de Dadié au Théâtre des Carmes, on s’étonne de la pluralité des accents qui résonne sur le plateau.
De son côté, Jean-Louis Barrault travaille avec Robert Liensol et Georges Aminel qui entrera à la Comédie-Française en 1967. Greg Germain rejoint la troupe d’Antoine Bourseiller, Jenny Alpha et Bachir Touré jouent sous la direction d’Henri Ronce. Antoine Vitez travaille avec Akonio Dolo et pratique la « distribution libre », autrement dit sans a priori racial, au Théâtre des Quatiers d’Ivry.
C’est à la fin des années 1970, après le choc pétrolier, l’arrivée du chômage et l’entrée de l’immigration dans le discours politique qu’un changement se fait sentir. Les médias montrent systématiquement des Noirs pour évoquer l’immigration et l’acteur ethnicisé endosse l’image du travailleur immigré5. Le théâtre se fait largement le miroir de cette crispation de la société, tout en dénonçant le racisme, c’est L’Étranger dans la Maison de Richard Demarcy avec Alain Aithnard en 1982 à la Cité Internationale, Combat de nègre et de chiens de Bernard-Marie Koltès, mis en scène par Patrice Chéreau, avec Sidiki Bakaba, puis Isaach de Bankolé au Théâtre des Amandiers de Nanterre en 1983, suivi en 1986 de Quai ouest et Dans la Solitude des champs de coton puis Y a bon Bamboula de Tilly au Théâtre Paris-Villette en 1987. La conséquence est simple, l’acteur noir incarne l’immigré, l’étranger et fait signe dans les distributions. Quand Jean-Christian Grinevald monte Le Misanthrope avec Paulin Fodouop dans le rôle d’Alceste au Théâtre de la Main d’or au début des années 1990, le texte de Molière résonne soudain autrement et convoque l’altérité d’un Alceste devenu « étranger » à la cour.