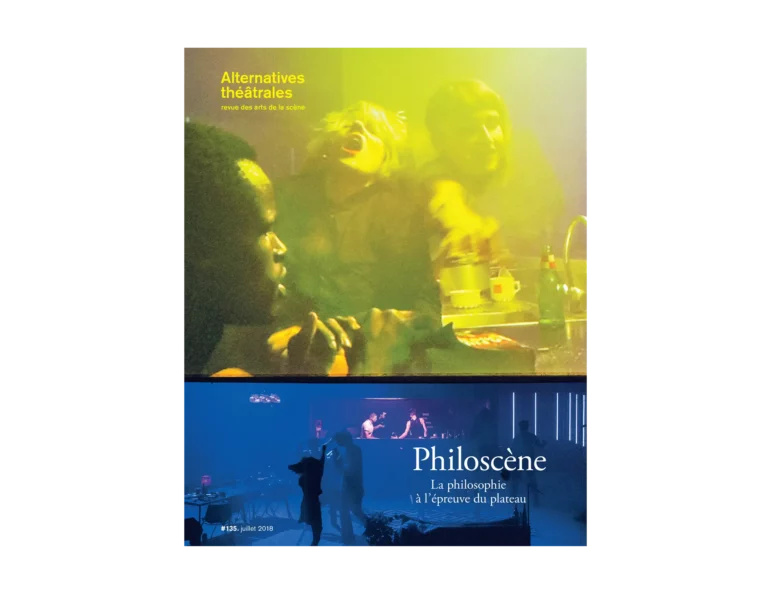Pauline d’Ollone, une des nombreuses jeunes Françaises du paysage théâtral belge mérite sa double nationalité. Licenciée en Lettres modernes, violoniste (formée au Conservatoire/ Paris), comédienne (formée à l’INSAS/ Bruxelles) elle met en scène une irrésistible adaptation du Banquet de Platon.
Tout a commencé à la Comédie-Française en 2010, lors d’un Banquet adapté par Jacques Vincey. « J’ai perçu, dit-elle, les écueils dans lesquels il ne fallait pas que je tombe : un texte extrêmement littéraire et intellectuel, très désincarné, rien que l’essence philosophique sans aucune mise en jeu des corps. On en oublie la complexité des personnages d’où sont nées ces idées. La pensée n’est plus mouvement, elle est statique, figée et presque ennuyeuse ». Et vlan ! Son modèle ? Les Flamands de TG Stan qui « s’emparent de Molière avec un regard contemporain et donnent la parole au corps, alors qu’en France, Molière est souvent devenu un objet de décoration dans notre chambre ».
Appliquée à Platon, la recherche de rajeunissement est double. Sur le fond, que prendre et laisser des théories platoniciennes sur l’amour ? Qu’est-ce qui est (in)audible pour une femme contemporaine ? Et sur la forme, comment passer de la philosophie au théâtre ? « Les théories philosophiques s’incarnent dans des expériences, des troubles amoureux entre certains personnages. Il se passe plein de choses entre eux avant d’arriver à l’expression d’une vérité. Ils ont des doutes sur les diverses théories de l’amour que chacun expose. Ils ont des éternuements, ils s’interrompent, ils ont des règlements de compte entre eux. J’ai essayé de creuser ça, de faire apparaitre des « personnages » au-delà des porteurs d’idées. » Elle s’appuie, notamment, sur les notes de bas de page pour éclairer les rapports de force et d’amour, non dits dans le texte, et qui éclairent les théories de chacun comme autant d’« autoportraits » dynamiques. Ainsi fait-elle de Socrate non seulement un manieur d’idées et de paradoxes mais un « moteur affectif ».
« Tout le monde attend Socrate, le maître « désiré ». Chez Platon cela prend peu de place, mais c’est un excellent élément dramaturgique qui se traduit par des mouvements vifs, des impatiences, bref, des sentiments plutôt que des idées. Pour les exprimer, je me suis inspirée de Roland Barthes, qui dans Fragments d’un discours amoureux parle longuement de cette « attente » et de son lien avec le désir. »
Du Banquet de Platon, on ne retient souvent, à part Socrate, que deux personnages flamboyants. Aristophane, qui développe la fameuse théorie de l’androgyne et Alcibiade, le sulfureux politicien, amoureux ivre, éconduit par Socrate. Les autres sont de vagues porte-paroles de théories. Dans son adaptation, Pauline d’Ollone en fait un « portrait de groupe » dynamique.
« En bas de page, on apprend qu’Agathon est l’amant de Pausanias, je montre donc leur attirance sur scène. Agathon, l’hôte (« beau et bon »), est courtisé par tout le monde. J’ai donc développé son rôle, placé au centre de l’attention. Chacun défend des théories de l’amour mais en même temps, il y a dans ce groupe des rivalités amoureuses spectaculaires, comme l’arrivée tonitruante d’Alcibiade. Pausanias fait des règlements sur « qui on a le droit d’aimer », « comment il faut l’aimer » etc. D’où vient cette obsession de « réglementer » l’amour ? Cette volonté de hiérarchiser les êtres et les sentiments est un terreau propice à la discrimination et à l’esprit totalitaire de certaines lois : c’est à la fois risible et effrayant. Pour Eryximaque, il faut aimer sans souffrir. Pourquoi cette peur des excès de la souf- france ? Pour moi, il est guetté par la démesure et la folie et pour y échapper il s’appuie sur les théories matérialistes d’Épicure et de Lucrèce, un anachronisme que je revendique. Et si Diotime a tendance à tant parler d’immortalité, c’est qu’elle a peur de la mort qui la guette. Diotime meurt donc en parlant d’immortalité, une fin en beauté, en somme. J’ai chaque fois cherché les sources de conflit, ce qu’il y a derrière leurs idées. »