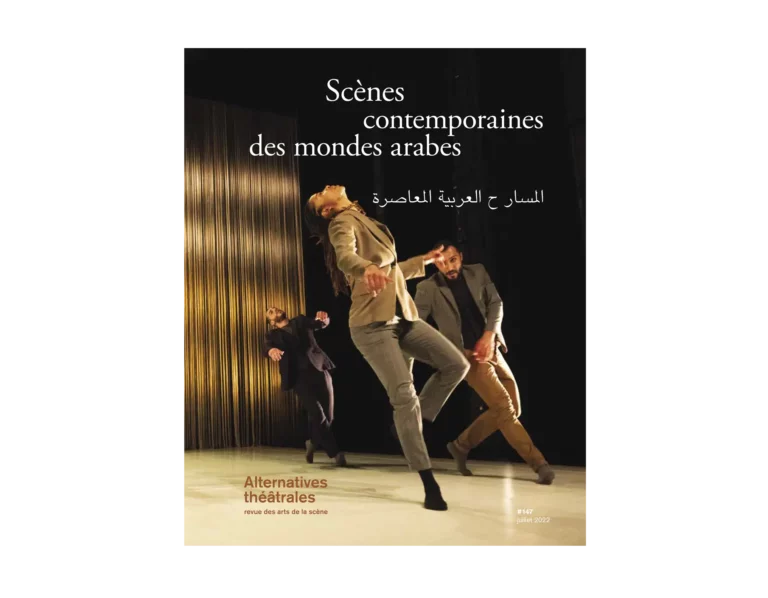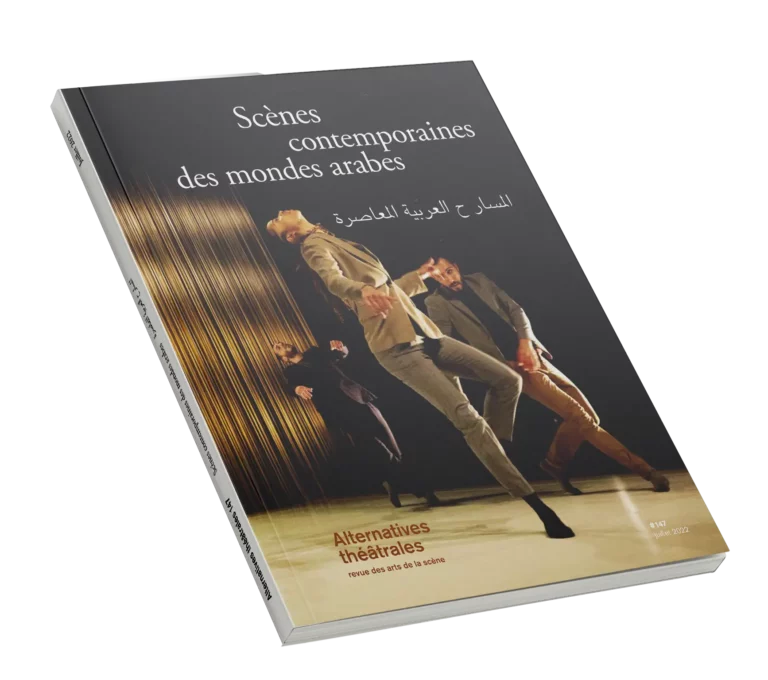Pour Wajdi Mouawad, le Liban, son pays d’origine, est « petit comme un jardin qu’un oiseau peut traverser en un jour ». Au-delà de la dimension miniature évoquée, la métaphore mérite d’être retenue tel le sceau souterrain de son identité. La culture arabe n’a‑t-elle pas érigé « le jardin » en espace privilégié et en parfait lieu de retraite, « jardin » qui la traverse des Mille et Une Nuits jusqu’aux tapis qui en fournissent la contamination généralisée. Mais ce « jardin » originel ne bénéficiera pas de la paix à laquelle, a priori, il renvoie, bien au contraire. Il sera le lieu des contradictions déchirantes qui ne laisseront pas indemne le jeune enfant séduit d’abord par la dimension héroïque des milices chrétiennes qui seront, ensuite, à l’origine des massacres de Sabra et Chatila. Une pareille rupture relie, comme dans un oxymore à jamais sous tension, le jardin pacificateur et les camps de l’horreur. Il servira de matrice à l’artiste qu’il deviendra.
Wajdi Mouawad témoigne de l’ampleur des désastres qui ont ravagé son « jardin » et il le fait avec une implication extrême ; il déplore haut et fort les blessures de sa culture. Culture peu encline à la réserve et à la rétention. « Crier » implique le courage d’assumer les désastres et de lancer des appels de détresse… Le théâtre de Wajdi Mouawad le confirme, et y a‑t-il preuve plus explicite de ce courage d’assumer la tragédie à corps perdu que son texte Incendies ? Les gens et les terres arabes, par l’ampleur de leurs conflits, nourrissent la puissance de cette plongée dans la souffrance. On ne pleure plus comme cela que dans le Moyen-Orient ou, jadis, dans la Grèce antique. Lessing rendait hommage à l’audace du cri dans la fameuse statue de Laocoon et, nous aujourd’hui, nous faisons notre sa conviction : oser pleurer est un acte de courage. Mais, sans jamais oublier tout à fait le réconfort du « jardin », oasis au cœur de la guerre.
On a reproché parfois à Wajdi Mouawad, comme autrefois à Camus, la cohérence de la narration et l’identité forte des personnages qui renvoient, dit-on, à une esthétique datée, étrangère aux opérations de dé-construction si fréquentes chez bon nombre d‘auteurs modernes. Mais symptomatique est la réponse de Mouawad qui motive son option par la référence à l’expérience historique de son pays. Confronté à la dé-construction du Liban, il voue son théâtre à un travail de construction. Et il cherche le lien aux dépens de la rupture, lien « dramaturgique » et nullement « politique ». Son théâtre ne camoufle pas les conflits, il les exacerbe même, mais sur fond de confiance faite à l’émotion comme liant. Et en cela, profondément, malgré tout, dans son théâtre persiste un espoir au cœur « du bruit et de la fureur ». Le fait de souffrir sans se briser rassure.
L’exil comme pulsion d’écriture
La guerre au Liban a fait exploser en morceaux la famille dont les membres se sont trouvés séparés en raison des départs imposés ou des contraintes matérielles. Wajdi Mouawad a quitté le Liban avec sa mère et sa sœur en se confrontant à l’expérience de l’exil. « Que serais-je devenu sans l’exil ? » se demande-t-il. L’exil appelle à un questionnement de soi, car il exige des choix à faire par rapport à l’identité, à sa conservation ou, au contraire, à l’intégration. L’exil est un défi pour tout artiste. Et Wajdi répond en se situant à la croisée de l’histoire et de la langue d’écriture. Il va trouver un équilibre inédit et fécond en sacrifiant l’usage de l’arabe sans pour autant oublier les blessures de son territoire d’origine. Ainsi il est d’ici et d’ailleurs. L’exil sera un défi, même météorologique, pour le jeune homme ayant vécu dans la douceur du Liban qui se trouve plongé dans la rigueur des froids canadiens. Il n’oubliera rien afin d’ériger cette expérience en matière d’écriture.
Wajdi Mouawad a consacré, successivement, des portraits aux membres de la famille. Comment oublierais-je une expérience qui, plus tard, se convertira en performance ? Nous étions trois pour visiter l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Comme nos rythmes de visite ne coïncidaient pas, d’un commun accord, nous nous sommes séparés pour nous fixer un rendez-vous précis à 13 heures à la sortie ! Moi-même et un ami, nous avons poursuivi la visite à deux, en passant d’un tableau à un autre ! Éparpillement des plaisirs. À la sortie, nous avons découvert Wajdi. Il nous avoua être resté, lui, tout le temps de la visite, devant l’immense tableau de Rembrandt Le retour du fils prodigue. Il s’en est imprégné. Mais, l’événement ne resta pas sans traces et Wajdi, à partir de Rembrandt, se livra à une performance dédiée au dialogue avec le père, Seuls ! Il se plaça sur le plateau, comme lui, seul face à la toile de Rembrandt… et, une fois, j’ai pu suivre le cheminement d’un événement de vie à l’émergence d’une œuvre. Je n’ai jamais pu voir Seuls sans penser au dialogue de Wajdi, à l’Ermitage, avec le père qui accueille son fils sur le pas de la porte ! Tandis que l’autre, le second, resté à la maison, se trouve renvoyé au second plan ! Quel désaveu de la fidélité, et quel hommage au voyage qui s’achève sur le retour, sur les retrouvailles générationnelles à l’entrée de la maison. De l’importance du seuil… Ainsi débutait la saga familiale de l’écrivain en exil.