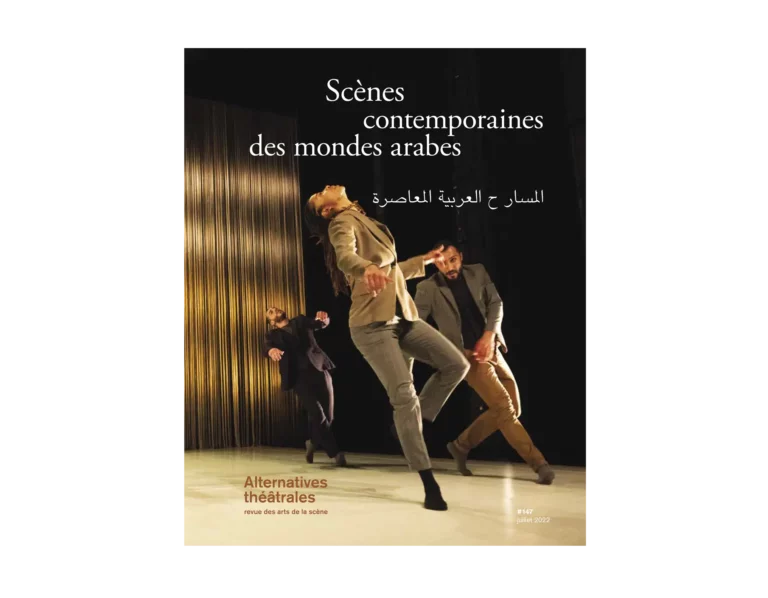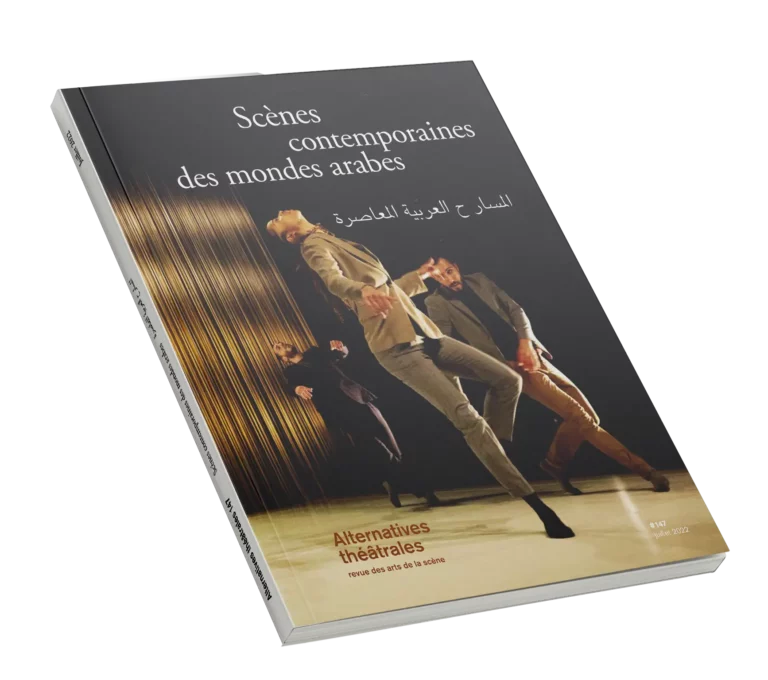Il y a chez les amateurs de Wajdi Mouawad un trait commun, une médaille dont les deux faces sont l’indulgence et la fureur.
Fureur, lorsqu’il se laisse aller aux excès de son génie, lorsqu’il trébuche sur la ligne de crête du pathos, oublie de couper la tête de la Méduse de sa propre création, par laquelle il se laisse fasciner (l’image est de lui). Indulgence, lorsqu’il commet quelques faux pas dans le domaine où il excelle : la sincérité, mâtinée d’autodérision, de sa si complexe autobiographie, celle d’un double exilé – du Liban bien sûr, mais aussi du Québec qu’il a quitté pour la France, bien que les enjeux de cette autre déterritorialisation soient bien différents. Il a fait de cette histoire personnelle, à force de la malaxer, la matière de ce qui est presque devenu mythologie.
Il y a d’ailleurs, dans Mère, très peu de ces faux pas à pardonner. C’est qu’il va au bout de la logique autobiographique et plonge, sans scrupule, dans un matériau si riche que l’on ignore pourquoi il a parfois besoin de s’en écarter en mettant en scène d’autres auteurs que lui-même.
Avant Père et Frères, les deux volets à venir, après Seuls, où Mouawad incarnait le fils qu’il était, et Sœurs, autre solo, Mère poursuit le cycle développant les différents points de vue des membres de sa famille sur leur histoire et son inscription dans l’Histoire. Un cycle que Mouawad a choisi d’appeler Domestique. Le terme peut surprendre, mais dit bien que c’est la question du foyer, de la terre d’appartenance que Mouawad pose, sans relâche, à travers les chemins généalogiques qu’il emprunte.
Il s’approche ici au plus près de sa vérité intime en racontant, selon un dispositif narratif somme toute assez simple – le Wajdi d’aujourd’hui est témoin du Wajdi d’hier, incarné par un enfant de dix ans – la période où il a vécu avec sa mère, sa sœur et son frère à Paris, en l’absence du père, resté sous les bombes beyrouthines dans l’espoir vain de gagner de quoi subvenir aux besoins de sa famille.