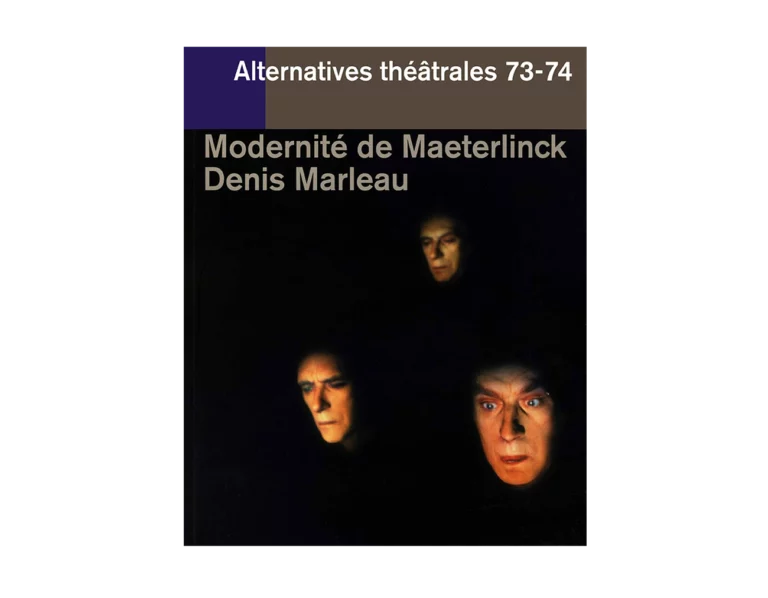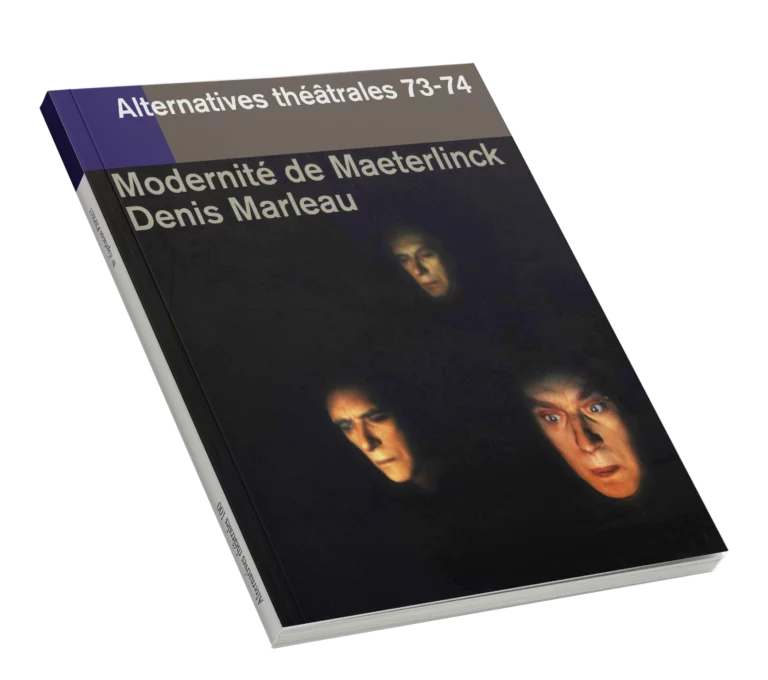EN JANVIER 1997 au Théâtre National à Bruxelles, PELLÉAS ET MÉLISANDE valut à son metteur en scène, Julien Roy, le prix du théâtre de la meilleure mise en scène de la saison. Rares en effet sont de tels instants d’harmonie entre l’univers d’un auteur et sa représentation scénique. Stupéfiant de beauté et de mystère, PELLÉAS ET MÉLISANDE donnait raison à Rilke lorsqu’il écrivait « je ne connais aucune œuvre dans laquelle soit enfermé autant de silence, autant de solitude ; d’adhésion et de paix, autant de royal éloignement de toute rumeur, de tout cri ». Cette proposition scénique était fidèle au symbolisme en retrouvant à la fois « la forme méditative du tragique contemporain » qu’évoquait Henri Ronse dans sa préface au texte publié chez Labor, et à qui Julien Roy rend grâce de l’avoir fait entrer dans Maeterlinck – il a joué en effet sous sa direction dans LES AVEUGLES et mis en scène, à son initiative, AGLAVAINE ET SÉLYSETTE. Enrichie des expériences de Meyerhold, de l’économie suggestive du Nô ou de la danse, la mise en scène de Julien Roy abordait l’œuvre tel un espace mental. La magnifique scénographie de Christian Fenouillat lié à la dramaturgie était plus suggestive que figurative, à la manière d’un Munch, d’un Spilliaert. Julien Roy trouvait une fois encore dans PELLÉAS ET MÉLISANDE ce qui le retient aussi chez Beckett ou Novarina : une interpellation de la parole, le pouvoir du poétique à traduire le secret, l’indicible, l’innommable.
Julien Roy— Maeterlinck a parié sur la langue, non sur la société ; une langue française dont i désapprend sciemment l’usage, en la réduisant au balbutiement, à l’écholalie, dans une sorte de régression au stade de pré-parole, jusqu’à l’entendre dans son frémissement originel. Car il importe moins au jeune poète de savoir de quoi on parle que de trouver d’où on parle : mise en abîme de l’homme par celle de la langue, à l’épreuve du sens. Le premier théâtre de Maeterlinck met en œuvre une poétique du silence qui « tend vers l’utopie d’un silence du mot », comme l’a écrit Delphine Cantoni. Par là, il nous donne à entendre notre béance psychique. Le personnage de L’INNOMMABLE de Beckett dira « entendre trop mal pour pouvoir parler, c’est ça mon silence… Ne plus entendre cette voix, c’est ça que j’appelle me taire ». Mélisande au moment de sa mort : « Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyez-vous… Je ne sais pas ce que je dis… Je ne sais pas ce que je sais… Je ne dis plus ce que je veux ». J’ajouterai avec Edmond Jabès : « subjuguée, la parole déserte la parole. Elle s’applique à n’être pas» ; avec Novarina : « c’est dessous la langue qu’on est maintenant, effondré ». Aussi les interprètes d’un tel théâtre n’ont-ils plus le droit, ici, d’incarner un personnage : à la manière de ces marionnettes si chères aux dramaturges symbolistes, – je pense notamment à Gordon Craig et Lugné Poe – ils doivent « se chercher dans leur incondition d’étranger » (Emmanuel Lévinas), jusqu’à nous apparaître totalement agis et parlés. Ainsi l’acteur ne sera-t-il plus l’usurpateur de nos rêves, mais le révélateur par défaut d’un théâtre intérieur à chacun.
Sophie Creuz— Comment avez-vous préparé les comédiens à ce travail sur le temps, la lenteur, à aborder une œuvre avec laquelle ils n’étaient pas familiers, hormis vos anciennes élèves, Muriel Clairembourg, Cécile Henry et Anne Beaupain.
J. R.—Essentiellement par l’écoute active du son de la langue, jusqu’aux limites de la perte du sens, à cette source où le son donne à voir et à entendre ce qu’on ne peut ni regarder ni écouter.